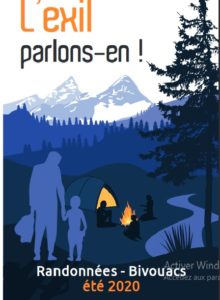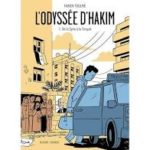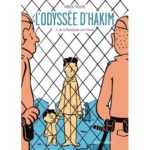Nettoyage, sécurité, aide à la personne… La crise sanitaire a mis en lumière l’importance de secteurs qui ont recours à une main-d’œuvre sans papiers. Des appels à manifester pour leur régularisation ont été lancés pour ce samedi.
La crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19 a révélé l’importance « des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal », a déclaré le président de la République, Emmanuel Macron, le 13 avril. Parmi ces agents de caisse, de nettoyage ou de sécurité, ces éboueurs ou aides à domicile, se trouvent de nombreux travailleurs étrangers sans papiers. Pour les raconter, Le Monde a reconstitué vingt-quatre heures dans la vie de l’économie française, au contact de ces « premiers de corvée ».
• 5 h 45

Abdoul (prénom modifié), ripeur intérimaire, emprunte un bus de nuit pour se rendre au travail. CAMILLE MILLERAND / DIVERGENCE POUR « LE MONDE »
La nuit est encore dense et, dans le métro, les premiers travailleurs de l’aube s’engouffrent. Abdoul (le prénom a été modifié) est de ceux-là. Ce Malien de 26 ans commence à 8 heures, mais, pour rejoindre l’usine de traitement des ordures ménagères pour laquelle il travaille, dans le sud de l’Ile-de-France, il doit prendre un métro, un RER et un bus, soit un peu plus d’une heure et demie de transport. Abdoul est « ripeur », ainsi qu’on nomme les éboueurs juchés à l’arrière des camions-bennes. Chaque jour, durant sa tournée, avec les deux collègues qui forment son équipe, il ramasse et charge une vingtaine de tonnes de déchets.
Pendant le confinement, Abdoul effectuait quarante heures par semaine. Le jeune homme fait partie de ces travailleurs restés au front au plus fort de l’épidémie. Chaque jour, il recevait un SMS de son employeur. « 5 heures demain matin, merci » ; « 8 heures demain matin, merci »… « Oui, chef », répond Abdoul sans varier. Ce boulot, c’est sa survie, sa planche de salut.

Uniforme d’Abdoul (prénom modifié), ripeur intériméraire depuis un an. Camille Millerand / Divergence pour « Le Monde »

Bus de nuit emprunté par Abdoul (prénom modifié), ripeur intérimaire, pour se rendre au travail. Il doit prévoir 1 h 30 de transport en commun. Camille Millerand / Divergence pour « Le Monde »
Abdoul est sans papiers. « Si t’as pas le truc, t’es dans la merde. » Le truc, c’est la façon pudique qu’il a de désigner le titre de séjour, le sésame pour une vie en règle. Après une année de galère, à dépendre des billets de 20 euros que les Maliens du foyer où il vit voulaient bien lui céder, Abdoul a réussi à trouver du travail, en utilisant les papiers d’un autre. On appelle ça « travailler sous alias », une méthode classique pour ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter un faux document d’identité. Abdoul pense que son employeur n’est pas dupe mais, dans le non-dit qui prévaut entre eux, chacun trouve son compte.
• 7 heures
Ousmane (le prénom a été modifié) arrive parmi les premiers ouvriers sur le chantier. Depuis trois ans, ce Sénégalais de 38 ans s’accommode d’une vie dans les interstices de la légalité. « Si tu n’as pas de papiers, tu n’es pas tranquille, reconnaît-il toutefois. Tu n’as pas de maison, tu ne peux pas circuler parce que tu as peur en cas de contrôle, tu n’as pas de carte Vitale, donc, quand tu es malade, tu ne peux pas être en arrêt… »
Ousmane travaille pour le sous-traitant d’une des plus grosses entreprises de construction française, spécialisé dans la propreté. Sur des chantiers d’Ile-de-France, il fait « tout », résume-t-il. Du ramassage de gravats à la désinfection de préfabriqués, en passant par le nettoyage de sanitaires ou encore le démontage d’échafaudages. « Parfois, on nous demande même de faire du béton », dit-il. Une vie dure, loin de son fils de 15 ans, resté au Sénégal, et marquée par des fins de mois à découvert. Mais Ousmane prend son mal en patience, dans l’espoir d’une régularisation future. « Quand j’aurai le titre de séjour, dit-il, j’irai visiter la France, je passerai mon permis de conduire et le permis de cariste. »
• 8 heures

Ousmane (prénom modifié), sénégalais, 38 ans, vit en France depuis trois ans. Il est agent de nettoyage sur des chantiers de BTP en Ile-de-France. Camille Millerand / Divergence pour « Le Monde »
D’ordinaire, à cette heure-ci, Lassana Soumare termine sa première vacation du jour. Jusqu’au 1er mai, il faisait le ménage dans une mairie d’arrondissement tôt le matin et, le soir, il rempilait pour quelques heures dans un grand hôpital parisien. La crise sanitaire a été une période chargée pour ce Malien de 35 ans, arrivé en France en 2014.
Mais, le 1er mai, son patron a mis fin à presque deux ans et demi de collaboration. Sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), délivrée après un contrôle d’identité, Lassana Soumare avait dû lui révéler sa situation et lui demander une promesse d’embauche pour essayer de contester la mesure administrative devant le tribunal. Résultat : l’employeur ne veut plus prendre le risque de le faire travailler tant qu’il n’est pas régularisé.
Pour se nourrir, Lassana Soumare dépend aujourd’hui des dons de l’Armée du salut. Et du 115 pour ne pas dormir dans la rue. Hébergé dans un centre du 10e arrondissement de Paris, il partage une chambre avec trois autres personnes . « Ce sont des gens ramassés dans la rue, ça change tout le temps. » Début juin, le test qu’il a effectué s’est révélé positif au SARS-CoV-2.
• 10 heures

Mamadou Nassokho, sénégalais, 26 ans, est livreur Frichti. Ici, lors d’une mobilisation devant le site Arago de la plate-forme, pour demander une régularisation, à Paris (14e). Camille Millerand / Divergence pour « Le Monde »
Ils sont une dizaine au moins, rassemblés devant un « hub » de Frichti, l’enseigne de préparation et de livraison de repas, dans le 14e arrondissement. Ils y resteront la journée. Tous réclament leur régularisation, lors d’un mouvement social inédit dans le secteur de la livraison. Plus de deux cents livreurs Frichti y participent. Originaires de Côte-d’Ivoire, du Burkina Faso, de Guinée, du Sénégal ou du Cameroun, ils ont été recrutés comme autoentrepreneurs, souvent sur simple présentation de leur passeport. « Pendant le confinement, on a tous travaillé », assurent-ils.

Mamadou Nassokho, sénégalais, 26 ans, livreur pour la plate-forme Frichti. Camille Millerand /Divergence pour « Le Monde »
Mamadou Nassokho, Sénégalais de 26 ans, est l’un d’eux. Depuis mars 2019, à raison d’une cinquantaine de kilomètres parcourus par jour, il gagnait entre 1 000 et 1 200 euros par mois. Avant cela, ce jeune titulaire d’une licence en logistique des transports et d’un master en management de qualité, a multiplié les petits boulots. « J’ai fait la plonge dans un resto, le ménage dans des bureaux, du bricolage… », énumère-t-il. De loin en loin, les grèves de travailleurs sans papiers viennent rappeler l’importance de la main-d’œuvre étrangère dans certains secteurs de l’économie.
• 11 heures

Réunion syndicale avec des intérimaires du nettoyage en Ile-de-France, dans la permanence départementale CGT Paris. Des traducteurs peuls et bambaras assurent la traduction des infos du jour. Camille Millerand/ Divergence pour » Le Monde »
Les bureaux de la CGT ne désemplissent pas. Depuis l’ouverture, à 8 h 30, de la permanence départementale d’accueil des travailleurs sans papiers, dans le 19e arrondissement, les personnes défilent, une liasse de documents sous le bras, autant de preuves de leur vie en France, qu’ils soumettent aux cégétistes, avant de déposer une demande de régularisation en préfecture.
Une partie seulement pourra solliciter une « admission exceptionnelle au séjour ». La régularisation par le travail dépend de critères qui ont été définis par une circulaire de 2012, dite « circulaire Valls ». Elle prévoit par exemple une présence minimum de trois ans sur le territoire, la détention d’au moins vingt-quatre feuilles de paie, ainsi qu’une promesse d’embauche. Ces critères n’ont pas force de loi. Et chaque préfecture conserve un pouvoir discrétionnaire pour délivrer un titre de séjour.
Alors qu’on estime entre 300 000 et 600 000 le nombre de sans-papiers en France, environ 30 000 personnes sont régularisées chaque année. La majorité obtient un titre pour des motifs familiaux et, pour 7 000 personnes environ, en raison du travail qu’elles exercent. « C’est une gestion de la politique migratoire au fil de l’eau, considère Marilyne Poulain, membre de la direction confédérale de la CGT. Et ça reste un instrument qui relève de l’exceptionnel, appliqué différemment selon les préfectures, et donc qui ne garantit pas l’égalité de droits. »
Interrogé par Le Monde, un cadre du ministère de l’intérieur convient que la circulaire Valls, dans sa mise en œuvre à bas bruit, présente l’avantage « de ne pas traiter le sujet par des grandes opérations de régularisation polémiques et déstabilisantes ». Place Beauvau, on veut éviter la « controverse » politique.
Certains considèrent qu’il faut au contraire ouvrir le débat, alors que la crise sanitaire a mis en lumière l’utilité sociale des « premiers de corvée » dans les métiers du nettoyage, de la sécurité, de la distribution ou encore du service à la personne. « Ces gens occupent des postes que personne ne veut occuper, précaires et difficiles. Ils font partie des personnes qu’on aurait pu applaudir pendant le confinement », fait valoir Clémence Martin, qui travaille pour le Secours catholique, dans le Val-de-Marne.

Espace café d’un foyer de travailleurs de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Camille Millerand / Divergence pour « Le Monde »
Le 13 mai, l’ONG a écrit au président de la République, conjointement avec la CFDT, la CGT, la Cimade ou encore Emmaüs, pour demander la régularisation des personnes sans papiers comme mesure de justice et de reconnaissance. Les interpellations se multiplient en ce sens, en provenance d’associations, mais aussi de l’Eglise de France ou encore de députés de l’aile gauche macroniste.
Samedi 20 juin, des manifestations devaient avoir lieu dans plusieurs villes de France, à l’appel de la Marche des solidarités, un rassemblement de collectifs et de plus de deux cents organisations. Au ministère de l’intérieur, on considère qu’« il ne faut pas modifier les critères de régularisation » pour éviter un « effet d’attraction », mais on souhaite« porter une attention particulière aux personnes qui se sont exposées dans l’intérêt général pendant la crise ». Par exemple, sans régulariser davantage, mais en privilégiant les travailleurs plutôt que la régularisation pour motif familial.
• 12 heures

Rahim (prénom modifié), 28 ans, est agent de propreté dans le RER. Avant d’occuper cet emploi, il a été livreur pour les plates-formes Deliveroo, Stuart, UberEats et Globo. CAMILLE MILLERAND POUR « LE MONDE »
Aujourd’hui encore, Nesrine, une Algérienne âgée 27 ans, n’aura pas de pause déjeuner. Depuis 2018, elle travaille au noir comme caissière dans une enseigne de la grande distribution, à Paris. Elle pointe six jours sur sept, n’a pas de congés payés et touche moins d’un smic par mois. Pendant le confinement, elle est restée sur le pont. Elle a même livré des personnes âgées à leur domicile. « Au début, on n’avait pas de protection, se souvient-elle. Ça a duré une vingtaine de jours. Après, on avait des masques et des gants, mais on devait les garder pendant deux jours. »
Dans l’espoir d’être déclarée – et de constituer un dossier de régularisation –, la jeune femme a bien proposé au gérant du magasin de s’acquitter elle-même des charges sociales, mais il a refusé. Si sa situation n’évolue pas, Nesrine ne remplira pas les critères de la circulaire Valls.
Rahim (le prénom a été modifié) ne nourrit pas davantage d’espoir. Ce Tunisien de 29 ans n’est en France « que » depuis deux ans et n’a pas encore cumulé suffisamment de fiches de paie. Devant la difficulté de la tâche, il est parfois gagné par l’angoisse. Pourtant, tous les jours, dans le RER, il désinfecte et nettoie des poignées et des barres de maintien par centaines, pour éviter la propagation du Covid-19 dans les transports franciliens.
Rahim est arrivé en Europe en traversant la Méditerranée. Il avait échoué trois fois avant de réussir à gagner l’île italienne de Lampedusa. « La première fois, le bateau a coulé, et vingt-huit personnes sont mortes », se souvient-il. Le jeune homme a alors repris un temps son travail de veilleur de nuit dans une clinique de Zarzis, en Tunisie, payé 200 euros par mois, avant de retenter la traversée.
En France, les bons mois, il peut gagner jusqu’à 1 100 euros et envoyer un peu d’argent à ses parents. S’il réussit à économiser suffisamment, il voudrait s’acheter un scooter et reprendre, sur son temps libre, des vacations comme livreur pour UberEats ou Deliveroo. Rahim ne repartira pas. « Je veux faire ma vie en France, confie-t-il. Avoir un petit pavillon, une petite famille, aider mes parents. » Dans l’espoir d’une vie meilleure, pour soi et les siens, les parcours des migrants sans papiers sont bien souvent marqués du sceau de l’abnégation.
• 14 h 30

Sire (au premier plan) et Sara, tous deux sénégalais, sont plongeurs dans un restaurant gastronomique à Paris. CAMILLE MILLERAND POUR « LE MONDE »
Le déjeuner est terminé. Dans les cuisines du restaurant chic Baltard, au Louvre, dans le 1er arrondissement de Paris, le personnel peut lever le pied. Sire et Sara vont s’assoupir quelques heures dans un canapé, avant le service du soir, qui s’étale de 19 heures à 23 heures. Ces deux cousins sénégalais ont été embauchés il y a près de trois ans comme plongeurs dans l’établissement. Ils sont en cours de régularisation.
A leur prise de service, au sous-sol du restaurant, ils s’emploient à nettoyer les poubelles, à laver les tabliers et les torchons, à lessiver le sol et à faire briller les établis en acier chromé. Ce qu’ils préfèrent, c’est donner un coup de main en cuisine. « Je lave la salade, j’émince les oignons, je coupe les saint-jacques, je prépare le jus de volaille », énumère Sara, fièrement, tandis qu’à l’étage Sire épaule les commis pour la mise en place.
Le propriétaire du Baltard, Vincent Sitz, le dit sans ciller : « Dans mes restaurants, aucun Blanc ne fait la plonge, et je veux entendre un seul restaurant me dire qu’il n’a pas de travailleur étranger, je ne le croirai pas. »Le chef d’entreprise, qui est aussi président de la commission emploi, formation et qualité de vie au travail du Groupement national des indépendants, un syndicat de l’hôtellerie-restauration, est confronté depuis des années aux difficultés de recrutement dans son secteur. « On a 140 000 postes à pourvoir, et on forme 45 000 jeunes par an, sachant qu’au bout de cinq ans il en reste la moitié. C’est un métier dévalorisé, il faut travailler le soir, le week-end et les jours fériés. Comme ils n’ont pas les moyens de se loger à Paris, les jeunes ont peu de chances de rentrer chez eux en banlieue pendant la coupure du milieu de journée, ce qui fait qu’ils n’ont pas de vie privée. »
M. Sitz en est convaincu : « Il faut être honnête et régulariser ceux qui sont dans nos entreprises, qui se taisent, mais qui charbonnent. On sait qu’ils travaillent avec les papiers d’un autre et ce n’est pas gratuit. » Une parole rare dans le milieu patronal. « Il y a des secteurs très réfractaires à la régularisation, observe Mme Poulain. Des employeurs se servent des travailleurs migrants comme variable d’ajustement et profitent de leur vulnérabilité. »
« Il y a des situations d’abus, corrobore Catherine Rose Bengan-Durand, membre de l’association de défense des travailleurs migrants philippins Nagkakaisang Pilipino (« les Philippins unis en France »). La plupart des travailleurs philippins en France sont sans papiers et évoluent dans le nettoyage ou la garde d’enfants, dans une grande précarité. »
• 19 h 15
En général, si son employeur ne lui demande pas de faire un baby-sitting, Rosaline (le prénom a été modifié) a terminé sa journée de travail. Cette nounou philippine de 27 ans, qui s’occupe de trois enfants dans le 16e arrondissement de Paris, a le sentiment d’avoir enfin trouvé une situation stable.
Lors de son arrivée en France, en 2015, elle a travaillé pour une famille dans des conditions délétères pendant près de trois ans. « Je vivais chez eux, dans les Yvelines. Je m’occupais des enfants et je faisais le ménage, rapporte-t-elle. Mais je n’étais payée que 700 euros pour quarante à quarante-cinq heures par semaine, avec un seul jour de repos et jamais de vacances. »
Les employeurs actuels de Rosaline appuient sa démarche de régularisation, toujours en cours. « Au début, j’habitais à Saint-Cloud, mais je n’arrivais pas à obtenir de rendez-vous à la préfecture de Nanterre, alors j’ai déménagé à Paris. » Dans certains départements franciliens, les délais de prise de rendez-vous en préfecture pour une régularisation sont supérieurs à un an. Si Rosaline obtient des papiers, elle voudrait retourner aux Philippines voir son fils de 7 ans. Elle pense aussi à changer de métier. Elle aimerait travailler dans un hôtel.
• 20 heures

Minkoro Toure est agent de sécurité. Ivoirien, il vit en France depuis l’été 2014. Camille Millerand / Divergence pour « Le Monde »
Minkoro Toure passe la porte du foyer de travailleurs où il loge, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Cet Ivoirien de 38 ans est agent de sécurité et, pendant tout le confinement, il a veillé au respect des règles de distanciation dans un bureau de La Poste. « J’ai travaillé à fond, du lundi au samedi », dit-il. A terme, s’il obtient des papiers, Minkoro, titulaire d’un DUT en transit et transports, nourrit le projet de monter sa propre société d’import-export. Pour l’instant, il multiplie les missions de vigile, au Palais de Tokyo et dans des boutiques des Champs-Elysées, dans une parfumerie comme dans une enseigne de cosmétiques bio.
En France depuis près de six ans, Minkoro a écumé les squats, les hôtels sociaux, les gymnases, les collocations et autres foyers, et a déjà fait l’objet de deux OQTF. « C’est un pays où le stress ne manque pas », confie-t-il. Il raconte la dépendance aux autres, l’impossibilité d’ouvrir un compte courant ou de s’engager dans une relation amoureuse, compte tenu de sa situation. Il dit aussi l’assignation à résidence et qu’il n’a donc pas pu se rendre aux funérailles de son père, en Côte-d’Ivoire.
« Notre souhait, c’est d’avoir des papiers, de payer les impôts, bien s’intégrer, assure-t-il. Ce n’est pas de travailler au noir. L’Etat y perd et nous aussi. » Bénévole au Cedre, une antenne du Secours catholique spécialisée dans l’accompagnement des étrangers, Minkoro se souvient d’avoir assisté à une visite de députés dans les locaux de l’association. Il a réalisé que « certains ne savent pas la portée réelle des décisions qu’ils prennent ».
• 00 h 30

Abdoul (prénom modifié) et Diaguely vivent dans un foyer situé en Seine-Saint-Denis. Le premier est ripeur en intérim, le second est agent de nettoyage. Ils se connaissent depuis leur enfance. Tous les deux sont soninkés. Ils ont grandi dans un village au Mali. Camille Millerand / Divergence pour « Le Monde »
Le calme domine dans le foyer où vit Diaguely Traore, à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Après avoir dîné d’un sombi, une spécialité soninké faite de bouillie de maïs au lait caillé, le jeune homme de 35 ans part attraper un bus de nuit. Jusqu’à l’aube, il nettoie les cuisines d’un restaurant McDonald’s de la région parisienne. Diaguely Traore a obtenu, il y a moins de deux ans, un titre de séjour, après huit ans de vie en France. Il a « réussi » là où d’autres « galèrent » encore. « Tout le monde n’a pas la même chance », reconnaît-il.

M. Baradji prépare le sombi pour Diaguely, qui s’apprête à partir au travail. M. Baradji vit en France depuis 50 ans. C’est le plus ancien de l’étage du foyer, il organise la vie des plus jeunes arrivés recemment en France. Camille Millerand / Divergence pour « Le Monde »
La première chose qu’il a faite, quand il a été régularisé, c’est de rentrer voir sa femme et ses enfants au Mali. La vie est plus « facile » pour lui, désormais, même si, par certains aspects, elle continue de ressembler à celle de ceux qui demeurent dans les limbes du système. Diaguely cherche toujours un « projet ». Il aimerait monter des sociétés dans son pays, dans le bâtiment ou l’alimentation, faire travailler son frère et un cousin. Il dit en soupirant : « Il y a beaucoup de gens à aider. »
Les femmes évoquées dans le récit n’ont pas souhaité être photographiées.
Julia Pascual



 De nouvelles grilles sont en cours d’installation rue des Garennes, zone industrielle des Dunes.
De nouvelles grilles sont en cours d’installation rue des Garennes, zone industrielle des Dunes. Une vingtaine de migrants dorment contre la façade de Conforama, fermé depuis une semaine.Par conséquent, de nombreux migrants se sont résignés à se rapprocher du centre-ville de Calais, voire plus loin, comme Coquelles. En effet, depuis plusieurs semaines, « il y a effectivement de plus en plus de migrants dans le secteur », assure Olivier Desfachelles, directeur général des services à la ville de Coquelles. Chaque nuit, une vingtaine de migrants dort devant
Une vingtaine de migrants dorment contre la façade de Conforama, fermé depuis une semaine.Par conséquent, de nombreux migrants se sont résignés à se rapprocher du centre-ville de Calais, voire plus loin, comme Coquelles. En effet, depuis plusieurs semaines, « il y a effectivement de plus en plus de migrants dans le secteur », assure Olivier Desfachelles, directeur général des services à la ville de Coquelles. Chaque nuit, une vingtaine de migrants dort devant