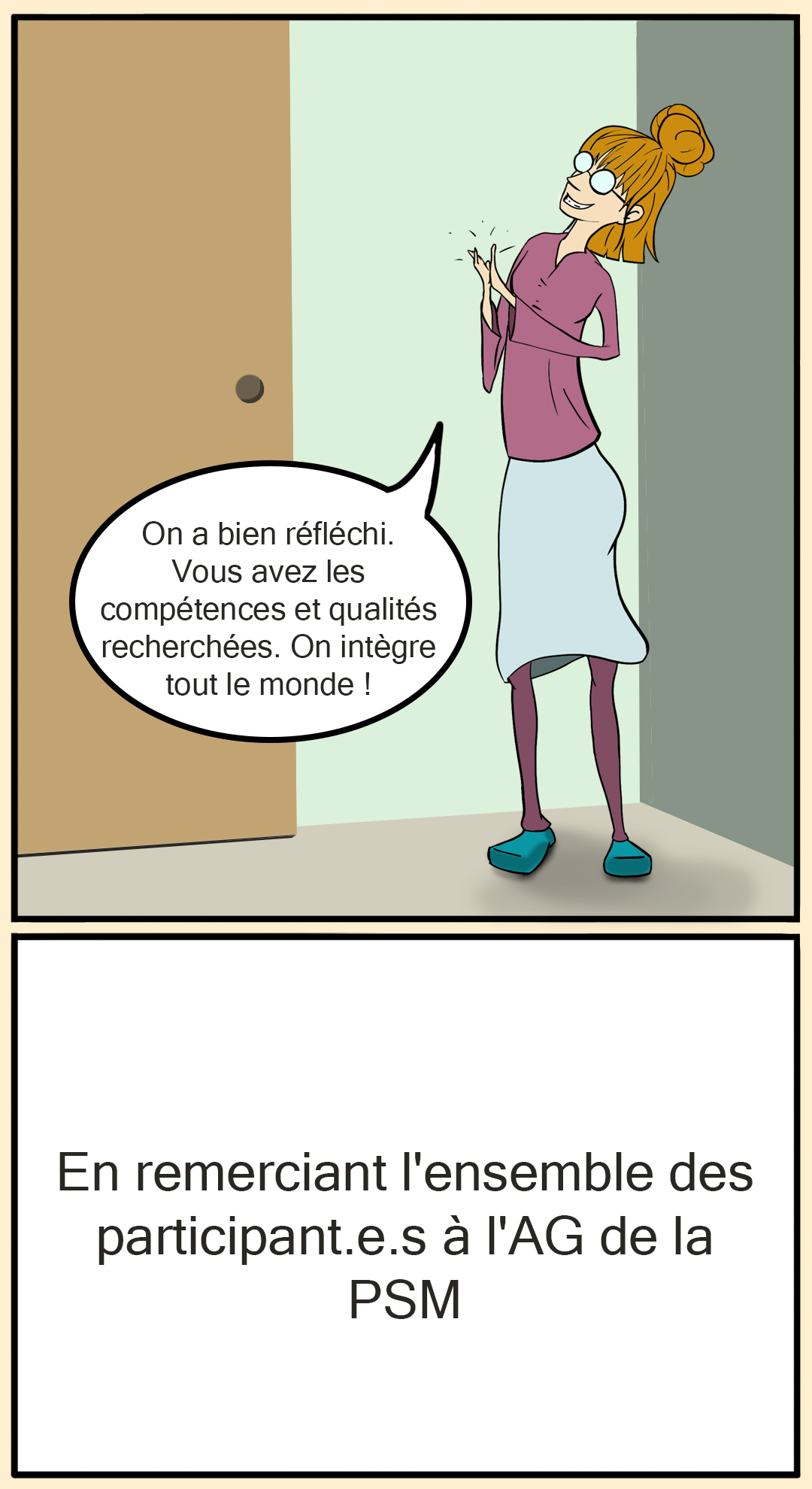En y repensant, Nourdine* peine encore à croire à ce que lui et d’autres jeunes ont vécu. « Non mais c’est tellement fou… », lâche-t-il en interrompant sa phrase et en détournant le regard, attablé dans un kebab au nord de Paris. À son arrivée en France il y a quelques années, il dormait non loin de là, dans l’un des campements de migrants installés sous les ponts, évacués depuis par les autorités. Après avoir été évalué et reconnu mineur, l’adolescent a été placé sous la protection de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et donc sorti de la rue.
« La plupart des gens ont peur d’elle, poursuit-il. Ce n’est pas quelqu’un de bon. » Celle qu’il accuse sans sourciller est Mme B., la responsable de la direction « enfance et jeunes majeurs » (DEJM) de l’association Le Lien, mandatée par les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine pour loger et prendre soin des mineurs non accompagnés (MNA dans le jargon) pris en charge par ces collectivités, à qui revient la protection de l’enfance.
Après plusieurs mois d’enquête, Mediapart a recueilli une dizaine de témoignages, tous concordants, de certains employés de la structure et de jeunes. Ces derniers dénoncent les « pressions psychologiques » et la maltraitance dont ils disent faire l’objet.
À chaque fois, la responsable est mise en cause. Sollicitée à plusieurs reprises, Mme B. n’a pas souhaité nous répondre. Face à ces accusations, la directrice générale de l’association souligne sa « bienveillance » et les remontées positives qu’elle a pu avoir la concernant, lui apportant ainsi son soutien (lire sa réponse complète dans l’onglet Prolonger).
« La façon dont elle nous parle à tous est rabaissante », jure Nourdine, évoquant des « insultes au quotidien » et des « paroles racistes ». « Elle nous disait par exemple : “Vous les Noirs, vous les Africains…” Elle disait aussi : “Vous n’êtes pas chez vous ici”, sous-entendu en France ou encore “Vous n’êtes pas des singes !” quand elle voyait qu’on n’avait pas rangé notre chambre. Ses propos sont terrifiants. »
Nourdine et plusieurs autres jeunes accusent également la responsable de leur « hurler » dessus. « Une fois, elle m’a crié dessus pour rien. Elle me disait que je n’étais pas chez moi ici [au foyer], et que j’allais foutre le camp. Je suis resté à la regarder dans les yeux, sans répondre, puis je suis reparti dans ma chambre. »
« Elle aime bien crier pour nous faire peur »
Chris*, un jeune originaire d’Afrique pris en charge dans les Hauts-de-Seine, décrit un comportement similaire. « Je l’ai déjà vue crier sur des gens comme si elle allait les frapper, témoigne-t-il. Elle humiliait un pote à moi à chaque fois qu’elle venait nous voir. Elle lui disait : “Ferme ta bouche, quand je parle tu n’as pas le droit de parler.” » Il affirme avoir été lui aussi « humilié » un jour, après avoir été convoqué dans le bureau de la directrice pour avoir fait une « bêtise ». « Mme B. me parlait, je répondais : “OK, j’ai compris”, et je baissais la tête. Elle me reprochait de ne pas la regarder et de ne pas sourire. Elle aime bien crier pour nous faire peur, alors elle s’est mise à me crier dessus. Elle m’a pris en photo avec son portable et m’a dit : “Regarde comme tu es moche quand tu ne souris pas.” »
Ce jour-là, la responsable du Lien serait allée plus loin selon lui, passant à un degré de violence plus élevé : « Elle a fini par se lever, m’a attrapé par la gorge avec ses deux mains et a commencé à me secouer la tête. Elle me disait que j’étais trop têtu et demandait pourquoi je ne voulais pas changer. J’ai interpellé sa collègue, qui était juste à côté, en criant “Regardez, elle m’étrangle devant vous !”, mais elle n’a rien dit ni rien fait. Tout le monde a peur d’elle », conclut-il, désabusé.
Chris n’est pas le seul à faire état de maltraitances au sein des hébergements gérés par l’association. « Une fois, elle était en colère contre un jeune. Elle était derrière lui et l’a attrapé par le cou [en enroulant son bras autour de son cou – ndlr] tout en lui criant dessus », complète Nourdine, en mimant le geste, l’air éberlué. « Les employés de l’hôtel sont intervenus pour lui dire d’arrêter. Même si le jeune avait fait quelque chose d’anormal, elle n’avait pas le droit de faire ça ! »
Kinza*, un autre MNA passé par différents hôtels gérés par Le Lien, prétend lui aussi avoir vécu cela. Selon lui, la responsable serait devenue « plus dure » envers eux durant le confinement : « Elle nous criait dessus, elle nous parlait mal et tenait des propos racistes et violents. Une fois, alors qu’elle nous avait réunis pour nous parler, j’ai posé une question et ça ne lui a pas plu. Elle m’a dit qu’elle allait m’apprendre le respect. Elle a mis sa main droite sur mon cou, elle a serré un peu et m’a repoussé vers l’arrière. Je n’ai rien pu faire, je me suis juste défendu en répétant que je n’avais rien fait… Après ça, je me taisais et restais dans mon coin, je ne voulais plus de problèmes », relate celui qui a depuis été renvoyé du Lien et qui vit actuellement « à la rue ».
Humiliations, propos « racistes » et gestes violents
Une scène similaire à celle à laquelle a assisté Adra, une ancienne employée d’un hôtel situé à Saint-Cyr où des MNA sont placés par le Lien. « J’ai vu Mme B. attraper un jeune par le col de son tee-shirt et essayer de le soulever. Il a fallu qu’on intervienne pour qu’elle arrête… Lui la regardait sans rien oser dire. » Sans papiers à l’époque, la quadragénaire affirme avoir été exploitée par le gérant de l’établissement, qu’elle poursuit aujourd’hui aux prud’hommes avec quatre autres personnes, toutes employées sans être déclarées.
Dans son appartement situé en banlieue parisienne, sous le regard de ses deux filles, Adra sort un épais dossier, constitué avec l’aide de son avocat, réunissant les preuves de ce qu’elle avance. Photos, certificats médicaux, virements bancaires… « Je ne vais pas le lâcher. J’ai perdu 57 kilos à cause de lui, sans compter mes problèmes de dos à force de tout porter à l’hôtel. »
Embauchée initialement pour gérer la réception et de l’administratif, Adra se retrouve vite à faire le ménage, l’entretien de l’hôtel, la vaisselle et la lessive des jeunes. « Je devais aussi leur donner des médicaments alors que je ne voulais pas porter cette responsabilité. Je commençais tôt le matin jusqu’au soir. Tout ça pour 700 euros par mois. » À ses yeux, Mme B. aurait été aussi responsable que le gérant de l’hôtel : « Elle savait que j’étais exploitée et que je travaillais indirectement pour Le Lien, puisque je faisais tout pour les jeunes. Elle m’a fait croire qu’elle allait m’aider pour que je continue de travailler. Elle m’a manipulée et n’a rien fait. »
Adra revoit la responsable « tirer les cheveux d’un jeune » en lui demandant de les couper ou en menacer un autre de « lui enlever les yeux » en positionnant ses deux doigts devant ses orbites. « Elle aime les impressionner », résume-t-elle, avant d’ajouter que les jeunes subissent un « harcèlement moral important » là-bas.
« En fait, elle n’est pas là dans l’intérêt des enfants », juge Adra, qui se remémore également des propos « racistes » dans la bouche de la responsable. « Elle n’aime pas les Noirs. Elle leur disait d’oublier leurs traditions, d’oublier tout ce qui venait de chez eux. Elle leur disait : “Il y a des toilettes ici, ce n’est pas le bled.” » D’après elle, la responsable reprochait aussi aux ados de ne pas porter de sous-vêtements. « Elle a rabaissé un jeune devant moi et lui a demandé, en tirant sur son jogging au niveau de la taille, s’il avait mis un caleçon. Puis elle s’est tournée vers moi pour me dire : “Tu sais en Afrique, ils ne portent pas de caleçon” », raconte-t-elle.
Ce même jeune, traumatisé par l’exil, aurait également été humilié car souffrant d’énurésie. « Elle lui disait, devant les autres, que ça puait et qu’il devait aller se laver. » À l’été 2020, Adra a alerté à deux reprises la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) par mail pour dénoncer ses conditions de travail mais aussi le comportement de Mme B. à son égard, concluant le message en implorant de ne pas « laisser les enfants mineurs entre les mains de personnes qui ne respectent pas la loi » et leur « donnent une mauvaise éducation ». Des mails restés sans réponse.
Deux des jeunes qui se sont confiés à Mediapart assurent par ailleurs avoir constaté une retenue sur l’aide financière qui leur est versée à la fin du mois. On leur aurait répondu qu’il s’agissait d’une « punition » pour des « bêtises » qu’ils avaient pu faire. Une pratique inscrite dans le règlement selon plusieurs éducateurs interrogés.
Plusieurs alertes au CSE
Au siège du Lien, plusieurs employés ont tenté de tirer la sonnette d’alarme. C’est le cas de Julien*, éducateur spécialisé, licencié en mai 2021 pour « propos calomnieux ». « J’ai dénoncé les faits de violence, appuyé par l’une de mes collègues qui a adressé un courrier au CSE [comité social et économique – ndlr]. Il y a eu plusieurs remontées faites au CSE, rien n’a été fait pour arranger la situation. Et de ce que je sais, aucun de mes collègues éducateurs n’a été interrogé », assure-t-il.
Selon plusieurs travailleurs sociaux, deux jeunes concernés par les faits de violence auraient été convoqués par la directrice générale du Lien… en présence de Mme B. Ces derniers auraient nié les faits par peur de représailles. « Une réunion d’équipe a suivi, Mme B. a demandé qui avait témoigné auprès du CSE, précisant que les personnes qui n’étaient pas d’accord avec ses façons de faire avaient la possibilité de ne plus travailler ici. Julien s’est fait renvoyer une semaine plus tard », témoigne Ines*, éducatrice au Lien.
Par souci de transparence, Julien précise qu’avant d’être licencié, lui-même a rencontré un problème avec un jeune, qui a tenté de descendre de voiture sur le périphérique parisien alors que le véhicule était en mouvement. « Je l’ai retenu, j’ai fermé la porte et lui ai remis la ceinture. J’ai eu peur pour sa vie et pour la mienne, je lui ai tiré l’oreille. Le jeune a été convoqué et recadré par Mme B., qui m’a par la suite rappelé que je n’aurais pas dû faire ça, sans s’en indigner outre mesure. Quelques semaines plus tard, après que j’ai alerté la direction sur les faits de maltraitance, Mme B. m’a ressorti cette histoire. Je lui ai rappelé qu’elle s’en prenait elle-même physiquement aux ados, ce qu’elle n’a pas nié », détaille Julien, qui affirme avoir vu la responsable mettre une tape sur la main des jeunes, les attraper par le menton ou leur tirer les cheveux.
Ines assure, elle aussi, avoir été témoin de maltraitances physiques et verbales. « Ça dure depuis des années. En entretien, elle demande au jeune de lui tendre la main et lui met une tape, elle prend fermement les plus jeunes par le menton et leur secoue la tête. Une fois, elle a tiré les cheveux d’un jeune qui avait des dreads, en disant :“C’est quoi cette coiffure ? T’as une coiffure de fille.” » Et de compléter : « Elle leur dit aussi des choses inutiles, qui les font se sentir mal, comme “tu sers à rien”, “tu vas rien faire de ta vie” ou “tu as un problème avec moi parce que je suis une femme blanche”. » « À moi, elle disait qu’on n’était pas en Afrique ici, avec les hommes qui commandent les femmes. Ça m’énervait car c’est de la discrimination », complète Chris, le jeune déjà cité.
Océane*, une autre éducatrice, a alerté le CSE de deux faits, dont elle garde un souvenir précis, dans un document que Mediapart a pu consulter. « Une fois, je l’ai vue tirer les cheveux à un jeune au point que sa tête tombe vers l’avant. Je ne pense pas qu’il ait eu mal, mais il y avait un côté tyran, à vouloir montrer sa force. C’était dégradant et j’ai vu le visage du jeune se fermer, il était au bord des larmes. Une autre fois, elle a hurlé sur un jeune devant tout le monde pendant un long moment, jusqu’à ce que ça s’apaise. Elle est ensuite revenue à la charge, puis a prononcé une phrase qui m’a choquée : “Un jour, tu te mettras à genoux devant moi pour me remercier de ce que j’ai fait pour toi.” Le môme n’a pas bronché, il y avait au moins vingt autres jeunes dans la salle. Certains étaient sidérés, d’autres continuaient à faire leur vie. Ils n’ont pas le choix, ils savent ce qu’il se passe si Mme B. décide de les virer. »
Selon plusieurs professionnels présents lors de la réunion d’équipe, la direction aurait défendu une « stratégie de théâtralisation ». « On nous a dit que c’était une approche expérimentale. Je vis très mal ce qui arrive aux jeunes, parce que notre mission première est de les protéger. Mais il y a un tel climat de peur que lorsqu’on voit des actes maltraitants, il y a de la sidération, on ferme les yeux de peur de subir le courroux de la direction », explique Greg*, un autre travailleur social de la structure, qui confirme des faits de maltraitance verbale et physique sur les MNA.
Il ajoute qu’une enquête interne aurait été déclenchée par le CSE, mais serait « biaisée » : « La présidente du CSE [directrice générale du Lien – ndlr] est très amie avec Mme B. Elle cautionne tous ses agissements. Tout fonctionne à l’affect dans cette structure », dénonce-t-il.
Contactés, les représentants du personnel affirment que depuis son élection fin 2018, le CSE a « toujours rempli son rôle de dialogue social auprès de l’ensemble des salariés du Lien, en faisant remonter systématiquement auprès de la directrice générale les problèmes ou questions soulevées par les salariés » – sans confirmer si une enquête a bien été diligentée – et nous renvoient vers la direction générale « compte tenu du devoir de confidentialité vis-à-vis des salariés ».
La directrice générale du Lien, Christine Baudère, nie quant à elle l’ouverture d’une quelconque enquête. Elle ne pouvait cependant ignorer les accusations portées à l’égard de la responsable de la DEJM : le procès-verbal d’une réunion du CSE datant du 9 avril 2021, signé de sa main, fait état de salariés ayant « fait remonter leurs interrogations quant à certaines pratiques qui auraient été constatées au sein de la DEJM ». L’employeur y vante le travail réalisé par la DEJM – son « professionnalisme » ou sa « bienveillance » – avant d’insister « pour que de tels propos non fondés, graves et inutilement injurieux cessent immédiatement ».
« Il n’y a pas un mois qui passe sans qu’un collègue démissionne »
Sollicitée par Mediapart à plusieurs reprises, la responsable de la DEJM n’a pas répondu à nos questions. La directrice générale du Lien a tenu à rappeler, dans un exposé général sans réponse aux points précis sur lesquels nous l’avons interpellée, que l’association place « au-dessus de tout l’intérêt de ces adolescents, demandant à [leurs] collaborateurs travaillant auprès d’eux un réel engagement, le respect d’un cadre de travail exigeant s’exerçant dans le contexte de la Protection de l’enfance ». Une mission « à forte charge émotionnelle, avec la nécessité de couvrir tous les besoins des jeunes qui sont isolés sans parents, dans une prise en charge 24/24h et sur 365 jours de l’année ».
« La directrice de l’Enfance, mise en cause, a forgé son expérience auprès des familles relogées dans les débuts du Lien, ajoute-t-elle. Certaines d’entre elles exprimaient leur reconnaissance du soutien attentif qu’elle leur portait soulignant sa bienveillance. De la même façon, […] je suis souvent frappée de la façon spontanée dont [de nombreux adolescents] parlent d’elle comme d’un repère sécurisant et avec un profond respect ».
Sollicité par Mediapart, le département des Yvelines n’a pas répondu à l’heure où nous publions cet article. Celui des Hauts-de-Seine indique qu’il « n’a pas été informé à ce stade d’une enquête interne » et qu’il a été « demandé à l’association de [lui] communiquer l’ensemble des éléments lorsque celle-ci sera finalisée ».
Dans son rapport 2020 établi dans le cadre de la mission de contrôle de l’ASE des Hauts-de-Seine, l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) mentionne Le Lien sans faire état du mal-être des jeunes, précisant que les « conditions matérielles, éducatives et sanitaires sont apparues très positives ».
L’inspection du travail aurait par ailleurs visité la structure à la fin juin 2021. Plusieurs employés, anciennement ou actuellement en poste au Lien, dénoncent aussi un climat de « terreur » pour le personnel, se disant victimes de « pressions psychologiques » au quotidien, avec des cas de burn-out et des arrêts maladie répétés, conduisant certains à partir.
« Il n’y a pas un mois qui passe sans qu’un nouveau collègue démissionne, souvent à cause du fonctionnement de la DEJM. La directrice a un rapport à une toute-puissance, des conduites arbitraires, des réactions qui font que les collègues se murent, se terrent et sont terrorisés face à elle », indique une professionnelle de santé employée au Lien, ajoutant que « beaucoup de personnes sont en souffrance » au sein de la structure.
Pour elle, les remontées faites au CSE ont été, au moment de la réunion, « tout simplement annulées ». « C’est une aberration totale : il n’y a pas eu d’écoute, pas d’instance pour protéger les employés. Comment agir pour la dignité des jeunes si nous ne sommes pas nous-mêmes considérés ? Les personnes sont isolées et chacun tient comme il peut. »
« C’est un tyran, tranche Ines, l’éducatrice, à propos de la responsable de la DEJM. À deux reprises, elle a hurlé sur des collègues en réunion devant tout le monde alors que ce n’était pas justifié. Elle en a fait pleurer une, puis lui a dit : “Tu vois, t’es pas capable de parler sans pleurer.” Elle lui avait même dit qu’elle n’était pas faite pour être éducatrice. Une bonne partie du personnel (éducateurs, référents santé, techniciens, assistants administratifs, cadres) s’en est pris plein la tronche au moins une fois en réunion. » Et Greg d’ajouter : « Mme B. exerce des pressions psychologiques sur les collaborateurs, elle aime avoir de l’emprise sur eux. J’ai vu des salariés sortir en larmes de son bureau. »
La direction défend la « bienveillance » de la responsable mise en cause
Cathy*, une ancienne employée partie « à cause de ce climat », évoque un « management par la peur ». « J’ai dénoncé le harcèlement dont ma collègue et moi faisions l’objet. Tout a été étouffé, j’ai laissé des traces au niveau de la médecine du travail. »
« Il faut rentrer dans son moule, poursuit Ines. Si elle n’aime pas notre personnalité, elle fait presque tout pour qu’on parte. » Océane parle elle aussi de « tyrannie » et évoque une ambiance « pesante ». « On a la pression quand elle est là. Par des phrases cinglantes ou un simple regard, elle peut imposer quelque chose de très particulier. Elle prend un malin plaisir à faire taire quelqu’un, les employés comme les jeunes, devant l’ensemble d’un groupe. Beaucoup de gens se taisent parce qu’ils ont peur. »
La directrice générale de l’association, qui rappelle que sa « porte est toujours ouverte pour d’éventuelles demandes de médiation ou d’arbitrage », estime que les équipes ont « accompagné l’évolution du Lien au fil des années, de façon très stable ». « Beaucoup de salariés au Lien ont entre dix et vingt ans d’ancienneté, ce qui est rare dans le contexte du travail aujourd’hui. Les valeurs qui ont été au cœur de notre création sont notre ADN et nous y sommes tous très attachés. Le management exercé s’inspire de ces valeurs », assure Christine Baudère.
Nourdine, l’un des MNA, prêt à « porter plainte contre Mme B. », a tenté de se rassembler avec d’autres jeunes. En vain. « Quand on a parlé de mener une action collective, certains camarades se sont défilés. J’ai laissé tomber la plainte car il n’y avait pas assez de gens décidés. » « Je connais des jeunes qui ont voulu la dénoncer, abonde Chris. Moi-même, je lui avais dit qu’elle nous faisait souffrir et elle avait répondu qu’on était comme ses enfants. Mais ma mère ne m’aurait jamais fait souffrir comme ça ! » De son côté, Kinza affirme lui aussi avoir été perdu face à une telle situation : « Où aller se plaindre, comment faire ? Les autres jeunes me disaient que c’était elle la cheffe et que si je me plaignais, j’aurais des problèmes. »
« Je ne veux pas que d’autres jeunes subissent la même chose »
Plus nuancée, la professionnelle de santé déjà citée souligne un « vrai paradoxe » dans la vie de l’association : « Quelques jeunes se sont confiés sur des violences verbales et psychologiques, d’autres se disent contents de la prise en charge, parce qu’ils ont connu la rue, la traversée en mer, la prison ou la Libye, et ne réagissent pas forcément à la violence qu’ils peuvent retrouver ici. Du côté des employés, on voit qu’il y a des dysfonctionnements et des choses inadaptées, mais on est tous passionnés et on tient comme ça, les équipes arrivent malgré tout à travailler et la plupart des jeunes s’en sortent. Il y a aussi des choses positives au sein de la DEJM, et les méfaits sont tolérés parce que ça semble fonctionner », observe-t-elle, relevant « l’implication » de la responsable du service, qui ne se rend peut-être pas compte, à ses yeux, « de la violence que représente sa stratégie de “théâtralisation” ».
Contactés par Mediapart, plusieurs autres MNA pris en charge par Le Lien ont préféré garder le silence, sans nier les faits de violence reprochés à Mme B. « Une dizaine de jeunes m’avaient confié avoir des choses à dénoncer, mais ils sont régulièrement menacés d’être remis à la rue, et Le Lien a tous les moyens de trouver un argument pour le faire », assure Cathy, l’ex-employée. « Je veux que ça s’arrête. On ne vient pas ici [en France] pour faire du mal ou tuer des gens, alors quand on cherche à s’intégrer, il faut qu’on nous aide un minimum. Je ne veux pas que d’autres jeunes subissent la même chose », clame Nourdine.
« Dommage », aux yeux d’Océane, que l’image de la structure soit ainsi entachée malgré les efforts fournis par le personnel. « Il y a des professionnels expérimentés, bienveillants, impliqués dans leur travail, mais aussi des infrastructures très intéressantes, comme des appartements en autonomie, qui permettent aux jeunes de s’inscrire dans différents projets de vie adaptés. Il faut que Le Lien et les équipes compétentes puissent continuer de travailler, mais que les agissements de la direction changent », conclut l’éducatrice. Un sentiment partagé par Greg, qui maintient que l’association « doit poursuivre son activité », mais « dans de meilleures conditions ».

:quality(70):focal(2122x1049:2132x1059)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/KEW5ZDCXW5FZZLF2IOQZQV4WNY.jpg)