Ellen Salvi, 1 mars 2022
« L’hypocrisie, toujours la même. » Cédric Herrou n’a pas caché son écœurement en découvrant le message posté, samedi dernier, par le maire de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes) en solidarité avec la population ukrainienne. « Le même maire qui a fait sa campagne électorale contre l’accueil que nous avions fait pour d’autres populations victimes de guerres. Seule différence, ces populations étaient noires », a réagi l’agriculteur, l’un des symboles de l’aide aux migrants, grâce auquel la valeur constitutionnelle du principe de fraternité a été consacrée en 2018.
Un principe qui se rappelle depuis quelques jours au souvenir de nombreuses personnes qui semblaient l’avoir oublié, trop occupées qu’elles étaient à se faire une place dans un débat public gangréné par le racisme et la xénophobie. Il y a deux semaines, lorsque la guerre russe était un spectre lointain et que la campagne présidentielle s’accrochait aux seules antiennes d’extrême droite, rares étaient celles à souligner que la solidarité n’est pas une insulte et qu’elle ne constitue aucun danger.

Des réfugié·es ukrainien·nes attendent de monter dans un bus au point de contrôle de la frontière moldo-ukrainienne près de Palanca, le 1er mars 2022.Les mêmes qui jonglaient avec les fantasmes du « grand remplacement » et agitaient les questions migratoires au rythme des peurs françaises expliquent aujourd’hui que l’accueil des réfugiés ukrainiens en France est un principe qui ne se discute pas. À l’exception d’Éric Zemmour, dont la nature profonde – au sens caverneux du terme – ne fait plus aucun mystère, la plupart des candidat·es à la présidentielle se sont prononcé·es en faveur de cet accueil, à quelques nuances près sur ses conditions.
Mais parce que le climat politique ne serait pas le même sans ce petit relent nauséabond qui empoisonne toute discussion, des responsables politiques et des éditorialistes se sont fourvoyés dans des explications consternantes, distinguant les réfugiés de l’Est de ceux qui viennent du Sud et du Moyen-Orient. Ceux auxquels ils arrivent à s’identifier et les autres. Ceux qui méritent d’être aidés et les autres. Les bons et les mauvais réfugiés, en somme.
Ainsi a-t-on entendu un éditorialiste de BFMTV expliquer que cette fois-ci, « il y a un geste humanitaire immédiat, évident […] parce que ce sont des Européens de culture » et qu’« on est avec une population qui est très proche, très voisine », quand un autre soulignait qu’« on ne parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien [mais] d’Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essaient de sauver leur vie, quoi ! »
C’est pas du racisme, c’est la loi de la proximité.
Olivier Truchot, présentateur des « Grandes Gueules »Dès le 25 février, sur Europe 1, le député MoDem Jean-Louis Bourlanges, qui n’occupe rien de moins que la présidence de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, avait quant à lui indiqué qu’il fallait « prévoir un flux migratoire ». Mais attention : « ce sera sans doute une immigration de grande qualité », avait-il pris soin de préciser, évoquant « des intellectuels, et pas seulement ». Bref, « une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit ».
Ces propos ont suscité de vives réactions que l’éditorialiste de BFMTV et l’élu centriste ont balayées avec la mauvaise foi des faux crédules mais vrais politiciens, le premier les renvoyant à « la gauche “wokiste” » – un désormais classique du genre –, le deuxième à « l’extrême gauche » – plus classique encore, éculé même. « Il faut avoir un esprit particulièrement tordu pour y voir une offense à l’égard de quiconque », a ajouté Jean-Louis Bourlanges, aux confins du « on ne peut plus rien dire ».
C’est vrai enfin, s’indignerait-on aux « grandes Gueules », « c’est pas du racisme, c’est la loi de la proximité ». D’ailleurs, le même type de commentaire a fleuri dans des médias étrangers, tels CBS News, Al Jazzeera, la BBC ou The télégraph, comme autant de « sous-entendus orientalistes et racistes » condamnés par l’Association des journalistes arabes et du Moyen-Orient (Ameja). Preuve, s’il en fallait, que le racisme – pardon, « la loi de proximité » – n’est pas une exception française. Des initiatives qui tranchent singulièrement avec les politiques à l’œuvre depuis des années.
Suivant la directive d’Emmanuel Macron qui a confirmé que « la France prendra sa part » dans l’accueil des réfugiés ukrainiens, le gouvernement multiplie lui aussi les communications depuis quelques jours, le plus souvent par la voix du ministre de l’intérieur. Ces réfugiés sont « sont les bienvenus en France »a ainsi déclaré Gérald Darmanin lundi, avant d’appeler « tous les élus […] à mettre en place un dispositif d’accueil » et à « remonter, les associations, les lieux d’hébergement au préfet ».
Dans le même élan de solidarité, la SNCF a annoncé que les réfugiés ukrainiens pourraient désormais « circuler gratuitement en France à bord des TGV et Intercités ». « Belle initiative de la SNCF mais je rêve d’une solidarité internationale étendue à TOUS les réfugiés, qu’ils fuient la guerre en Ukraine ou des conflits armés en Afrique ou encore au Moyen-Orient. Les réfugiés ont été et sont encore trop souvent refoulés et maltraités », a réagi la présidente d’Amnesty International France, Cécile Coudriou
Car au risque de sombrer dans le « wokisme » – ça ne veut rien dire, mais c’est le propre des appellations fourre-tout –, on ne peut s’empêcher de noter que ces initiatives, plus que nécessaires, tranchent singulièrement avec les politiques à l’œuvre depuis des années au détriment des exilé·es : l’absence de dispositif d’accueil digne de ce nom ; le harcèlement quasi quotidien de la part des forces de l’ordre, qui lacèrent des tentes, s’emparent des quelques biens, empêchent les distributions de nourriture ; le renforcement permanent des mesures répressives…
Or comme l’écrivait récemment la sociologue et écrivaine Kaoutar Harchi, « un accueil digne, une aide sans condition, un accès immédiat à des repas, à des soins, à des logements, un soutien psychologique, devraient être accordés à toute personne qui est en France et qui souffre. Mais c’est sans compter le racisme qui distribue l’humanité et l’inhumanité ». C’est bien lui qui se profile aujourd’hui derrière la solidarité retrouvée de certain·es.
Le 16 août 2021, alors que les images d’Afghans s’accrochant au fuselage d’avions pour fuir l’avancée des talibans faisaient le tour du monde, Emmanuel Macron déclarait : « L’Afghanistan aura aussi besoin dans les temps qui viennent de ses forces vives et l’Europe ne peut pas à elle seule assumer les conséquences de la situation actuelle. Nous devons anticiper et nous protéger contre les flux migratoires irréguliers importants. » Imagine-t-on cette phrase prononcée dans le contexte actuel ? La réponse est évidemment non. Et son corollaire fait honte.

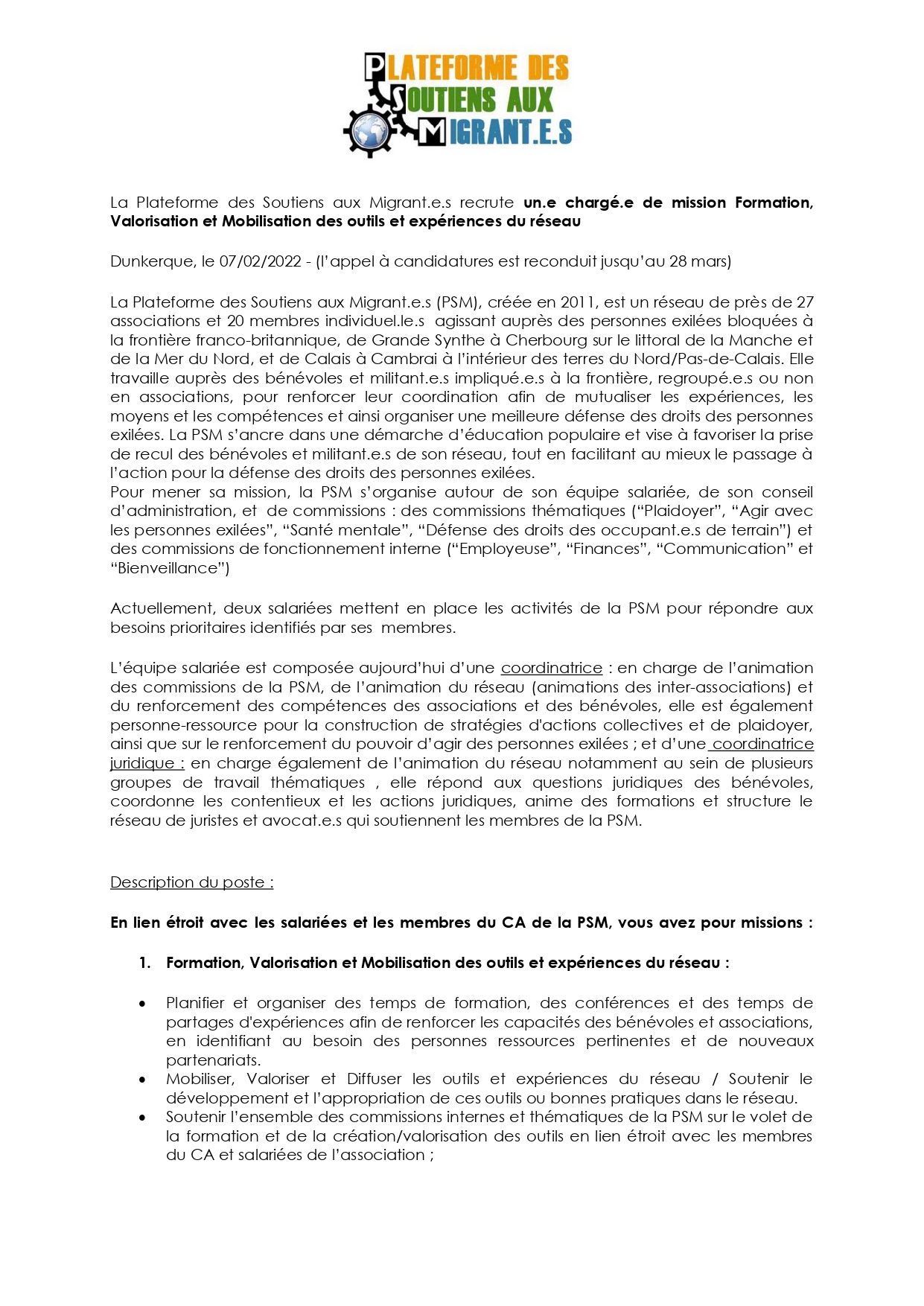
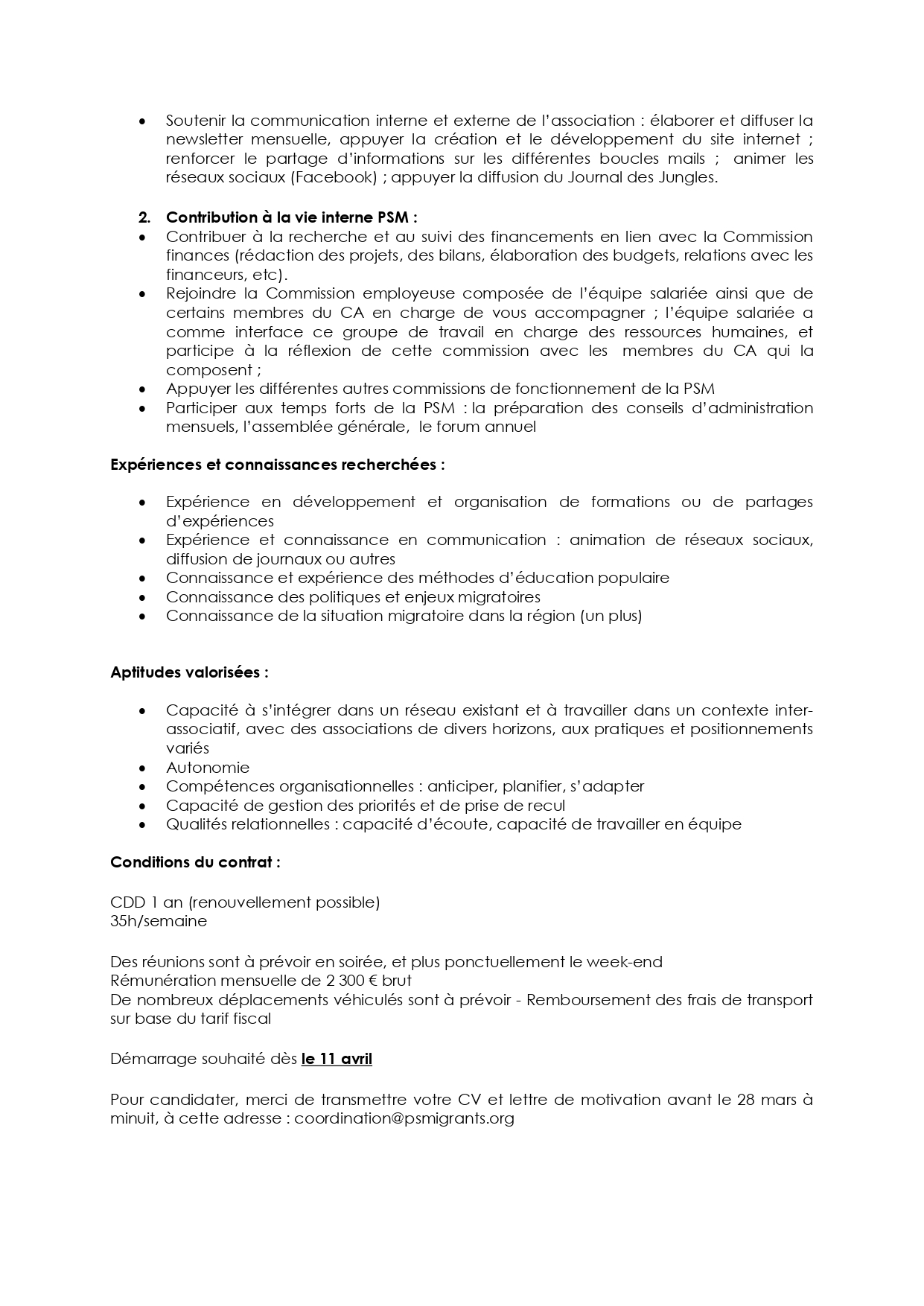
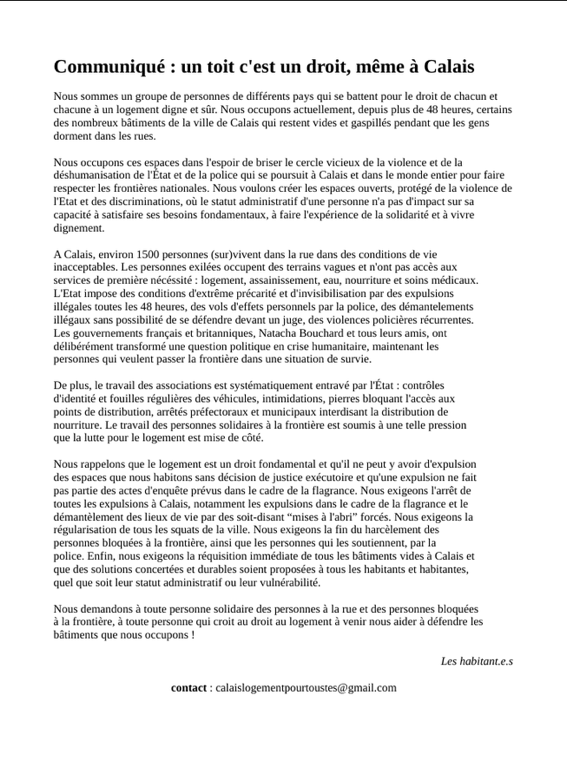


:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/I423S7RPTBFHPMETS22Q6BWRXU.jpg)

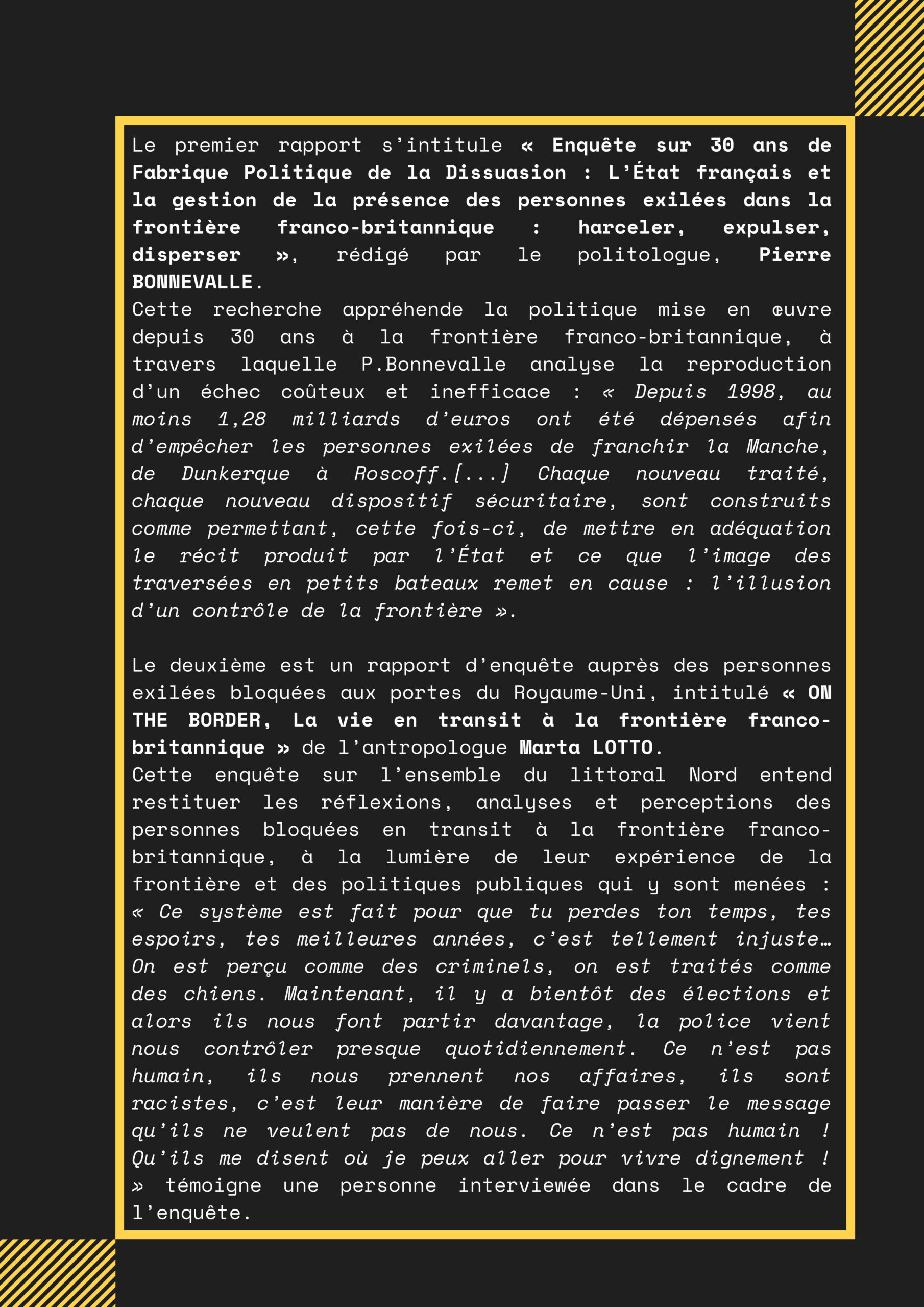
 LAURENCE GEAI POUR « LE MONDE »
LAURENCE GEAI POUR « LE MONDE »