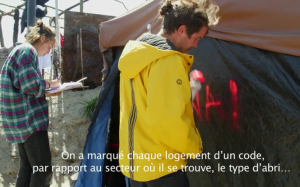Migrant.e.s économiques ou réfugié.e.s politiques
Faut-il trier les indésirables ?
Conférence-débat avec Karen Akoka
Organisée par la PSM, à Grande-Synthe, le 27 Janvier 2017
Compte-rendu par Martine Devries
La réponse était non, bien sûr, et Karen Akoka a développé ses arguments de manière convaincante, vivante et humoristique. Ces arguments venaient de son travail de chercheuse, car le sujet de sa thèse de science politique était : « La fabrique du réfugié à l’OFPRA ». Travail entrepris à la suite d’une expérience en tant qu’agente du Haut-Commissariat aux Réfugiés, expérience qui l’avait mise devant des contradictions insupportables.
La distinction entre réfugié.e et migrant.e est structurante pour l’administration, et elle l’est devenue également pour l’opinion publique.
Dans cette optique, les réfugié.e.s serait « obligé.e.s » de fuir leur pays, pour des raisons politiques, et la France, ayant signé la convention de Genève, serait « obligée » de leur accorder le droit d’asile, sans considération politique. Et, toujours dans cette optique, les migrant.e.s « économiques » auraient choisi de partir, et la France aurait le choix de les accepter ou non, pour des raisons politiques. Il y a déjà un paradoxe.
Le travail de l’agent.e de l’OFPRA, — décider d’accorder ou non l’asile –, est figuré comme s’il y avait une essence qui caractérisait à coup sûr la personne réfugiée, comme si il y avait une vérité à découvrir. Comme si dans le monde, les choses étaient noires ou blanches, et jamais grises, ne parlons pas de couleur !
Cela pose deux questions :
-Est-ce possible de trier ? Est-ce que on en connaît assez sur la vie, sur les conditions de cette vie dans les pays d’origine ? Est-ce qu’on peut se rendre compte…pour juger?
-Est-ce que c’est juste de protéger les un.e.s et de renvoyer les autres ?
Quand la question de la vérité ne se pose plus, cette question-là surgit, et elle est très gênante. Serait-il légitime de sauver les personnes de la guerre et de laisser mourir de faim les autres, après un séisme, par exemple, ou l’accaparement de leur terre ?
Voyons la question avec l’éclairage de l’Histoire. Celle-ci nous apprend que ces questions n’ont pas été traitées de la même manière au cours du temps. C’est une manière de questionner ce qui est accepté aujourd’hui, comme une évidence.
Le choix des définitions :
La définition de la personne réfugiée a subi des changements, et à chaque fois, cela correspondait à une utilisation politique. Il faut également être attentif à celles et ceux qui n’étaient pas considéré.e.s comme réfugié.e.s, et qui obtenaient néanmoins un titre de séjour.
Le terme « réfugié.e » au XVIème et XVIIème siècle est admis pour les protestant.e.s, de manière à les valoriser, car ces personnes fuyaient les persécutions religieuses. Des populations juives et arabes fuyaient aussi des persécutions, mais elles n’ont pas été qualifiées du même terme.
Au XXème siècle, « les russes », en tant que groupe, sont accepté.e.s comme réfugié.e.s. Car ce groupe fuit les persécutions du communisme. Nul besoin d’être persécuté.e personnellement, il suffit de faire partie du groupe. Dans la même période, les « espagnol.e.s » et les « portugais.es » qui fuient les régimes fascistes de Franco et de Salazar ne sont pas étiqueté.e.s réfugié.e.s. Car la France maintient des relations avec ces régimes, et ces groupes sont accueillis comme « émigrés ». A cause du terme « persécution » qui figure dans la convention de Genève, admettre quelqu’un.e à ce titre comporte un enjeu politique : la critique du régime du pays que ces personnes fuient.
En 1951, il y a dans le monde deux blocs : le Bloc socialiste et l’Occident. Il y aurait deux motifs envisageables pour accorder l’asile : au titre du droit socio-économique, pour les victimes d’inégalités. Ou au titre de victime de violences, pour défendre les libertés politiques. C’est le second qui a été choisi, donnant plus d’importance aux droits civiques qu’aux droits socio-économiques, et également plus d’importance aux droits de l’individu qu’aux droits collectifs. Si le choix avait été différent, ce serait maintenant la personne qui fuit la faim et la misère qui serait le « bon » réfugié, et celle en dissidence politique qui serait à renvoyer.
Comment sont appliquées les définitions au fil du temps ?
Entre 1950 et 1970, on parle de « candidat.e.s », et non de « demandeuses ou demandeurs d’asile ». Les personnes venant de pays sous domination communiste et candidates à l’asile étaient la preuve vivante de la décrédibilisation du régime communiste, et c’était une période de plein emploi. Elles étaient acceptées sans difficulté. En 1956, lors du soulèvement de Budapest, c’est un accueil enthousiaste et spectaculaire qui est fait aux personnes venant de Hongrie. Le gouvernement français de l’époque était farouchement anti-communiste. Et cet événement, très médiatisé, permettait aussi de ne pas voir le désastre ridicule de Panama, enjeu politique évident pour le régime.
A l’arrivée des « boat-people » venant du Viet-Nam, du Laos, et de Birmanie, pays de régime communiste, les personnes ont été reconnues comme réfugiées, sans entretien individuel. Les CADA ont été créés à cette période. L’accord était quasi automatique, et les archives montrent que celles et ceux qui ont été accueilli.e.s en France l’ont été sur des critères d’adaptabilité : maîtrise de la langue, qualification, services rendus à la France ; et pas sur des critères de persécution.
L’immigration « de travail » avait été suspendue en France en 1973. Elle avait été alimentée essentiellement par des gens venant du Maghreb. Ces travailleuses et travailleurs, progressivement, étaient devenu.e.s une main d’œuvre moins docile, plus sensible aux syndicats. Il restait des besoins de main d’œuvre. Ils ont été remplis par ces « boat people », réputé.e.s plus dociles, et venu.e.s à titre de réfugié.e.s. Pourquoi ? Pour dénoncer les régimes communistes, pour ne pas remettre en cause l’arrêt de l’immigration de travail : ce sont des enjeux de politique intérieure. Pendant cette période, les espagnol.e.s, portugais.es, et yougoslaves bénéficiaient de moins de tolérance. Toujours pour des raisons de politique, extérieure cette fois.
Donc, la catégorie « réfugié.e » est flexible. Il y a du jeu possible, de la confusion même. Or, du point de vue de l’exilé.e, le statut de réfugié.e est un statut contraignant. Il n’y a pas de retour possible au pays, la rupture est totale. Le statut de migrant.e est moins radical et conviendrait mieux à certain.e.s.
Dans les années 80, le contraste est grand entre le traitement des exilé.e.s asiatiques, reconnu.e.s réfugié.e.s sans difficulté, (on étouffe même certaines fraudes) et les personnes venant du Zaïre : pour celles-là, la suspicion préfigure celle qui règne actuellement. Pourquoi cette évolution ? C’est la fin de la guerre froide, plus personne n’est intéressé à décrédibiliser les régimes communistes. La période est maintenant loin de la décolonisation, et les relations avec les anciennes colonies sont recherchées, pour favoriser les échanges commerciaux.
De même, dans les années 90, l’entrée des Kurdes devient difficile : ce n’est pourtant pas la situation en Turquie qui a changé, ce sont les relations de la France avec la Turquie !
Regarder l’évolution historique éclaire ainsi le présent : de 20% de refoulé.e.s et 80% de statut de réfugié.e accordé par l’OFPRA, on est passé à la proportion inverse. Ce n’est pas parce que l’OFPRA aurait perdu son « indépendance ». En fait, elle ne l’a jamais eue. Les critères ont changé, voilà tout ! Avant, les critères diplomatiques étaient prépondérants, actuellement ce sont les nécessités de la politique intérieure. Il s’agit, devant l’opinion publique, de « gérer les flux migratoires ». Parce que la période est une période de crise économique, et que c’est facile et commode de désigner l’exilé.e comme bouc émissaire. Ce n’est pas que les agent.e.s de l’OFPRA soient devenu.e.s xénophobes. C’est que ces personnes sont formées à chercher « le vrai dissident », « le bon réfugié », introuvables. Les motivations des personnes sont, par définition, personnelles et mêlent, la plupart du temps, des raisons politiques, ou religieuses, mais aussi professionnelles, affectives, d’évènements de vie, de goût pour l’ailleurs…
Ce que nous apprend cette recherche historique, c’est que le critère entre exilé.e accepté.e et indésirable n’est pas une vérité objective et éternelle. C’est aussi que ce n’est pas une question de nombre, c’est une question de volonté politique. Et cela conforte l’idée qu’il ne peut pas y avoir de politique de l’asile sans une politique ouverte de l’immigration dans son ensemble. Celles et ceux qui pensent en protéger au moins quelques-un.e.s en se consacrant aux personnes ayant demandé l’asile exclusivement se trompent : le nombre des un.e.s et des autres baisse ensemble.
C’est stupéfiant de constater le fossé entre les résultats d’une telle recherche, historique et sociologique, et d’autres qui convergent, et les décisions administratives qui sont prises.
En conclusion : ne nous laissons pas abuser par de fausses oppositions : migration économique en opposition à l’asile politique, migration individuelle en opposition à la migration collective, départ volontaire en opposition au départ forcé.






 Joël/Jobéni – L’interview, suite…
Joël/Jobéni – L’interview, suite…