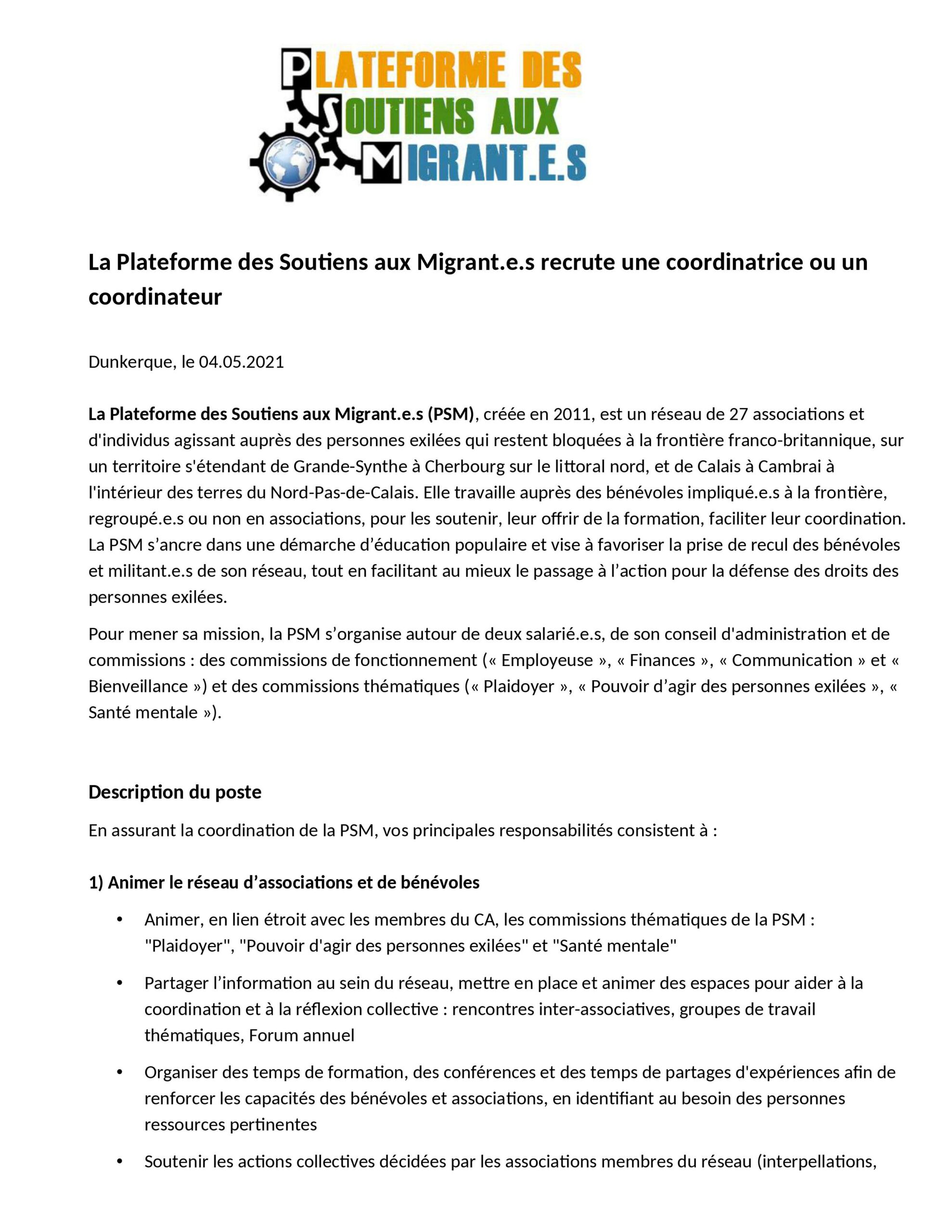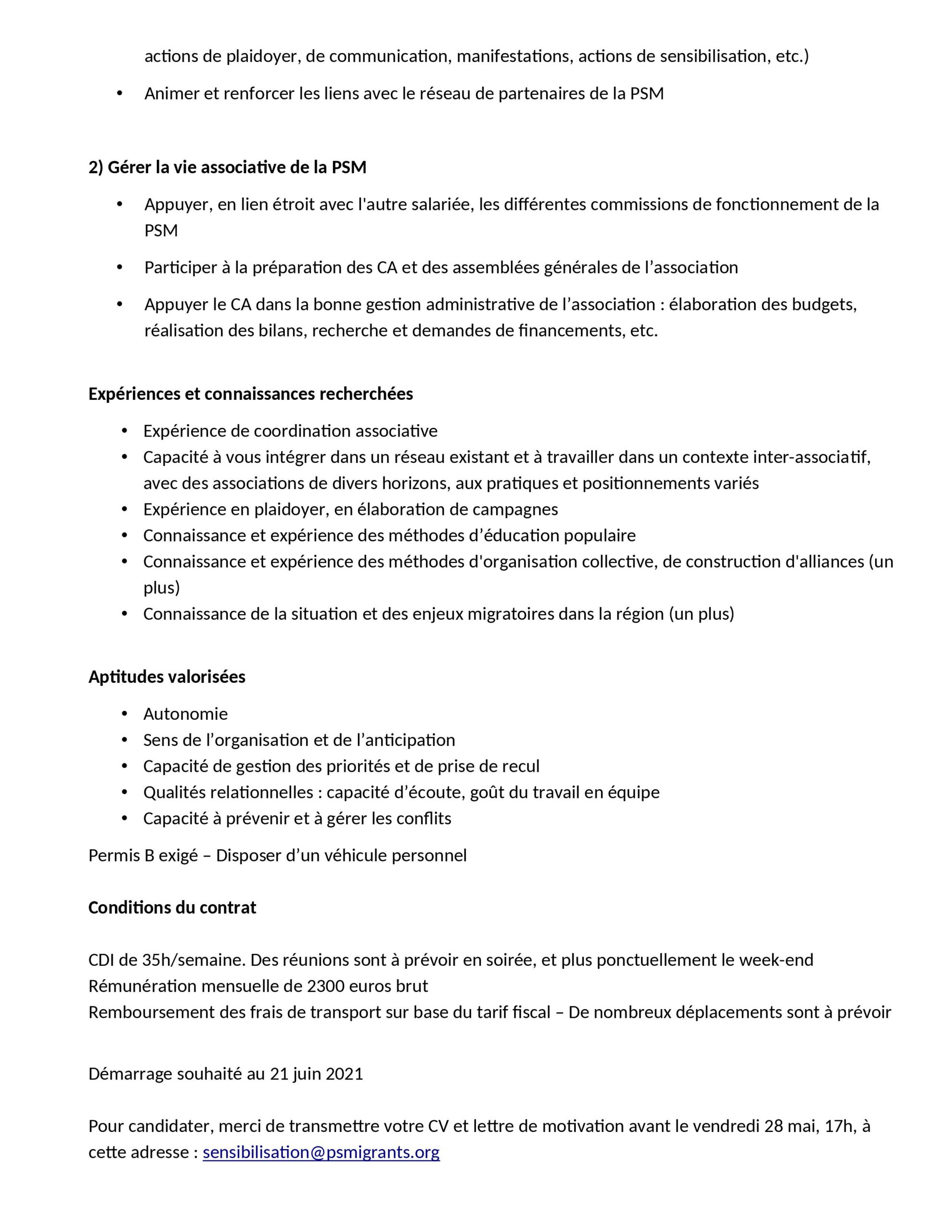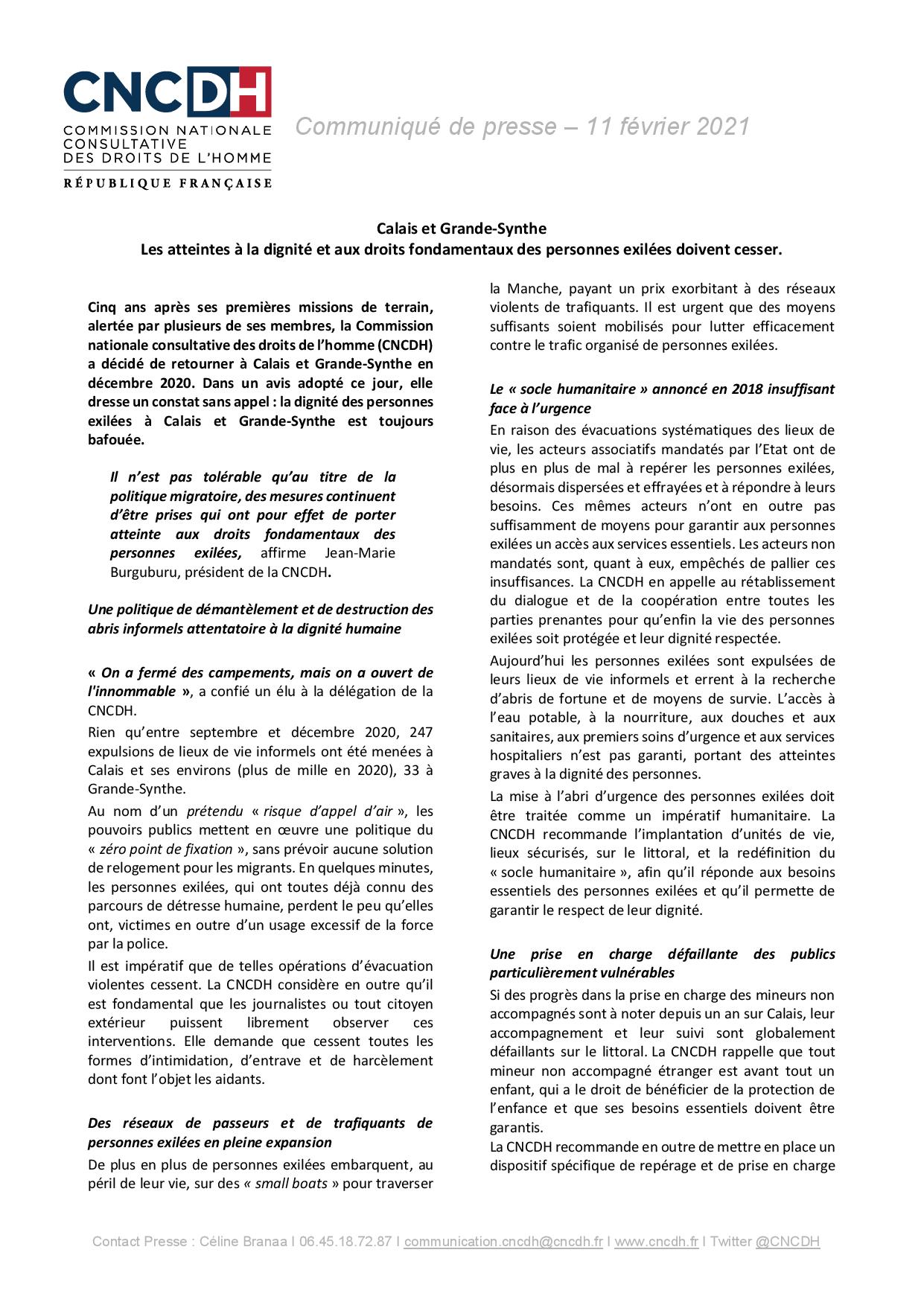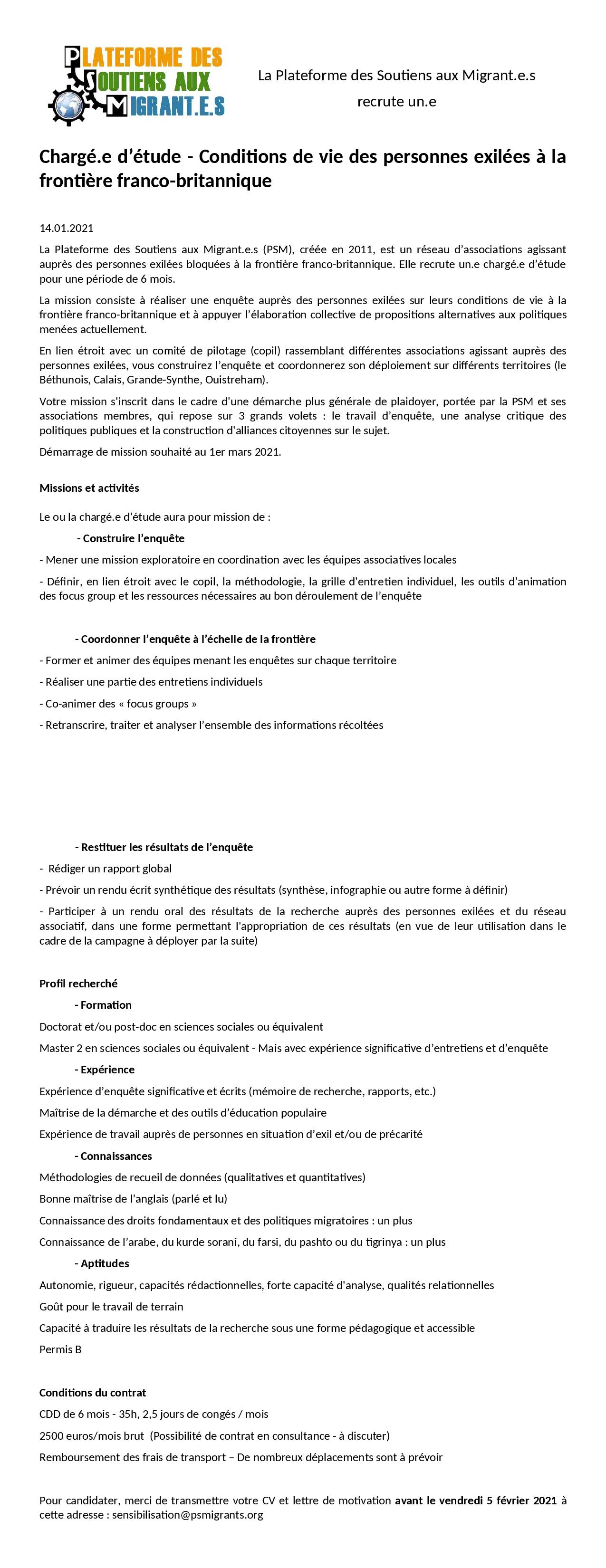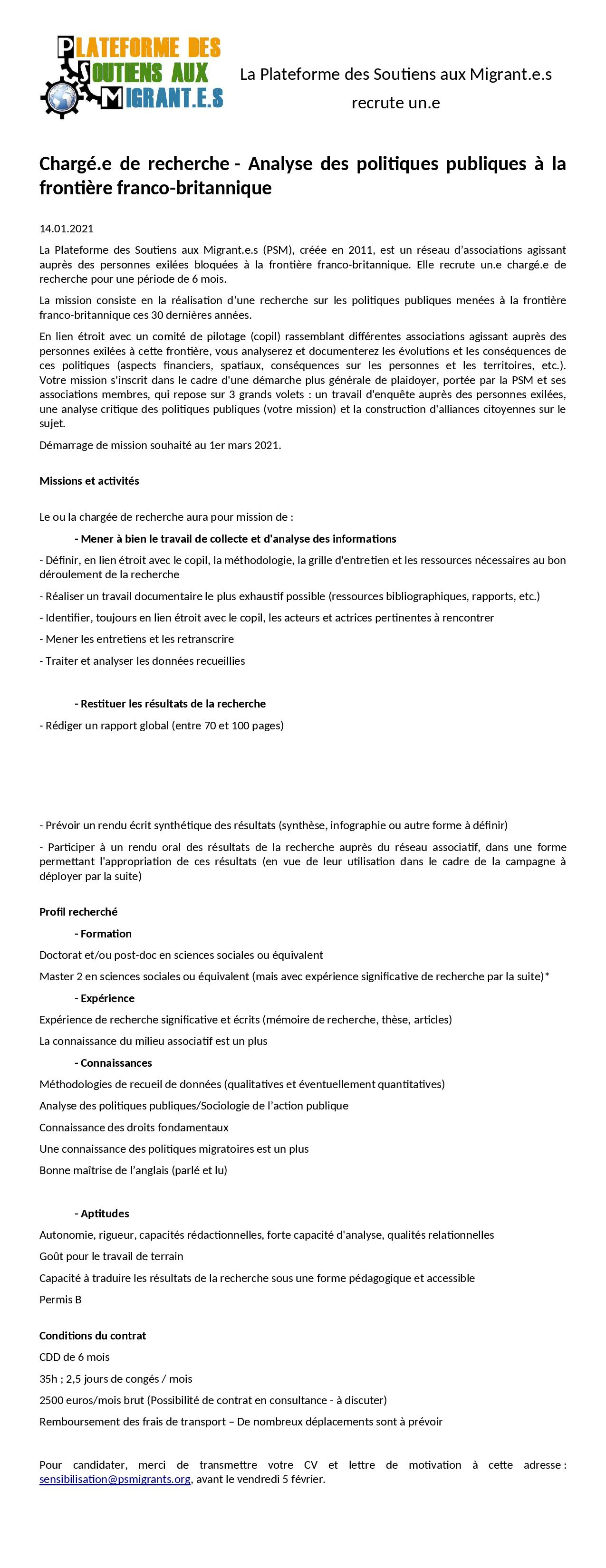A Calais, on met des noms sur les tombes
Depuis plus de vingt ans, près de 300 migrants sont morts en tentant de franchir la frontière franco-britannique.
Pour éviter que ces disparitions ne passent inaperçues, à Calais, une vingtaine de personnes, réunies dans un « groupe décès », œuvrent pour identifier les disparus, retrouver leur famille et leur donner une sépulture digne.
Lecture en 6 min.

La militante associative Siloé dans le carré musulman du cimetière nord de Calais, où sont enterrés les migrants musulmans qui ont pu être identifiés. Marion Esquerré pour La Croix
Tout a commencé par un article dans La Voix du Nord. Ce dimanche 18 octobre 2020, le journal local écrit que « le corps sans vie d’un migrant a été retrouvé sur la plage de Sangatte, au niveau de la mairie », et que la victime, qui ne porte pas de papiers d’identité sur elle, « serait un homme, âgé entre 20 et 40 ans, d’apparence moyen-orientale ». Prise derrière des poteaux de bois plantés dans le sable, une photo montre des officiers de police penchés sur un corps dont on n’entrevoit presque rien.
Ce jour-là, comme à chaque fois que l’un d’entre eux apprend la mort d’un migrant, les membres du « groupe décès » de Calais, qui comprend une vingtaine de personnes, simples citoyens ou salariés d’associations comme le Secours catholique, Utopia 56, Médecins du monde ou la Croix-Rouge, échangent leurs informations. Créé en 2017, le groupe décès s’est donné pour objectif d’identifier les personnes décédées, de retrouver leur famille et de les enterrer conformément à leur rite et aux souhaits de leurs proches. Pour rendre leur dignité à ces disparus, le lendemain de chaque décès, un petit rassemblement a lieu à 18 h 30 place Richelieu pour une minute de silence et un petit temps d’échange.
Tout de suite, une réunion est aussi organisée dans les locaux du Secours catholique, rue de Moscou. Il y a là Juliette Delaplace, chargée de mission « exilés » au Secours catholique de Calais, Mariam Guérey, animatrice dans la même association, Siloé Médriane, la coordinatrice d’Utopia 56, et plusieurs autres Calaisiens. Des équipes sont constituées. Une militante, Fabienne, s’occupera des contacts avec la police, Siloé et Mariam se chargeront des proches.
« Normalement, quand il y a décès, c’est aux policiers de trouver l’identité et de rechercher les causes du décès, explique Juliette Delaplace. Mais ils ne vont plus enquêter dans les camps à la recherche des proches. » Cette fois, par exemple, l’enquête n’avance guère. L’officier de police judiciaire indique qu’il part en vacances le vendredi suivant, et que si d’ici là aucun nom n’apparaît, l’enterrement se fera sous X.
Pas question que l’homme de la plage connaisse ce sort. Au groupe décès, c’est le branle-bas de combat. Chacune de leur côté, Siloé et Mariam, accompagnées d’interprètes en pachtoune et en persan, font le tour des quatre ou cinq lieux de vie des migrants de Calais, avec les maigres informations à leur disposition. Un manteau noir. Une implantation capillaire un peu haute. Chez les Iraniens, où se rend Mariam, un homme manque à l’appel. La description pourrait correspondre. Surtout, quand elle indique que l’homme avait sur lui 50 € dans une poche en plastique, un compatriote est saisi d’effroi. On lui demande une photo de son ami, qui est présentée à la police, laquelle confirme que c’est bien lui. Il s’appelle Behzad Bagheri Parvin, il a 32 ans, il est né à Rasht, dans le nord-ouest de l’Iran, et sa vie s’est arrêtée à la frontière franco-britannique.
« Son camarade, qui partageait sa tente, nous a raconté que la veille du départ, Parvin avait fait un rêve, se souvient Mariam. Il avait expliqué qu’il s’était vu, seul, en Grande-Bretagne. Le lendemain, il est allé acheter un canot pneumatique pour tenter la traversée en solitaire. Quand il est revenu, il lui restait 60 €. Il a donné 10 € à son ami. Ils se sont dit au revoir le samedi à 15 heures. » Le dimanche matin, la Manche avait rejeté le corps de Parvin sur la plage de Sangatte.
Traumatisé, le camarade de tente quitte Calais, refusant hébergement et prise en charge psychologique. Omid, le traducteur persan, et Mariam se chargent alors d’appeler la famille en Iran. Une tâche délicate. Les parents sont incrédules. Il faut leur envoyer le certificat de décès. Ils envisagent alors de faire revenir le corps en Iran. Mais ce souhait se heurte au coût du rapatriement. La décision est alors prise de l’enterrer à Calais, en respectant le rite chiite et les volontés de la famille.
Le jour des funérailles, « j’ai apporté un foulard noir qu’on a mis sur la tombe, et sur lequel on a posé la photo de Parvin et des gâteaux cuisinés par une amie et un collègue iranien. Un représentant du culte musulman a dit une prière, raconte Mariam. On a tout filmé et envoyé à la famille. On a mis de côté pour eux un peu de terre, une photo et un bonnet que son ami a retrouvé dans sa tente ». « On n’était pas beaucoup, ça n’a pas duré très longtemps, c’était un peu triste », se souvient Siloé. Mais, pour le groupe décès, l’essentiel est accompli : Parvin a une tombe à son nom au carré musulman du cimetière nord de Calais.
Ce n’est pas toujours le cas. En mai, le corps d’un homme a été retrouvé dans le port de Calais. Au poignet, il portait un bracelet au nom de Camara, mais son patronyme est resté inconnu. Il a été enterré sous X au carré des indigents du cimetière sud de la ville. Sur la plaque qui surplombe sa tombe est indiqué « Mr X 20-323 ». « Cela arrive, malheureusement, commente Mariam.Ce sont des personnes à qui leurs parents ont donné un nom, c’est insupportable de ne pas le leur rendre. » Les cheveux bouclés, les yeux noirs cernés, le regard intense, Mariam est un peu la mémoire du groupe décès. Depuis 2003 qu’elle travaille au Secours catholique, elle a été témoin de dizaines de disparitions, qui n’ont pas toujours été traitées avec respect. Du temps de la « jungle », il est arrivé que la photo d’un cadavre soit affichée à l’entrée d’un centre, pour avertir d’éventuels proches.
Désormais, depuis la mort le 27 octobre dernier de sept personnes dans un naufrage, dont toute une famille originaire du Kurdistan iranien, avec trois enfants, le groupe décès travaille en lien étroit avec la Croix-Rouge. « Notre travail, explique Marion Huot, officier de recherches du service rétablissement des liens familiaux, c’est de faire le lien avec les autres membres de la famille, de les accompagner dans leur deuil grâce à nos correspondants sur place et de faire en sorte que leurs souhaits soient respectés. » La famille des naufragés, qui a eu la douleur d’apprendre leur décès par la presse, a demandé la plus grande discrétion.
Cette sextuple disparition figure dans la frise chronologique qu’a réalisée Maël Galisson. Ce militant du Gisti, compagnon de route du groupe décès, a fait un impressionnant travail de recensement des décès à la frontière franco-britannique. Depuis 1999, il a compté 296 décès. « Mais je ne prétends pas à l’exhaustivité, commente-t‑il, car je n’ai pas connaissance de toutes les disparitions et avec la croissance des tentatives de traversée en mer, il y a certainement des naufrages dont on n’entend pas parler. »
« Au-delà du nombre de morts, ce qui ressort de ces statistiques, détaille Maël Galisson, c’est que la frontière tue et que ces morts sont étroitement liées aux décisions successives de fortification des lieux de passage. » La majorité des disparitions sont dues aux tentatives de passage elles-mêmes, notamment en camion, bien plus qu’aux violences ou conditions de vie des exilés à proprement parler (lire les repères). « L’une des techniques consiste à s’accrocher sous les essieux ou à essayer de se cacher dans la cargaison, reprend Maël. Certains meurent asphyxiés ou écrasés par les marchandises. Beaucoup décèdent en descendant du camion, percutés par des véhicules. »
Mais surtout, précise-t‑il, « à chaque fois qu’une voie se ferme, les exilés tentent une autre voie, plus dangereuse ». Depuis que le port a fait l’objet de lourds travaux de fortification, « on voit se multiplier le nombre de morts via Eurotunnel ». Puis, après la sécurisation d’Eurotunnel, les exilés tentent de créer des embouteillages sur la rocade, et de nombreux accidents sont recensés. Enfin, à la suite de la fortification de la rocade, se multiplient les tentatives par voie maritime. Dernièrement, « les embouteillages liés au Brexit ont conduit à ce que beaucoup tentent leur chance en essayant de grimper dans des camions sur l’autoroute », note Juliette Delaplace, qui se souvient, alors qu’une réunion d’urgence était organisée à propos d’un décès sur l’A16 le 19 novembre dernier, qu’une vingtaine de Soudanais étaient arrivés au Secours catholique. « Ils savaient ce qui s’était passé, c’était leur ami qui était décédé », se rappelle Siloé.
Le jeune homme en question s’appelait Mohamed Khamisse Zakaria. Il avait 20 ans. Il était arrivé moins de deux mois auparavant à Calais, avec un ami qui, depuis, avait réussi à passer en Angleterre. L’un des jeunes gens du groupe des Soudanais l’a aidé à monter dans un camion et a fermé la porte derrière lui. Que s’est-il passé ensuite ? Mohamed a-t‑il eu peur ? Quoi qu’il en soit, il est ressorti du camion et alors que la police faisait usage de gaz lacrymogène, on a vu Mohamed courir à travers la voie. Avant d’être percuté par une voiture.
C’est un camarade mineur, originaire du même village du Darfour que Mohamed, qui s’est chargé, avec Mariam et Siloé, d’appeler la famille, qui vit désormais dans un camp de réfugiés. « C’était très dur », euphémise Siloé. « La mère n’arrêtait pas de répéter : “Mais il est où ? Mais il est où ?” », se souvient Mariam, qui a mis de côté pour les parents les bijoux que portait leur fils. La Croix-Rouge a pris le relais. Un trio d’amis s’est chargé d’organiser les funérailles au cimetière nord. Les associations ont, elles, organisé deux cérémonies du souvenir au Secours catholique, avec prières musulmane et catholique. Il y avait plus de 150 personnes. Écrit par ses compagnons de route, un texte a été lu. « Ses vingt ans de vie crient à nos cœurs, nos consciences, et à la conscience de l’humanité. Voici en écho notre cri, celui des exilés de Calais : “Nous ne savons pas quoi faire, nous voudrions accéder légalement au Royaume-Uni, nous rêvons d’une vie digne, d’une vie d’humains. Les circonstances nous affaiblissent mais nos cœurs sont forts et l’espoir nous pousse à traverser les frontières.” »
:quality(70):focal(2122x1049:2132x1059)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/KEW5ZDCXW5FZZLF2IOQZQV4WNY.jpg)