Par Juliette Bénézit, Le Monde du 26 juillet 2021
Bénévoles et habitants ne voient toujours pas d’issue dans cette ville qui attire encore des milliers d’exilés.
Zenawi se distingue par sa posture. On l’aperçoit au loin, planté au fond d’un campement où vivent une centaine d’exilés, à Calais (Pas-de-Calais). Il se tient à l’écart et ne bouge pas. Le jeune homme est un Erythréen de 24 ans au visage rond. Il porte une épaisse doudoune noire et une boucle d’oreille qui brille. Zenawi balaye l’endroit du regard, puis lance : « Ça fait peur. »
Quelques heures plus tôt, le jeune homme est arrivé à la gare ferroviaire de Calais-Fréthun, bagages en main. En ville, il a demandé quoi faire, où aller. On lui a indiqué ce camp situé près de la rocade portuaire, où vivotent principalement des Erythréens. Ici, les détritus jonchent le sol et certaines silhouettes sont amaigries. Après avoir passé six ans en Suisse, où sa demande d’asile a été rejetée plusieurs fois, le dernier espoir de Zenawi se situe désormais de l’autre côté de la Manche, en Angleterre. Il demande : « Combien ça coûte pour passer là-bas ? »
Abderrahmane, un Soudanais de 17 ans, est à Calais depuis un mois. Il flotte dans ses vêtements et marche en tongs. Le jeune homme est installé dans un autre camp de la ville, situé dans la zone de l’hôpital, où se concentrent environ 500 personnes. Là, en s’enfonçant, on aperçoit sous les feuillages des bâches trouées, des couvertures de survie, une paire de gants, des boîtes de conserve vides. A quelques mètres d’une décharge d’excréments, on tombe sur une poussette abandonnée. Tous les soirs, Abderrahmane dort sous un arbre avec son duvet. Il n’a pas de tente. Pour trouver le camion qui l’emmènera en Angleterre, il dit qu’il se débrouille tout seul : il n’a plus d’argent pour payer les passeurs.
Abderrahmane, 17 ans, a quitté sa ville natale de Wad Madani, au Soudan, il y a quatre mois. Il a traversé la Libye et l’Italie pour arriver à Calais il y a un mois. Tout comme ses amis avec qui il partage un arbre à l’intérieur de la jungle « Hospital », l’adolescent rêve d’Angleterre. Du fait des passages et évacuations répétitives par les forces de l’ordre, les exilés de la jungle « Hospital » n’ont plus de tentes. Les personnes se retrouvent sans-abri et terminent souvent la nuit sur les parkings et les ronds-points aux abords de la « jungle », pour ne pas se faire réveiller par la police.
Après vingt ans de crise humanitaire, les destins des migrants de passage à Calais se brisent toujours au sein de cette ville qui les plonge dans un abîme de misère. D’après les chiffres des associations et de la préfecture du Pas-de-Calais, entre 900 et 2 000 exilés sont présents sur le littoral, principalement des Erythréens, des Soudanais, des Afghans, des Iraniens et des Syriens, parmi lesquels de plus en plus de femmes et d’enfants. Après vingt ans de crise humanitaire, cette détresse laisse place à un épuisement généralisé, des bénévoles aux habitants, qui ne voient toujours pas d’issue.
Des évacuations toutes les quarante-huit heures
Cet été, comme depuis deux décennies dans le Calaisis, il y a urgence. Urgence, selon le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, en déplacement à Calais samedi 24 juillet, à sécuriser davantage la frontière franco-britannique, à renforcer la présence policière et la lutte contre les passeurs. Depuis le début de l’année, plus de 8 000 exilés ont rejoint le Royaume-Uni à bord de « small boats » – des petites embarcations de fortunes –, presque autant que sur l’ensemble de l’année 2020.
Urgence également, pour les associations humanitaires, qui s’alarment : comment poursuivre leurs missions ? Comment distribuer de la nourriture alors qu’un arrêté préfectoral interdit cette activité dans une partie de la commune et que les autorités intensifient la pression sur la dizaine de campements situés en périphérie de la ville ? « En ce moment, les évacuations ont lieu tous les jours, à des rythmes différents. La police ne vient plus nécessairement le matin, mais parfois en plein après-midi », rapporte Pierre Roques, de l’association Utopia 56.
Le plus souvent, les exilés se déplacent de quelques mètres et reviennent aussitôt. Leurs effets personnels, comme leur tente ou leur téléphone portable, peuvent être saisis. Ils ont trois semaines pour les récupérer dans un local mais nombreux sont ceux qui racontent ne pas les retrouver. « A force, il y a une pénurie de tentes. On n’a plus de stock », déplore Pierre Roques.
Depuis le démantèlement de la « jungle » de Calais en 2016, où s’entassaient près de 10 000 personnes, les autorités veulent éviter les « points de fixation ». Jusqu’à récemment, les évacuations étaient organisées toutes les quarante-huit heures. « On voit, sous le mandat d’Emmanuel Macron, l’industrialisation de cette politique de dissuasion qui est mise en place depuis plusieurs années », analyse Pierre Bonnevalle, actuellement chargé, par la Plate-forme des soutiens aux migrants, de mener une étude sur les politiques publiques à l’œuvre dans le Calaisis depuis trente ans. « C’est la seule manière de ne pas laisser des choses inacceptables s’installer », a défendu Gérald Darmanin, samedi, dansune interview à La Voix du Nord
En janvier 2018, le président de la République, Emmanuel Macron, définissait les contours d’un « socle humanitaire » mis en place par l’Etat à Calais. A savoir, l’organisation de distributions de nourriture assurées par des associations mandatées, le rétablissement d’accès aux douches et à l’eau et la possibilité de mises à l’abri d’urgence.
Un dispositif jugé « insuffisant » par la Commission nationale consultative des droits de l’homme, dans un avis rendu le 11 février. L’autorité administrative indépendante appelle à « mettre fin à la politique sécuritaire dite du “zéro point de fixation” » et recommande « la création de petites unités de vie, le long du littoral, permettant aux exilés de trouver un lieu sécurisé et un temps de répit propice à une réflexion sur leur projet migratoire ».
« On se sent souvent impuissants »
En attendant, les associations tentent de s’adapter. Utopia 56, par exemple, effectue des maraudes sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. L’association est arrivée dans le Calaisis en 2015. Leurs bénévoles sont jeunes. La plupart ne sont pas de la région. Portés par leur indignation, ils viennent prêter main-forte pour quelques mois ou quelques semaines.
En cette soirée du 13 juillet, Mathilde Le Viavant, 27 ans, et Lucille Echardour-Coural, 22 ans, assurent une maraude. Au volant d’un van bleu marine cabossé, elles sillonnent la ville et les campements dans le but de mettre en relation le Samusocial et les familles à la rue. « On se sent souvent impuissants. La semaine dernière, on a laissé 31 personnes dehors, avec des femmes et des enfants. Il n’y avait plus de place au 115, témoigne Lucille. Il faut aussi se ménager psychologiquement. On n’a pas forcément la maturité émotionnelle pour voir tout ça. »
Ce soir-là, une maman afghane leur a téléphoné depuis son campement. Elle est accompagnée de sa fille de 6 ans et porte son bébé d’un an dans ses bras. Toutes les trois viennent d’arriver de Belgique, où leur demande d’asile a été rejetée. La mère est anxieuse. Elle explique qu’elle ne sait pas vraiment si elle veut aller au Royaume-Uni. Elle montre ses chaussures pleines de boue et confie qu’elle n’en a pas d’autre. Elle raconte que sa petite fille lui demande tous les jours : « Maman ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? »
« [A la fin des années 1990], je trouvais que ce lieu était dur, raconte Martine Devries, une Calaisienne de 73 ans. Finalement, c’était le paradis comparé à la situation actuelle »
Certains bénévoles plus âgés, des militants de la première heure, ne parviennent plus toujours à faire face à ce désarroi, épuisés de « vider l’océan à la petite cuillère ». Martine Devries, une Calaisienne de 73 ans, s’était engagée pour les réfugiés à la fin des années 1990. A cette époque, des Kosovars fuyant la guerre s’étaient installés dans un parc du centre-ville, rendant pour la première fois visible la cause des migrants bloqués dans le Calaisis.
Cette ancienne médecin généraliste a ensuite assuré des consultations au centre humanitaire de Sangatte, où quelque 67 000 exilés ont transité entre 1999 et 2002. « A l’époque, je trouvais que ce lieu était dur, raconte-t-elle. Finalement, c’était le paradis comparé à la situation actuelle. »
Christian Salomé, 72 ans, a passé la main avant que la maladie ne le rattrape. Pendant plus de dix ans, cet ancien salarié d’Eurotunnel a dirigé L’Auberge des migrants, une association créée en 2008. Il y a consacré toute sa retraite. Il accueillait chez lui des exilés, les accompagnait dans leurs démarches. Sa conjointe, Marie, 70 ans, une enseignante à la retraite, confie : « On a parfois frôlé le burn-out et on a souvent pleuré. »
Riverains « exaspérés »
D’après la préfecture du Pas-de-Calais et la municipalité, la situation migratoire continue d’alimenter les tensions en ville. Toutes deux indiquent que le nombre de mains courantes enregistrées est en augmentation depuis un an et que la présence policière a dû être renforcée. Des problèmes liés à la consommation d’alcool et des nuisances sont rapportées par les Calaisiens qui habitent à proximité des campements. La maire de la ville, Natacha Bouchart (Les Républicains), évoque des riverains « exaspérés » et une « perte d’attractivité » pour la commune.
A Calais, on raconte l’histoire de deux mondes qui s’ignorent et ne se connaissent pas ou si mal. Les « migrants » ? Tout juste les croise-t-on dans la rue, à la gare, dans les bus, au supermarché ou dans les parcs. En mai, Amnesty International a publié les résultats d’une étude menée avec Harris Interactive pour comprendre ce que ressent la population face à cette crise humanitaire. Bilan : c’est d’abord la situation économique de la ville qui préoccupe, alors qu’un habitant sur trois vit sous le seuil de pauvreté.
Ensuite, les répondants estiment que la crise, perçue comme insoluble, a dégradé l’image de la ville. Ils disent se sentir non pas insensibles au sort des exilés mais impuissants, lassés, découragés. Claire Millot, 70 ans, secrétaire générale de l’association Salam-Nord-Pas-de-Calais, évoque l’histoire de ce monsieur qui lui disait à propos des migrants : « Je veux que ces gens disparaissent, ils me culpabilisent. »
La route de Gravelines est une rue pavillonnaire proprette où de belles maisons de ville sont situées de part et d’autre de la chaussée. Tout proche, il y a la zone industrielle des Dunes. Pendant plusieurs mois, des campements y étaient installés, à côté des habitations et des commerces, avant que les lieux ne soient évacués, murés et grillagés. Valérie (le prénom a été modifié), la patronne d’un café avoisinant, évoque les difficultés rencontrées pendant cette période, les tensions, les clients qui se faisaient plus rares. « On comprend qu’ils veuillent aller au Royaume-Uni, mais qu’est-ce qu’on peut faire ? », constate-t-elle.
Bisrat, un Erythréen de 23 ans, est à Calais depuis six mois. Le soir où nous le rencontrons dans le campement où il vit, il est assis sur un bloc de béton, seul. Il est le premier de sa famille à être parti et se sent investi d’une grosse responsabilité. Il est passé par la Libye, il a traversé la Méditerranée. Ses empreintes sont enregistrées en Italie, pays responsable de sa demande d’asile. Bisrat n’a plus d’argent pour payer les passeurs. Tous les soirs, il essaie de monter dans un camion, en vain. Il demande : « Qu’est-ce que je devrais faire ? »




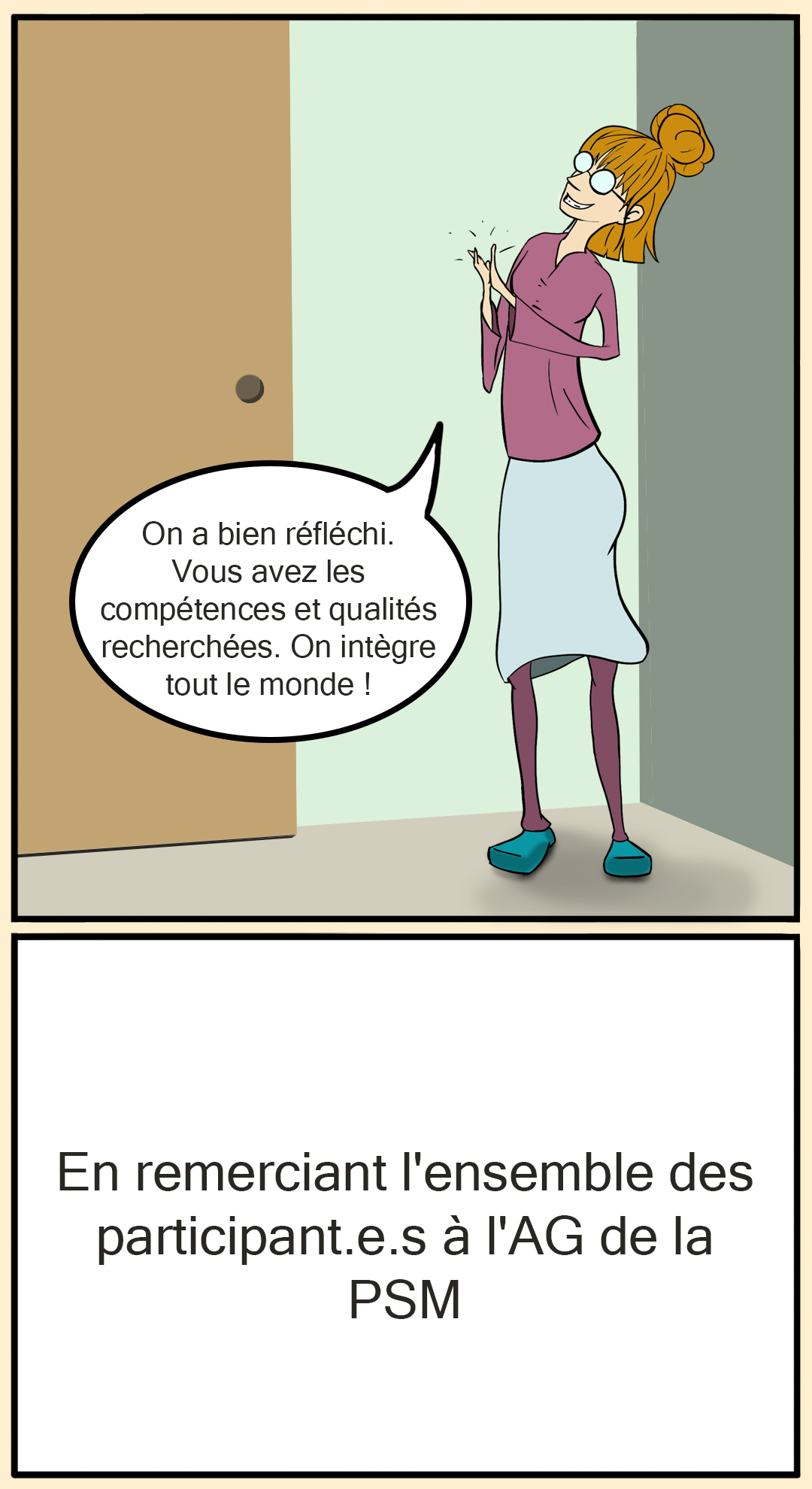
:quality(70):focal(1659x1372:1669x1382)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/FUVN4A2IHNGCBANMT3LI2ZQ5OA.jpg)





