Abubaker est décédé lundi 28 février dernier à Calais. Le texte ci-dessous, rédigé avec l’aide de ses proches, revient sur les circonstances de son décès.


Abubaker est décédé lundi 28 février dernier à Calais. Le texte ci-dessous, rédigé avec l’aide de ses proches, revient sur les circonstances de son décès.

Les premières décisions de rejet de demandes d’asile d’Afghans sont tombées. En parallèle, les demandes de réunification familiale ou de rapatriement formulées par des réfugiés déjà protégés en France n’aboutissent pas, laissant les requérants imaginer le pire pour leurs proches restés dans le pays.
Nejma Brahim, Mediapart, 25 décembre 2021
Depuis la chute de Kaboul et la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan en août dernier, certains organismes – français et internationaux – estiment qu’il n’y a plus de conflit armé, réduisant ainsi les chances pour les Afghans d’obtenir une protection.
Au lendemain d’un attentat revendiqué par l’État islamique le 26 août, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), chargée d’étudier les recours des personnes ayant vu leur demande d’asile rejetée en premier lieu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), suggérait ainsi aux juges de réduire la protection des Afghans, considérant qu’il était « permis de conclure à la cessation du conflit armé ».
« À cet égard, les deux attentats revendiqués par l’organisation État islamique le jeudi 26 août ne remettent pas en cause cet état de fait », pouvait-on lire dans un mail interne que s’était procuré Mediapart fin août . Dans les semaines qui suivent, les premiers rejets pour des demandes d’asile formulées par des requérants afghans tombent.
Mediapart a pu consulter une quinzaine de décisions de la CNDA, datées entre le 15 septembre et le 3 décembre, dans lesquelles la cour évoque des déclarations « très peu circonstanciées ou personnalisées », « confuses ou incohérentes », « lacunaires », « sommaires et peu substantielles » ou encore des propos « superficiels ».
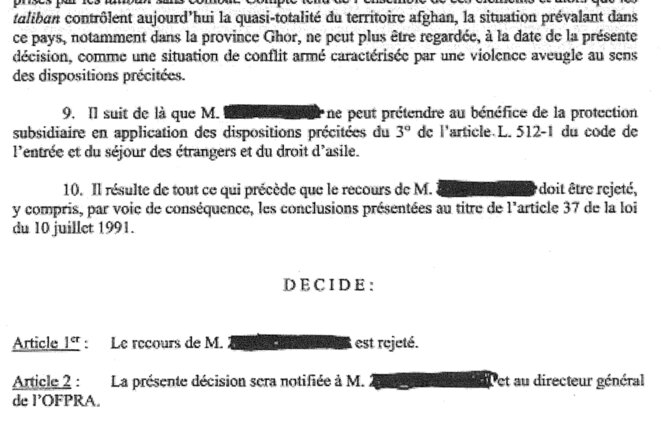
La plupart du temps, la cour souligne que les déclarations du requérant « n’ont pas permis d’établir la réalité des faits à l’origine de son départ d’Afghanistan ni d’établir le bien-fondé et l’actualité de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ». En balayant ainsi les craintes de persécutions ou de menaces graves – pouvant émaner d’une opposition d’ordre politique ou religieux, par exemple –, les juges de l’asile refusent d’accorder le statut de réfugié au requérant.
À chaque fois, ils reconnaissent toutefois que « les talibans contrôlent aujourd’hui la quasi-totalité du territoire afghan », mais estiment que la situation prévalant dans ce pays, et notamment dans la province du requérant, « ne peut plus être regardée comme une situation de conflit armé caractérisée par une violence aveugle ». Autrement dit, le degré de violence n’est pas suffisant pour justifier une protection pour les requérants afghans, qui n’encourent, selon les juges, plus de risques en cas de retour sur place. De quoi provoquer l’ire des avocats qui accompagnent les demandeurs d’asile afghans.
Dans son cabinet situé en région parisienne, Myriam*, avocate spécialisée en droit d’asile, épluche ses dossiers. Elle compte une vingtaine de rejets de la CNDA depuis la chute de Kaboul. Et depuis le 13 décembre, au moins dix rejets de l’Ofpra. « Après la prise du pouvoir par les talibans, on a senti que l’Ofpra jouait la prudence, qu’il temporisait un peu afin de voir l’évolution de la situation. Mais là, on voit qu’il y a une accélération. L’Office commence à rejeter les demandes, ce qu’il ne faisait pas jusqu’ici : soit il protégeait via le statut de réfugié, comme pour les évacués, soit il accordait une protection subsidiaire », commente-t-elle.
L’OFPRA commence à considérer qu’il n’y a pas forcément la nécessité de protéger les Afghans face au régime taliban […]. C’est quand même un sacré positionnement.
Et d’ajouter : « Dans des dossiers où il ne conteste pas la nationalité afghane ni même parfois l’origine du requérant, l’Ofpra commence à considérer qu’il n’y a pas forcément la nécessité de protéger les Afghans face au régime taliban, et estime donc que l’on peut vivre en tant que civil sous ce régime. C’est quand même un sacré positionnement. »
Pourtant, un rapport de l’ONG Human Rights Watch datant du 30 novembre documente l’exécution sommaire ou la disparition forcée de plus de cent anciens agents de la police et du renseignement dans quatre provinces depuis la prise de pouvoir par les talibans le 15 août dernier, et ce « en dépit de l’amnistie proclamée ».
À la CNDA, où le positionnement n’a pas tardé à être formulé aux juges, cela dépend, assure l’avocate, des juges et des chambres. « On a aussi des décisions positives, où les juges considèrent que même si les faits allégués à l’origine de l’exil ne sont pas établis, la simple présence sur le territoire suffit à exposer à une menace ou à de mauvais traitements, et où ils donnent le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. » Cela devient une « vraie loterie », regrette-t-elle.
Une fois leur demande d’asile rejetée, ils se retrouvent en situation d’errance, sans prise en charge ni solution d’hébergement.
« Tous ces rejets sont absurdes et insensés », s’insurge Reza Jafari, président de l’association Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs qui accompagne de nombreux exilés afghans en France et dans le monde. « Pour ne pas accorder de protection subsidiaire, on dit qu’il n’y a plus de conflit interne, alors que le ministère de l’intérieur avait annoncé suspendre les expulsions vers l’Afghanistan juste avant la chute de Kaboul. Pour le statut de réfugié, on demande aux personnes de prouver leur religion, leur ethnie ou leur opposition politique et disent qu’ils manquent de preuves. Mais les gens sont partis avec un sac à dos ! Une fois leur demande d’asile rejetée, ils se retrouvent en situation d’errance, sans prise en charge ni solution d’hébergement », détaille-t-il.
Tout récemment, à la CNDA, le recours d’un demandeur d’asile afghan est passé en ordonnance, c’est-à-dire sans audience et donc sans possibilité de s’exprimer devant un juge. Depuis plusieurs mois, les avocats de la cour sont en grève pour dénoncer un ensemble de « dysfonctionnements », dont les ordonnances de tri font partie, les renvois (qui rallongent les délais pour les demandeurs d’asile), l’influence du Centre de recherche et de documentation sur les décisions (à l’origine du mail interne évoqué plus haut) et le manque d’indépendance et d’impartialité des juges . Les discussions en cours avec la présidence de la cour n’ont toujours pas abouti. Une mission d’inspection doit, dans ce contexte houleux, avoir lieu en janvier.

Ces premiers rejets viennent remettre en cause les beaux discours tenus par l’État français sur l’accueil des Afghans en quête de protection durant les mois qui ont suivi la prise de pouvoir par les talibans. Dans le même temps, les demandes de réunification familiale patinent et sont sources d’anxiété pour les Afghans déjà protégés en France, qui attendent des mois, voire des années, avant d’obtenir une réponse.
Au centre d’accueil pour réfugiés de la Cimade, à Massy-Verrières (Essonne), Basira et Muslima terminent, penchées au-dessus de la table, la confection de l’une des banderoles commencées en septembre. Consciencieusement, Muslima perce le tissu à l’aide d’une aiguille, encore et encore, pour unir le drapeau afghan au texte inscrit au feutre. « Migration forcée par les talibans », « Nouvelle génération sacrifiée », « Nous voulons que le monde nous soutienne », peut-on lire sur la banderole, une fois celle-ci dépliée et suspendue au mur. Et au centre de l’affiche, bien en évidence : « Pourquoi les personnes réfugiées ne peuvent pas obtenir de visas pour leurs familles ? »
Les démarches ont pris presque trois ans, c’était très long, d’autant que nous étions en danger là-bas.
« Lorsque les talibans ont pris le pouvoir en août, ils étaient tous abattus, explique Lætitia, travailleuse sociale. Des cercles de parole se sont mis en place et cela les a vraiment soudés, même s’ils ne parlent pas tous la même langue. L’idée des banderoles est venue pour leur permettre de faire passer des messages. »
Arrivé en France en 2014 après avoir fui les talibans, le mari de Muslima obtient d’abord la protection subsidiaire avant de lancer une demande de réunification familiale. « On est allés à l’ambassade de France trois ou quatre fois pour les passeports, l’entretien, la prise d’empreintes et les photos », relate Muslima, un tissu traditionnel vert émeraude autour de la tête.
« Les démarches ont pris presque trois ans, c’était très long, d’autant que nous étions en danger là-bas. » « On a dû cacher notre départ aux proches et aux voisins, car si les talibans l’apprenaient, on risquait d’être enlevés », ajoute dans un français parfait Intizar, son fils âgé de 16 ans, aujourd’hui inscrit au lycée.
En cause, derrière ces délais, une « politique de suspicion » généralisée et intrusive, selon les travailleuses sociales, visant à sans cesse remettre en doute les liens familiaux avec le conjoint ou les enfants, mais aussi une multitude de documents à fournir, souvent banals en France, mais peu communs dans le pays d’origine. Lorsque la demande est rejetée, les réfugiés peuvent contester la décision auprès de la Commission des recours pour les refus de visa (CRRV), puis, dans un second temps, saisir le tribunal administratif – une autre procédure « longue et pénible » pour les familles.
« Le moindre décalage, un seul document manquant fait perdre encore six mois dans la procédure. » L’un des cas les plus marquants est celui d’une réfugiée dont le recours au tribunal administratif a été rejeté et qui fait aujourd’hui appel de la décision. « C’est la première fois que l’on va aussi loin dans la procédure », soupire Lætitia.

En fin d’après-midi, Abdelhamid, 49 ans, vient rejoindre le groupe. Un feutre rouge à la main, le père de famille repasse sur chaque lettre pour former le mot « Liberté ». Sa fille Basira, 18 ans, ses deux autres enfants, son épouse et sa mère ont pu le rejoindre en France en octobre dernier après plus de deux ans de démarches. « J’ai dû envoyer ma famille en Iran car il n’y avait plus d’ambassade de France en Afghanistan. Ça a été très difficile pour eux là-bas car ils ont souffert de racisme. » La famille a dû composer avec les délais. « Pas le choix. »
Les personnes devaient donc se rendre au Pakistan ou en Iran afin d’effectuer leurs démarches. « Sauf que l’Iran demandait une carte de résident. [L’ambassade] du Pakistan a fermé pendant un an. Après la chute de Kaboul, elle a enfin rouvert, mais elle a annoncé dernièrement que seuls 600 visas avaient été délivrés. C’est très peu quand on sait le retard accumulé », pointe-t-il.
La procédure retarde tout et rend les gens malades.
Dans le même temps, des Afghans en quête de protection se sont retrouvés bloqués à l’aéroport en Iran alors même que leur demande de réunification familiale a été acceptée : « C’est le cas d’un journaliste ou encore d’une dame et ses deux enfants que j’accompagne. Ils sont allés en Iran avec un visa, mais le temps d’obtenir celui pour la France, le premier pour l’Iran avait expiré. Les autorités ne les ont pas laissés prendre l’avion pour la France », relate-t-il.
Si Abdelhamid, le père de Basira, se dit soulagé de savoir ses proches en sécurité à ses côtés, il reste très préoccupé par la situation dans son pays d’origine : « Physiquement je suis là, mais mentalement, je suis toujours là-bas. » « L’Afghanistan a besoin de liberté et les droits des femmes doivent pouvoir être respectés », complète Basira, un foulard noir entourant la moitié de sa chevelure.

En attendant, Abdelhamid a le bras gauche paralysé depuis que son véhicule a roulé sur un engin explosif. Il garde aussi des séquelles psychologiques et voit un psychologue tous les jours. Selon l’une des travailleuses sociales qui les accompagnent, beaucoup ne sont pas venus à l’atelier ce soir car leur histoire est « trop douloureuse ».
Certains sont suivis pour un syndrome post-traumatique, d’autres sont rongés par la peur que leur proche, journaliste ou ex-auxiliaire de l’armée française, soit tué. « La procédure retarde tout et rend les gens malades. On attend de ces personnes de s’intégrer, mais comment voulez-vous qu’elles le fassent sans leur famille et alors qu’elles sont plongées dans l’angoisse ? », interroge Lætitia.
Plusieurs réfugiés du centre ont perdu des membres de leur famille, pour lesquels ils avaient demandé un rapatriement, depuis la prise du pouvoir par les talibans.
À l’annonce de la chute de Kaboul, les équipes du centre se sont activées pour réunir les documents nécessaires aux demandes de rapatriement dans le cadre de la cellule de crise mise en place par le ministère des affaires étrangères. À ce jour, aucun des trente résidents concernés n’a eu de retour. Pourtant, nombre d’entre eux sont aujourd’hui menacés par les talibans, comme les frères et sœurs de Muslima, enseignants ayant participé à des programmes internationaux pour favoriser l’éducation des filles, qui vivent désormais cachés.
« Cela représente une centaine de proches coincés sur place. Plusieurs réfugiés du centre ont perdu des membres de leur famille, pour lesquels ils avaient demandé un rapatriement, depuis la prise du pouvoir par les talibans. Un réfugié arrivé au centre en 2016 a même anticipé, voyant la progression des talibans, et a décidé de partir chercher sa femme et ses quatre enfants en Afghanistan », rapporte Charlotte, une travailleuse sociale. Sa conjointe a finalement perdu la vie dans un attentat. Il avait lui aussi lancé les démarches pour une réunification familiale, qui n’avait toujours pas abouti.

Les récits se suivent et se ressemblent. Abdulzahed, 30 ans, attend que ses parents puissent le rejoindre en France. Il fait partie de celles et ceux qui, constatant les délais de la demande de réunification familiale, ont tenté une demande de rapatriement fin août.
« Les talibans ont tiré sur mon père et il a été blessé au bras », confie-t-il en ouvrant une photo sur son smartphone pour prouver ses dires. Sur le bras de son père apparaît un cratère large de plusieurs centimètres.
Je pense à mes parents tout le temps, je m’inquiète énormément pour eux.
Le mécanicien, désolé de se montrer en bleu de travail de retour du garage, passe une main dans ses cheveux épars pour paraître « plus présentable ». Il affirme ne plus pouvoir se concentrer. « Je pense à mes parents tout le temps, je m’inquiète énormément pour eux. La procédure est trop longue. Rien que pour obtenir l’acte de naissance, ça a pris beaucoup de temps », déplore-t-il.
Un peu avant 21 heures, Basira, Abdelhamid, Abdulzahed, Jumakhan et Lætitia reposent les feutres. Les banderoles sont presque prêtes et seront accrochées à l’entrée du centre en janvier, pour que l’Afghanistan ne tombe pas dans l’oubli, mais aussi pour alerter sur les difficultés rencontrées pour faire rapatrier leurs proches. Timidement, le mari de Muslima s’approche de Lætitia, un téléphone à la main. « J’ai la photocopie du passeport de mon oncle, si tu peux l’ajouter aux demandes de rapatriement… »
Dans un rapport publié mardi soir, Claire Hédon alerte sur les difficultés auxquelles près de 10 millions de personnes sont confrontées dans leurs démarches numériques. Soulignant sa « forte inquiétude », elle pointe l’insuffisance des réponses de l’État.
Faïza Zerouala, Mediapart, 15 février 2022
Il ne faut pas attendre de Claire Hédon, Défenseure des droits, à l’orée de l’élection présidentielle, un commentaire cinglant et frontal envers la politique de dématérialisation engagée par Emmanuel Macron pour « simplifier » officiellement 250 démarches permettant d’accéder aux services publics.
Mais son constat est net : si le basculement dans le tout-numérique est réussi d’un certain point de vue et sur le plan quantitatif, cette politique laisse sur le bas-côté les plus démuni·es face à la chose numérique.
C’est ce volet que l’institution indépendante a choisi d’explorer dans un rapport rendu public mardi 15 février au soir, baptisé « Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-on ? ». En rebond d’un premier rapport consacré au sujet, la Défenseure des droits a en effet souhaité dresser un bilan des améliorations apportées – ou non – en matière d’accès des citoyennes et citoyens les plus fragiles et précaires aux services publics numériques. Elle en tire une « forte inquiétude » et regrette l’insuffisance des réponses de l’État.

En creux, Claire Hédon pointe tous les défauts d’une stratégie qui fragilise une large partie de la population : quelque 10 millions de personnes, selon ses estimations, rencontrent des obstacles pour faire valoir leurs droits. Lors de la présentation de cette étude à la presse, la Défenseure des droits a expliqué que « la dématérialisation est une chance et simplifie pour un grand nombre de personnes l’accès à un certain nombre de droits. Mais pour un certain nombre de personnes, ça va être compliqué, ça les éloigne à cause de difficultés techniques. » Sachant que 15 % des foyers ne sont pas équipés d’Internet à domicile. La pandémie a aussi révélé l’ampleur de cette fracture numérique.
Claire Hédon a ainsi dénombré, en 2021, 90 000 saisines de son institution relatives à ces difficultés d’accès aux services publics (contre 35 000 en 2014), sur 115 000 reçues en tout.
Et de citer des exemples concrets d’entraves. « Nous avons des réclamants qui mettent six mois, un an, 18 mois à obtenir leur pension de retraite et qui se retrouvent sans rien pendant tout ce temps-là. » Alors que l’État fait tout pour encourager le dispositif Ma prim rénov’ qui vise à aider les ménages à améliorer l’efficacité énergétique de leur logement, le choix d’une procédure exclusivement numérique complique l’accès. Certaines personnes ratent des convocations de Pôle emploi, exclusivement envoyées par voie électronique, et se retrouvent radiées pour avoir manqué sans le savoir des rendez-vous avec leur conseiller ou conseillère.
La Défenseure des droits déplore qu’« on demande à l’usager de s’adapter au service public, [alors que] l’une des règles du service public, c’est de s’adapter aux usagers. Là, il y a un renversement : l’usager doit savoir faire et la responsabilité finale du bon fonctionnement de la démarche lui incombe ».
Dans l’introduction du rapport, Claire Hédon rappelle un autre paradoxe. « Les démarches numériques apparaissent comme un obstacle parfois insurmontable pour les personnes en situation de précarité sociale alors même que ce sont celles pour lesquelles l’accès aux droits sociaux et aux services publics revêt un caractère vital. » Le risque : aggraver encore le phénomène de « non-recours »
Les personnes âgées, étrangères et détenues sont particulièrement vulnérables aux effets de cette dématérialisation. Faute de parvenir à décrocher un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement d’un titre de séjour, certaines se retrouvent sans récépissé et ont pu perdre leur emploi.
Claire Hédon tient à souligner que « chacun d’entre nous peut, un jour, rencontrer un blocage incompréhensible face à un formulaire en ligne, ne pas parvenir à joindre un agent, échouer à dénouer un problème, faute de dialogue ».
Daniel Agacinski, délégué général à la médiation, relève aussi, avec malice, que les sites sont plus ou moins accessibles selon leur objet : les services fiscaux le sont davantage que les sites de prestations sociales ou des préfectures.
Claire Hédon souligne toutefois une amélioration pour les personnes en situation de handicap : « 40 % des sites internet publics leur sont accessibles, même si ça veut dire que 60 % ne le sont pas. Mais c’est un progrès par rapport à notre dernier rapport, où c’était 12 %. Mais on n’est pas du tout encore 100 % accessibles. »
La dématérialisation doit se faire au bénéfice de tous les usagers, et non au détriment d’une partie.
Des solutions contre l’exclusion ont été proposées, comme les espaces France Services, mis en place pour garantir un accès aux services publics. Mais là encore, la Défenseure des droits pointe l’un des défauts majeurs du dispositif : les agent·es présent·es ne sont pas formé·es à tous les services et peuvent se trouver démuni·es face à certaines démarches complexes. « Ce n’est pas notre rôle de les évaluer mais ce serait bien que ce soit fait… », recommande Claire Hédon.
Le manque de vacataires, pour cause de difficulté à les recruter, s’avère une source d’inquiétude. La Défenseure des droits a d’ailleurs indiqué garder un œil sur les acteurs privés qui capitalisent sur les difficultés de certain·es à réaliser des démarches . « Je suis choquée par ça, l’accès aux services publics doit rester gratuit. » Il revient à la répression des fraudes d’agir, précise Daniel Agacinski.
Autre regret : la Plateforme Solidarité numérique créée pour lutter contre l’illectronisme, vient de fermer ses portes. LesPasses numériques sont tout de même considérés comme une amélioration.
Pour rectifier la situation générale, la Défenseure des droits formule des préconisations et souhaite s’appuyer sur deux jambes « pour contribuer à ce que la dématérialisation se fasse au bénéfice de tous les usagers, et non au détriment d’une partie d’entre eux ».
Cela passe, selon elle, par un maintien du double accès aux services publics, le numérique ne pouvant être l’unique voie. Cet « omnicanal » (numérique, téléphone, courrier, guichet) n’est pas assez développé. Il faudrait également associer les usagers et usagères précaires à la conception des sites internet pour qu’ils soient accessibles à tous et toutes, engager un travail collectif pour « le droit à la connexion », renforcer les effectifs dans les préfectures débordées, permettre à chacun·e de se rétracter sur la dématérialisation des échanges avec les administrations.
La Défenseure préconise aussi de maintenir un contact sous forme de papier pour les démarches comportant des délais ou des notifications d’attribution, de révision ou de retrait de droits pour qu’aucun choix ne reste figé.
Par Marjorie Cessac, Le Monde du 16 février
Alors qu’une entreprise sur deux a du mal à recruter, beaucoup d’étrangers ont du mal à obtenir un visa de travail. Le volet emploi de l’immigration pèche par son inadéquation aux besoins du marché.
Ils sont artisans, boulangers, restaurateurs, bouchers, soignants. Et toujours un peu plus nombreux à se mobiliser pour empêcher l’expulsion d’un employé immigré sur lequel ils savent compter. Ils sont aussi étrangers mais diplômés en France, parfois chercheurs dans des laboratoires prestigieux, sans pour autant parvenir à renouveler leur titre de séjour condition sine qua non pour pouvoir travailler.
A quelques semaines de l’élection présidentielle, quand les questions identitaires et sécuritaires se mélangent et hystérisent les débats sur l’immigration, ces récits disent une autre histoire : celle de la pénurie de main-d’œuvre, des freins administratifs kafkaïens et de la contribution des immigrés – qu’ils soient diplômés ou pas – à l’économie. Ils racontent leur présence essentielle, comme ces aides-soignantes en « première ligne » applaudies au début de la pandémie. Ils montrent, en creux, à l’autre bout du spectre, la faible affluence des étrangers plus qualifiés. « Ainsi la France, 6e puissance économique mondiale, n’est que 19e au classement mondial “compétitivité et talents” élaboré par [l’école privée de management] l’Insead, qui mesure la capacité d’un pays à attirer, produire et retenir des talents », constatent des économistes dans une note du Conseil d’analyse économique de novembre 2021.
Main-d’œuvre peu qualifiée
L’immigration a toujours rempli un rôle de compensation là où il y avait un vide, où les besoins n’étaient pas satisfaits par la population locale. A la fois sur les métiers pour lesquels la demande s’accroît brusquement et sur ceux qui sont en déclin comme l’artisanat en voie d’être mécanisé ou délocalisé. Certes, depuis l’époque des ouvriers spécialisés (OS) de Renault à Boulogne-Billancourt décrits par le sociologue Abdelmalek Sayad en 1986, le profil des immigrés de travail s’est diversifié. De plus en plus exercent une profession qualifiée, à l’instar des 11,5 % de médecins formés à l’étranger, ou des nombreux ingénieurs informatiques tunisiens.
Mais les étrangers restent surreprésentés dans les métiers les plus difficiles : la moitié d’entre eux travaillent dans le bâtiment et les travaux publics ou dans les services aux particuliers et aux collectivités. Ce sont ces emplois précaires qui ont le plus de mal à recruter à l’heure de la reprise. Exemple, dans les emplois de maison où un poste sur cinq est occupé par une personne étrangère non originaire de l’Union européenne. Et où près de la moitié des employés devrait partir à la retraite avant 2030. « Il ne faudra pas moins de 600 000 recrutements pour compenser ces cessations d’activités », prévenait Marie-Béatrice Levaux, présidente de la Fédération des particuliers employeurs de France (Fepem), dans le cadre de l’enquête parlementaire sur les migrations, en juillet 2021.
Certes tous ces postes ne seront pas pourvus par des immigrés. Mais force est de constater qu’en dépit du chômage, certaines fonctions, pourtant indispensables, ne parviennent plus à attirer les Français. En raison de la précarité grandissante des emplois, de leur longue dévalorisation ou du fait qu’ils sont perçus comme trop contraignants au regard des aspirations nouvelles. « En Europe, le besoin de travailleurs n’est pas seulement lié au vieillissement de la population, souligne Jérôme Vignon, conseiller à l’Institut Jacques Delors, mais aussi à la montée en gamme des qualifications de la population résidente qui, du coup, engendre une baisse de la main-d’œuvre peu qualifiée. »
A la merci des employeurs
Dans ce contexte tendu, la France est régulièrement pointée du doigt pour ne pas avoir suffisamment soigné le volet travail de son immigration. . Face à la montée du chômage, d’autres lois ont poursuivi le même objectif. Entamée en 2019 en vue de fluidifier le recrutement des étrangers, la dernière réforme souffre d’une inadéquation aux besoins immédiats. Si la liste des métiers en tension ouverts aux étrangers a été réactualisée au printemps 2021 – une première depuis quatorze ans –, elle reste très incomplète.
Cette même réforme entend promouvoir le recrutement à l’étranger sans toutefois aborder la question cruciale de l’embauche en France. Attablé devant un café, dans son restaurant Baltard au Louvre, en plein cœur de Paris, Vincent Sitz le déplore : « Embaucher en France est déjà compliqué alors je ne vais pas m’amuser à recruter un plongeur au Mali ou au Sénégal. Ce n’est pas juste une personne pour une tâche, c’est aussi une question de feeling, d’affinité », explique celui qui est aussi président de la commission emploi-formation du Groupement national des indépendants de l’hôtellerie-restauration.
Le secteur compte 220 000 postes vacants : « Nous avons besoin de réactivité, qu’il y ait des courroies de transmission – préfectures, ambassades, personnes dédiées à nos secteurs à Pôle emploi – pour repérer ces profils et nous mettre en lien avec eux. Nous devons aussi absolument développer les formations courtes », insiste-t-il en citant l’exemple réussi de Mariam, en train de dresser une table dans la même salle.
Arrivée de Dakar en France en janvier 2018, cette jeune chef de rang a entamé dès février ce type d’apprentissage rapide avant d’être recrutée à sa sortie, en stage puis comme commis de salle dans cette même entreprise. « Cela fera bientôt quatre ans », calcule-t-elle, consciente que « d’autres n’ont pas eu cette chance ». Comme les nombreux sans-papiers qu’elle connaît.
Adama (le prénom a été changé) était, encore il y a peu, dans ce cas. Ripeur, ce Malien a vécu six ans tapi dans la clandestinité sous l’identité d’un autre avant d’être régularisé lors d’une grève fin octobre à Sepur, une entreprise de collecte des déchets alors sous le coup d’une enquête de l’inspection du travail. « J’ai travaillé dans plein de domaines, surtout dans la sécurité vu mon gabarit, raconte-t-il, mais avec Sepur, j’ai connu le pire. » « Horaires de repos jamais respectés », « un salaire jamais exact » : « Chaque fois que je réclamais mon dû, ils me menaçaient, ou ils me renvoyaient vers l’agence d’intérim que personne ne connaissait, j’étais obligé de me taire », poursuit-il.
Certains employeurs abusent de ces irréguliers qui, la peur au ventre, n’ont d’autre choix que d’être corvéables à merci. D’autres craignent un « appel d’air » s’ils procèdent à des régularisations. Nombre redoutent tout bonnement de voir le salarié leur échapper une fois qu’ils l’auront fait, sachant que la législation leur donne la possibilité de demander sa régularisation.
« C’est un point primordial, note Marilyne Poulain, pilote du collectif Immigration à la CGT. Si l’employeur a tissé un lien privilégié avec son salarié ou son apprenti, il lui arrive de se mobiliser pour lui. En revanche, dans les grosses boîtes d’intérim, les géants du nettoyage ou du BTP, qui brassent le plus de main-d’œuvre étrangère, ces travailleurs régularisés ou sans papiers continuent de n’être que des pions subordonnés à l’employeur qui a tout pouvoir sur lui. » Les rares employeurs à vouloir adopter une démarche légaliste se heurtent « à une forme d’impasse », « à des préfectures complètement engorgées et inaccessibles », ajoute celle qui soutient de nombreuses grèves en faveur des sans-papiers.
Former les réfugiés
Si les travailleurs sans-papiers constituent un sujet hautement politique et miné, il est un statut qui bénéficie d’une protection administrative, qui rassure les employeurs, et pour lequel le Medef s’est impliqué, c’est celui de réfugié. Dès 2015, quand plus de 1 million de migrants sont arrivés en Europe à la suite du conflit syrien notamment, plusieurs initiatives ont émergé en vue de leur intégration professionnelle.
Des fédérations professionnelles comme celle du bâtiment ont lancé, en 2018, des projets comme le plan « 15 000 bâtisseurs » visant à recruter des jeunes, des demandeurs d’emploi mais aussi des réfugiés. Des programmes public-privé comme celui de HOPE ( Hébergement, orientation, parcours vers l’emploi) ont également vu le jour à leur attention.
Sayed et Berhane ont pu en bénéficier. Les deux hommes n’ont pas suivi les mêmes routes migratoires, mais leurs chemins se sont croisés au centre de formation professionnelle pour adulte (AFPA) de Grenoble, où ils suivaient des cours de français et apprenaient un métier en tension. « Nous avons suivi la formation de maçon “VRD”, épelle Berhane, 43 ans. Voirie et réseaux divers. Pour moi, c’était assez simple, car en Erythrée, j’étais dans l’armée et déjà dans la construction. »
A ses côtés, Sayed, 30 ans, a dû reprendre tout à zéro. « Moi, j’ai étudié l’hydrométéorologie. En Afghanistan, je faisais des statistiques pour l’ONU. A présent, ma priorité est de bien parler français », poursuit le jeune homme qui a fui l’avancée talibane. Tous deux sont en contrat de professionnalisation auprès d’une agence d’intérim.
Ces initiatives, qui se comptent seulement en milliers, remportent l’adhésion des employeurs. Un succès sans commune mesure avec les résultats de l’Allemagne, qui, en 2021, avait réussi, grâce à l’apprentissage, à faire employer la moitié du 1,6 million de réfugiés. « Au départ, les entreprises étaient frileuses, reconnaît Pascale Gerard, directrice diversité et intégration à l’AFPA. Mais aujourd’hui, elles sont de plus en plus nombreuses à venir vers nous pour recruter. » L’objectif, pour 2022, est d’embaucher 1 500 réfugiés.
Certaines multinationales se mobilisent publiquement. Douze d’entre elles comme Sodexo, L’Oréal, Ipsos ou Accor, ont rejoint le réseau international Tent Partnership for Refugees qui promeut les talents et le profil singulier de ces étrangers. « Celles que nous avons interrogées ne se sont toutefois pas encore livrées à de réels engagements chiffrés d’embauches », relèvent Sophie Bilong et Frédéric Salin, deux chercheurs qui ont mené une étude pour l’Institut français des relations internationales auprès de dix-huit d’entre elles.
« Celles qui en font le plus ne sont pas forcément dans cette coalition », rappellent-ils, comme certaines PME particulièrement actives dans l’embauche des femmes. Après avoir enquêté auprès de réfugiés ayant acquis un titre de séjour depuis un an, ils ont constaté que leurs conditions de travail restaient encore « précaires, instables, insatisfaisantes ». Elles sont souvent marquées par un « déclassement professionnel » par rapport à leur situation dans leur pays d’origine.
Attirer sans conditions
Faute de ne pas suffisamment valoriser les qualifications des étrangers, la France se priverait d’une immigration économique optimale, d’autant que sa politique est implicitement pensée pour le court terme, selon les experts. « S’il faut faciliter l’obtention de visas sur ces métiers en tension, sur lesquels les natifs ne veulent plus aller, comme l’ont fait les Anglais lorsqu’ils ont accordé 10 000 visas à des chauffeurs routiers, pour éviter des pertes, des désorganisations et des délocalisations, cela ne saurait suffire, reconnaît Jérôme Valette, économiste et maître de conférences à la Sorbonne. Il faut aussi, sur le long terme, être en mesure d’attirer des immigrés très qualifiés sans condition d’emploi car c’est l’immigration la plus à même d’avoir des effets bénéfiques sur l’économie dans son ensemble, en favorisant l’innovation et la création d’entreprise notamment. »
Pour ce faire, François Hollande avait créé le « passeport talent », destiné aux plus hautement qualifiés. Le dispositif, renforcé, a bénéficié à 9 552 étrangers en 2019, dont 53 % de scientifiques. Mais certains économistes comme ceux du Conseil d’analyse économique engagent à plus d’efforts. Y compris à destination des étudiants : « En étendant, écrivent-ils, l’octroi d’un titre de séjour à l’issue des études, notamment des très qualifiés, sans y adjoindre des critères de salaire minimum, ni d’adéquation du travail aux qualifications. » Dans bien des pays, nombre de prix Nobel n’auraient pu être décrochés sans ces scientifiques ou artistes venus d’ailleurs. Ainsi au Royaume-Uni : sur les 45 primés depuis 1969, quinze étaient nés à l’étranger !
Ellen Salvi, 1 mars 2022
« L’hypocrisie, toujours la même. » Cédric Herrou n’a pas caché son écœurement en découvrant le message posté, samedi dernier, par le maire de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes) en solidarité avec la population ukrainienne. « Le même maire qui a fait sa campagne électorale contre l’accueil que nous avions fait pour d’autres populations victimes de guerres. Seule différence, ces populations étaient noires », a réagi l’agriculteur, l’un des symboles de l’aide aux migrants, grâce auquel la valeur constitutionnelle du principe de fraternité a été consacrée en 2018.
Un principe qui se rappelle depuis quelques jours au souvenir de nombreuses personnes qui semblaient l’avoir oublié, trop occupées qu’elles étaient à se faire une place dans un débat public gangréné par le racisme et la xénophobie. Il y a deux semaines, lorsque la guerre russe était un spectre lointain et que la campagne présidentielle s’accrochait aux seules antiennes d’extrême droite, rares étaient celles à souligner que la solidarité n’est pas une insulte et qu’elle ne constitue aucun danger.

Des réfugié·es ukrainien·nes attendent de monter dans un bus au point de contrôle de la frontière moldo-ukrainienne près de Palanca, le 1er mars 2022.Les mêmes qui jonglaient avec les fantasmes du « grand remplacement » et agitaient les questions migratoires au rythme des peurs françaises expliquent aujourd’hui que l’accueil des réfugiés ukrainiens en France est un principe qui ne se discute pas. À l’exception d’Éric Zemmour, dont la nature profonde – au sens caverneux du terme – ne fait plus aucun mystère, la plupart des candidat·es à la présidentielle se sont prononcé·es en faveur de cet accueil, à quelques nuances près sur ses conditions.
Mais parce que le climat politique ne serait pas le même sans ce petit relent nauséabond qui empoisonne toute discussion, des responsables politiques et des éditorialistes se sont fourvoyés dans des explications consternantes, distinguant les réfugiés de l’Est de ceux qui viennent du Sud et du Moyen-Orient. Ceux auxquels ils arrivent à s’identifier et les autres. Ceux qui méritent d’être aidés et les autres. Les bons et les mauvais réfugiés, en somme.
Ainsi a-t-on entendu un éditorialiste de BFMTV expliquer que cette fois-ci, « il y a un geste humanitaire immédiat, évident […] parce que ce sont des Européens de culture » et qu’« on est avec une population qui est très proche, très voisine », quand un autre soulignait qu’« on ne parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien [mais] d’Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essaient de sauver leur vie, quoi ! »
C’est pas du racisme, c’est la loi de la proximité.
Olivier Truchot, présentateur des « Grandes Gueules »Dès le 25 février, sur Europe 1, le député MoDem Jean-Louis Bourlanges, qui n’occupe rien de moins que la présidence de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, avait quant à lui indiqué qu’il fallait « prévoir un flux migratoire ». Mais attention : « ce sera sans doute une immigration de grande qualité », avait-il pris soin de préciser, évoquant « des intellectuels, et pas seulement ». Bref, « une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit ».
Ces propos ont suscité de vives réactions que l’éditorialiste de BFMTV et l’élu centriste ont balayées avec la mauvaise foi des faux crédules mais vrais politiciens, le premier les renvoyant à « la gauche “wokiste” » – un désormais classique du genre –, le deuxième à « l’extrême gauche » – plus classique encore, éculé même. « Il faut avoir un esprit particulièrement tordu pour y voir une offense à l’égard de quiconque », a ajouté Jean-Louis Bourlanges, aux confins du « on ne peut plus rien dire ».
C’est vrai enfin, s’indignerait-on aux « grandes Gueules », « c’est pas du racisme, c’est la loi de la proximité ». D’ailleurs, le même type de commentaire a fleuri dans des médias étrangers, tels CBS News, Al Jazzeera, la BBC ou The télégraph, comme autant de « sous-entendus orientalistes et racistes » condamnés par l’Association des journalistes arabes et du Moyen-Orient (Ameja). Preuve, s’il en fallait, que le racisme – pardon, « la loi de proximité » – n’est pas une exception française. Des initiatives qui tranchent singulièrement avec les politiques à l’œuvre depuis des années.
Suivant la directive d’Emmanuel Macron qui a confirmé que « la France prendra sa part » dans l’accueil des réfugiés ukrainiens, le gouvernement multiplie lui aussi les communications depuis quelques jours, le plus souvent par la voix du ministre de l’intérieur. Ces réfugiés sont « sont les bienvenus en France »a ainsi déclaré Gérald Darmanin lundi, avant d’appeler « tous les élus […] à mettre en place un dispositif d’accueil » et à « remonter, les associations, les lieux d’hébergement au préfet ».
Dans le même élan de solidarité, la SNCF a annoncé que les réfugiés ukrainiens pourraient désormais « circuler gratuitement en France à bord des TGV et Intercités ». « Belle initiative de la SNCF mais je rêve d’une solidarité internationale étendue à TOUS les réfugiés, qu’ils fuient la guerre en Ukraine ou des conflits armés en Afrique ou encore au Moyen-Orient. Les réfugiés ont été et sont encore trop souvent refoulés et maltraités », a réagi la présidente d’Amnesty International France, Cécile Coudriou
Car au risque de sombrer dans le « wokisme » – ça ne veut rien dire, mais c’est le propre des appellations fourre-tout –, on ne peut s’empêcher de noter que ces initiatives, plus que nécessaires, tranchent singulièrement avec les politiques à l’œuvre depuis des années au détriment des exilé·es : l’absence de dispositif d’accueil digne de ce nom ; le harcèlement quasi quotidien de la part des forces de l’ordre, qui lacèrent des tentes, s’emparent des quelques biens, empêchent les distributions de nourriture ; le renforcement permanent des mesures répressives…
Or comme l’écrivait récemment la sociologue et écrivaine Kaoutar Harchi, « un accueil digne, une aide sans condition, un accès immédiat à des repas, à des soins, à des logements, un soutien psychologique, devraient être accordés à toute personne qui est en France et qui souffre. Mais c’est sans compter le racisme qui distribue l’humanité et l’inhumanité ». C’est bien lui qui se profile aujourd’hui derrière la solidarité retrouvée de certain·es.
Le 16 août 2021, alors que les images d’Afghans s’accrochant au fuselage d’avions pour fuir l’avancée des talibans faisaient le tour du monde, Emmanuel Macron déclarait : « L’Afghanistan aura aussi besoin dans les temps qui viennent de ses forces vives et l’Europe ne peut pas à elle seule assumer les conséquences de la situation actuelle. Nous devons anticiper et nous protéger contre les flux migratoires irréguliers importants. » Imagine-t-on cette phrase prononcée dans le contexte actuel ? La réponse est évidemment non. Et son corollaire fait honte.
L’appel à candidatures est reconduit jusqu’au 28 mars minuit !
Vous avez le goût de vous engager dans le soutien d’un réseau associatif en soutien aux personnes exilées bloquées à la frontière franco-britannique ? C’est ici !
La Plateforme des Soutiens aux Migrant.e.s recrute un.e chargé.e de mission en charge des formations, et de la valorisation et mobilisation des outils et expériences du réseau associatif à la frontière franco-britannique.
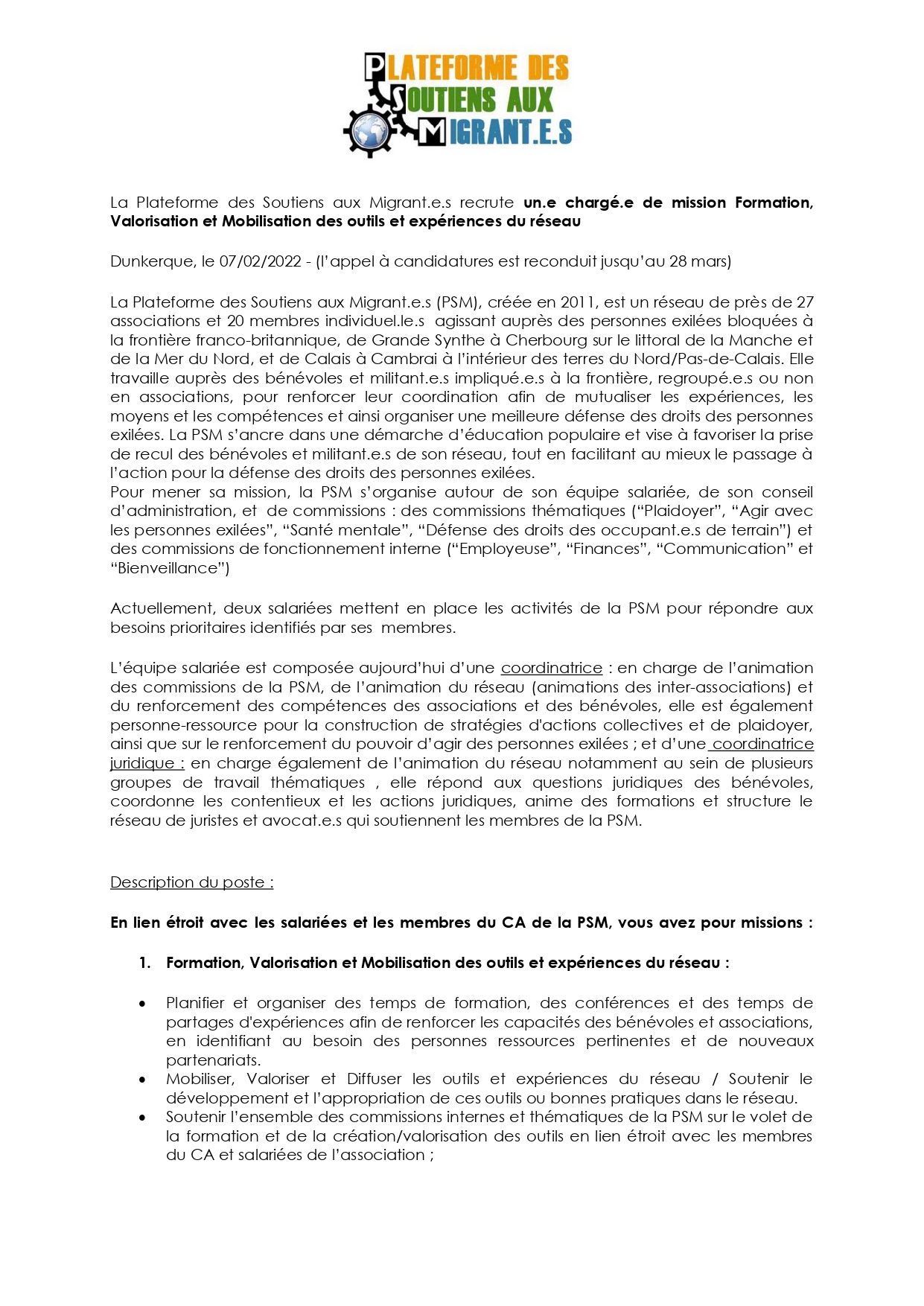
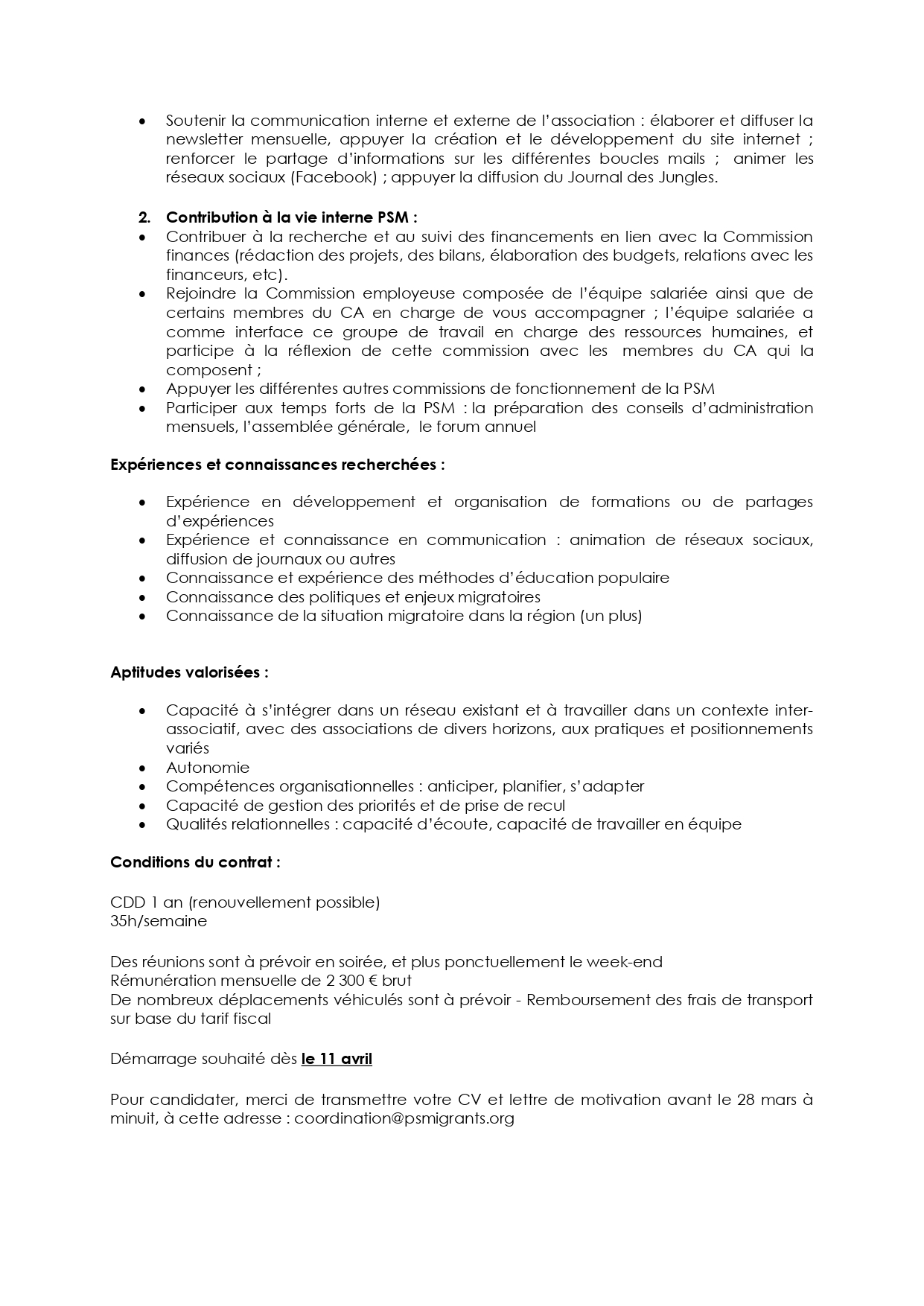
Migrations : Il faut mettre fin à « la politique qui ne génère que maltraitance et violence », créée par les accords du Touquet
Tribune, Le Monde, publiée le 4 février 2022
Collectif
Signé il y a dix-neuf ans par Paris et Londres, ce texte fait de la France le « bras policier » de la politique migratoire du Royaume-Uni pour empêcher les personnes exilées de traverser la Manche, dénoncent une trentaine d’ONG dans une tribune au « Monde ».
Tribune. Depuis plusieurs décennies, des hommes, des femmes et des enfants originaires d’Europe de l’Est, d’Afrique de l’Est, du Moyen-Orient ou d’Asie du Sud-Est, toutes et tous en recherche de protection, survivent sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord. La plupart de ces personnes exilées présentes sur nos côtes n’ont qu’un seul objectif : franchir – par tous les moyens – la frontière qui se dresse devant elles et qui les empêche de rejoindre le Royaume-Uni.
Il y a dix-neuf ans, le 4 février 2003, à la suite de la fermeture du centre de Sangatte et dans le prolongement du traité de Canterbury du 12 février 1986, la France et le Royaume-Uni signent le traité du Touquet. La frontière britannique est externalisée sur le sol français moyennant des financements de la Grande-Bretagne. La France devient le « bras policier » de la politique migratoire du Royaume-Uni pour empêcher les personnes exilées de traverser la Manche.
Expulsions, confiscations
Sur les côtes françaises, les autorités mettent en œuvre une politique de lutte contre la présence des personnes exilées et d’invisibilisation de celles-ci. Les maltraitances quotidiennes qu’elle implique sont nombreuses : expulsion de lieux de vie, confiscation d’affaires, maintien à la rue en l’absence de services permettant de couvrir leurs besoins fondamentaux, entrave à l’action des associations, etc.
Cette politique n’est pas seulement indigne et inacceptable, elle est également mortelle : au moins 342 personnes ont perdu la vie à la frontière franco-britannique depuis 1999, dont 36 en 2021. La poursuite année après année de cette politique inhumaine, la répétition de ces maltraitances et de ces drames pourraient nous pousser au fatalisme. Au contraire, nous agissons pour l’amélioration de la situation, pour le respect des droits et de la vie des personnes en exil.
C’est dans cet esprit que la Plate-forme des soutiens aux migrant·e·s, dont nous sommes membres ou que nous soutenons, a demandé à l’anthropologue Marta Lotto (« On The Border, la vie en transit à la frontière franco-britannique ») et au politologue Pierre Bonnevalle (« Enquête sur trente ans de fabrique politique de la dissuasion : l’Etat français et la gestion de la présence des personnes exilées dans la frontière franco-britannique. Harceler, expulser, disperser ») d’enquêter, pour l’une, sur les conditions de vie des personnes en transit et, pour l’autre, sur la gestion par les autorités françaises de la présence des personnes exilées à la frontière [présentation des deux rapports le 4 février, à l’université du Littoral-Côte d’Opale (ULCO), à Dunkerque].
Leurs analyses fines nous permettent une compréhension globale de la situation et nous contraignent, nous citoyens, à mettre les autorités face à leurs responsabilités et à leur imposer la mise en œuvre d’une politique alternative.
Aux portes de leur rêve
En effet, Marta Lotto, dans son rapport, nous indique que les raisons pour lesquelles ces personnes sont à Calais (Pas-de-Calais), Grande-Synthe (Nord), Ouistreham (Calvados) ou, pour d’autres, moins nombreuses, à Norrent-Fontes (Pas-de-Calais), Steenvoorde (Nord) ou Cherbourg (Manche), sont diverses.
Certaines ont commencé leur parcours migratoire avec l’objectif de vivre en Grande-Bretagne ; après un périple de quelques jours ou de plusieurs années, elles se retrouvent bloquées aux portes de leur rêve.
D’autres, au contraire, n’ont jamais imaginé aller en Grande-Bretagne, mais les circonstances de leur parcours les ont conduites aux portes de ce pays, qui est alors devenu le dernier recours face aux rejets auxquels elles ont été confrontées ailleurs en Europe.
Depuis trente ans, sans cesse, parce qu’elles veulent rejoindre leur famille, parce qu’elles sont anglophones ou parce qu’elles nourrissent de vains espoirs d’accéder à une vie meilleure, des personnes tentent de franchir les quelques dizaines de kilomètres qui les séparent de la Grande-Bretagne.
Barbelés et lames de rasoir
En dehors de la parenthèse 2015-2016, quand le tumulte du monde a poussé plus d’un million de personnes vers l’Europe, et une partie d’entre elles vers la Grande-Bretagne, il y a toujours eu entre 1 000 et 3 000 personnes en transit bloquées à la frontière.
Et, pourtant, ce n’est pas faute, pour les autorités françaises et britanniques, d’avoir tenu un discours de fermeté et mis en œuvre une politique de dissuasion. De manière très détaillée, le politologue Pierre Bonnevalle nous révèle que, depuis trente ans, quels que soient les gouvernements, une seule et même politique est menée : rendre les territoires situés sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord aussi inhospitaliers que possible.
Nous avons donc vu pousser des barrières et des barbelés, nous avons appris ce qu’était une « concertina », ces barbelés couplés à des lames de rasoir. Nous avons vu des arbres abattus et des maisons murées. Nous avons aussi appris que mise à l’abri pouvait être synonyme d’expulsions violentes, et que la solidarité pouvait être un délit.
Atteintes toujours plus fortes à la dignité, violation des droits des personnes exilées et destruction de l’attractivité de nos territoires sont les seuls résultats de cette politique. Vient s’ajouter le reniement constant et systématique de nos valeurs, celles qui fondent notre vivre-ensemble. N’est-elle alors que communication ? Une mise en scène pour montrer que l’Etat agit ? Mais qu’est-ce qu’une politique qui ne génère que maltraitance et violence ?
Un dialogue citoyen
Face à ce constat d’un échec flagrant de la politique mise en œuvre à la frontière franco-britannique, face à la violence qu’elle engendre pour les personnes exilées, mais aussi pour toutes celles qui vivent sur ces territoires, nous devons, aujourd’hui, regarder la réalité en face.
Pour que ces personnes vivent dans des conditions dignes, pour que nos territoires ne soient plus constellés de campements et de bidonvilles, pour que nos valeurs soient respectées, le paradigme des politiques publiques mises en œuvre à la frontière doit changer. Ces deux rapports, mais surtout les maltraitances qui s’exercent chaque jour sur notre sol, nous incitent à l’exiger.
Pour obtenir ce changement de modèle, nous devons, ensemble, engager un dialogue citoyen réunissant l’ensemble des forces vives des territoires du littoral de la Manche et de la mer du Nord et imaginer, collectivement, une politique respectueuse des droits de toutes et tous.
Nous appelons toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre pour lancer cette dynamique de convention citoyenne à la frontière franco-britannique.
Principaux signataires : Sylvie Bukhari-de Pontual, présidente du CCFD-Terre solidaire ; Chrystel Chatoux, coprésidente d’Utopia 56 ; François Guennoc, président de l’Auberge des migrants ; Henry Masson, président de la Cimade ; Martine Minne, présidente d’Attac Flandres ; docteure Carine Rolland, présidente de Médecins du monde ; Malik Salemkour, président de la Ligue des droits de l’homme (LDH) ; Antoine Sueur, président d’Emmaüs France ; Corinne Torre, chef de mission de la mission France de Médecins sans frontières ; Véronique Devise, présidente du Secours catholique-Caritas France.
Liste complète des signataires : https://archives.psmigrants.org/site/tribune-accords-du-touquet-fevrier-2003-a-fevrier-2022-mettons-fin-a-la-violence-et-a-linhumanite/
Un an après le démantèlement des principaux camps de la capitale, faute de mise à l’abri, des squats fleurissent en banlieue parisienne dans des bâtiments désaffectés et insalubres, comme à Vitry-sur-Seine ou à Thiais, dans le Val-de-Marne.
Par Pierre Terraz
Publié le 10 décembre 2021
« Dans la rue, un homme m’a proposé de m’héberger si je couchais avec lui. J’ai refusé, j’ai dormi dehors pendant deux mois, puis je suis arrivé ici. » Comme Amadou (les prénoms ont été modifiés), originaire de Côte d’Ivoire, ils seraient plus de 200 migrants à occuper ce squat installé il y a six mois dans des bureaux désaffectés, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne).
En juin, une demande d’expulsion avait été prononcée, jamais mise en application faute de projet concret pour le bâtiment, promis à la démolition. Aucune convention d’occupation n’a non plus été signée, mais l’association United Migrants, qui encadre le lieu, espère encore pouvoir le pérenniser après la fin de la trêve hivernale, le 31 mars 2022.
Des squats comme celui-ci, il en fleurit de plus en plus depuis le démantèlement des principaux camps de la capitale, il y a un an. Un phénomène difficile à quantifier, tant il est imperceptible, mais en progression constante, relatent les acteurs de terrain. En France, au moins 177 bâtiments auraient été occupés en 2021, selon le dernier rapport de l’Observatoire des expulsions de lieux de vie : c’est trois fois plus qu’en 2020.
« Autour de Paris, on comptabilise encore plus de 1 200 migrants éparpillés dans des squats et micro-campements, explique aussi Paul Alauzy, chargé de projets à l’association Médecins du monde. Il y a eu un déplacement de la population : là où on intervient désormais, on retrouve les mêmes individus que dans les anciens camps démantelés de Paris. » Si les tentes ont quasiment disparu du paysage parisien, les exilés, eux, se voient donc contraints de se replier dans les recoins cachés d’Ile-de-France.
Misère invisible
Au cœur de la zone industrielle de Vitry-sur-Seine, il faut pousser une porte en fer derrière un amas d’ordures afin de pénétrer les lieux. Alors qu’il n’y a pas de voisins directs, mis à part des entrepôts, les volets restent pourtant fermés : impossible de se douter que quelqu’un vit ici. « Le but n’est pas d’être excessivement visible », euphémise Romain Prunier, représentant de l’association United Migrants.
Occupés depuis mai par des migrants d’origine africaine, les bureaux ont été reconvertis en chambres. Dans l’une d’elles, une famille de quatre Ivoiriens partage la pièce plongée dans l’obscurité : « Nous sommes en France depuis 2019, mais notre demande d’asile a été déboutée. Notre enfant ne va pas à l’école. J’ai travaillé plusieurs fois au “black”, on m’a arnaqué à chaque fois. Je faisais le ménage dans les bureaux d’une grande entreprise de vin, une connaissance qui a les papiers me faisait travailler sur son contrat, à sa place. Les deux derniers mois, il a arrêté de m’envoyer l’argent », témoigne le père.
Cette impossibilité de s’intégrer légalement, sans papiers, semble n’être qu’une composante de la précarité des occupants du lieu. Dans une chambre où vivent huit Soudanais, demandeurs d’asile, le plus jeune manifeste sa difficulté à apprendre la langue : « Je suis en France depuis cinq ans, mais je ne trouve pas de bon professeur de français. »
Ce qui fait l’unanimité, surtout, reste la difficulté à trouver un toit correct. Une mère de famille algérienne, dépourvue de titre de séjour, explique : « Le 115 ne marche pas ! On nous donne des adresses très loin de Paris, à plus d’une heure de transports en commun. Je n’ai pas de téléphone, pas Internet… je ne sais pas comment y aller. Je me rappelle une fois où j’étais perdue, à 2 heures du matin, avec ma petite fille dans la poussette. » Jean, un Congolais de 35 ans, ajoute : « Pour les hommes seuls, c’est très compliqué. On te met deux ou trois jours quelque part, puis tu dois partir. Parfois, tu tombes dans des centres où il y a des bagarres. Ici, plus personne ne fait appel au 115. »
Si l’habitat en squat semble permettre un meilleur ancrage territorial et une certaine stabilité, l’isolement communautaire qui en découle détache aussi ses occupants, qui ne font plus confiance aux institutions, du droit commun.
Pour Kerill Theurillat, coordinateur de Utopia 56 à Paris, l’émergence de ce type d’occupation n’a rien d’un hasard, outre la saturation des dispositifs d’accueil (l’Ile-de-France comptabilise 46 % de la demande d’asile, pour seulement 19 % des places d’hébergement). « C’est aussi une manière d’invisibiliser les gens. Les seules fois où ils ne sont pas délogés, c’est quand ils sont dans des squats ou que les camps sont installés sous des ponts, loin des riverains. Pour moi, c’est une politique délibérée », assure-t-il.
Conflits de voisinage
A Thiais, ville aisée du Val-de-Marne, l’ambiance est plus électrique dans le voisinage. En octobre, 228 migrants de tous statuts (sans-papiers, demandeurs d’asile, déboutés…) se sont mis à y occuper une résidence désaffectée, au cœur d’un quartier pavillonnaire.
Depuis, le squat, également encadré par United Migrants, attise la colère des riverains. « J’habite ici depuis 1973. Ils ont débarqué une nuit, et depuis, on n’est plus tranquilles. Le bâtiment n’est pas aux normes de sécurité incendie. Imaginez qu’il prenne feu, notre maison aussi partira en fumée », s’inquiète une dame vivant dans une habitation mitoyenne. Une voisine tempère : « C’est surtout le fait que ce ne soit pas encadré par les pouvoirs publics qui me gêne… Si ça continue comme ça, on va finir à 500 personnes ! Il n’y a eu aucun problème majeur pour le moment, mais j’ai peur pour l’avenir. »
Certains avancent leurs théories. « La préfecture de police a refusé d’intervenir dans les quarante-huit heures, délai légal pour une expulsion immédiate, et le maire de Thiais ne peut rien faire car le bâtiment appartient à la Ville de Paris. En désaffectant le bâtiment, ils n’ont barricadé que trois fenêtres, et une semaine avant l’arrivée des migrants, du personnel est venu faire le ménage. Certaines personnes avec des postes à responsabilité nous ont dit qu’il était fort probable que ce soit organisé : Paris se débarrasse de ses campements pour les JO [Jeux olympiques] de 2024 », assure un riverain.
Face à ces inquiétudes, le maire (Les Républicains) de Thiais, Richard Dell’Agnola, voudrait déplacer les occupants au plus vite. Problème : l’ancienne résidence pour personnes âgées appartient effectivement à la Ville de Paris, qui ignore jusqu’ici les revendications de l’élu.
La municipalité parisienne, elle, défend le bon état du bâtiment, qui ne justifie pas une expulsion alors que la trêve hivernale a commencé, mais un rapport commandé par Richard Dell’Agnola conclut une note de 5/18 en matière de sécurité. Electricité défaillante, risque d’incendie, présence d’amiante, extrême surpopulation… Certains occupants dorment dans les sous-sols, sans fenêtre ni aération. « Légalement, le problème sécuritaire prédomine et annule la trêve hivernale », proteste le maire de Thiais.
Un « problème de responsabilité politique »
L’association United Migrants a pu rencontrer Léa Filoche, adjointe à la Mairie de Paris chargée des solidarités, de la lutte contre les inégalités et contre l’exclusion. Paris aurait-il avantage à installer les migrants dans ce squat plutôt que de les reloger de manière conventionnelle ? L’adjointe proteste et souligne la responsabilité de l’Etat dans l’hébergement des sans-abri : « La doctrine de Paris est simplement de ne pas évacuer tant que nous n’avons pas de solution de remise à l’abri. Contrairement aux manières du préfet de police, Didier Lallement, qui pousse volontiers les campements en dehors de la capitale ou les planque dans des tunnels aux conditions de salubrité affreuses, sous le périphérique. Laisser ces gens à la rue, c’est le choix de l’Etat, pas celui de la Ville de Paris. » Si la Mairie de Paris ne compte pas déplacer les squatteurs, elle a quand même déposé plainte contre l’occupation : un moyen de se protéger en cas d’incident à l’intérieur de son bâtiment.
La préfecture d’Ile-de-France, elle, n’a pas souhaité réagir, et refuse de communiquer le nombre de migrants à la rue qu’elle recense en région parisienne. Mais elle se félicite de la mise en place des « orientations régionales », un programme visant à proposer des hébergements en régions afin de désengorger la capitale. « Depuis l’entrée en vigueur de ce nouveau schéma d’accueil, le 1er janvier 2021, 13 822 orientations régionales ont été réalisées. Il s’agit d’un effort sans précédent de prise en charge », se réjouit l’un de ses représentants.
Reste à voir la mise en pratique : en septembre, 670 migrants évacués d’un camp parisien étaient déplacés en bus hors de la capitale, sans être informés de leur destination. Certains ont fini en centre de rétention.
Richard Dell’Agnola dénonce un « problème de responsabilité politique qui fait subir le problème à la banlieue ». Pour Kerill Theurillat, d’Utopia 56, ce phénomène révèle plus largement un problème structurel dans l’accueil des réfugiés en France : « Le naufrage qui a eu lieu à Calais [Pas-de-Calais], on en trouve les causes ici. Les gens ne poursuivent pas un “rêve anglais”… Après des mois sans solution, ils fuient tout simplement les conditions de vie en France. Des drames, je suis sûr qu’il va en y avoir d’autres. » Selon l’Observatoire des expulsions de lieux de vie informels, 91 % des expulsions effectuées entre novembre 2020 et octobre 2021 n’ont fait l’objet d’aucune mise à l’abri, ou d’une mise à l’abri partielle.
Pierre Terraz