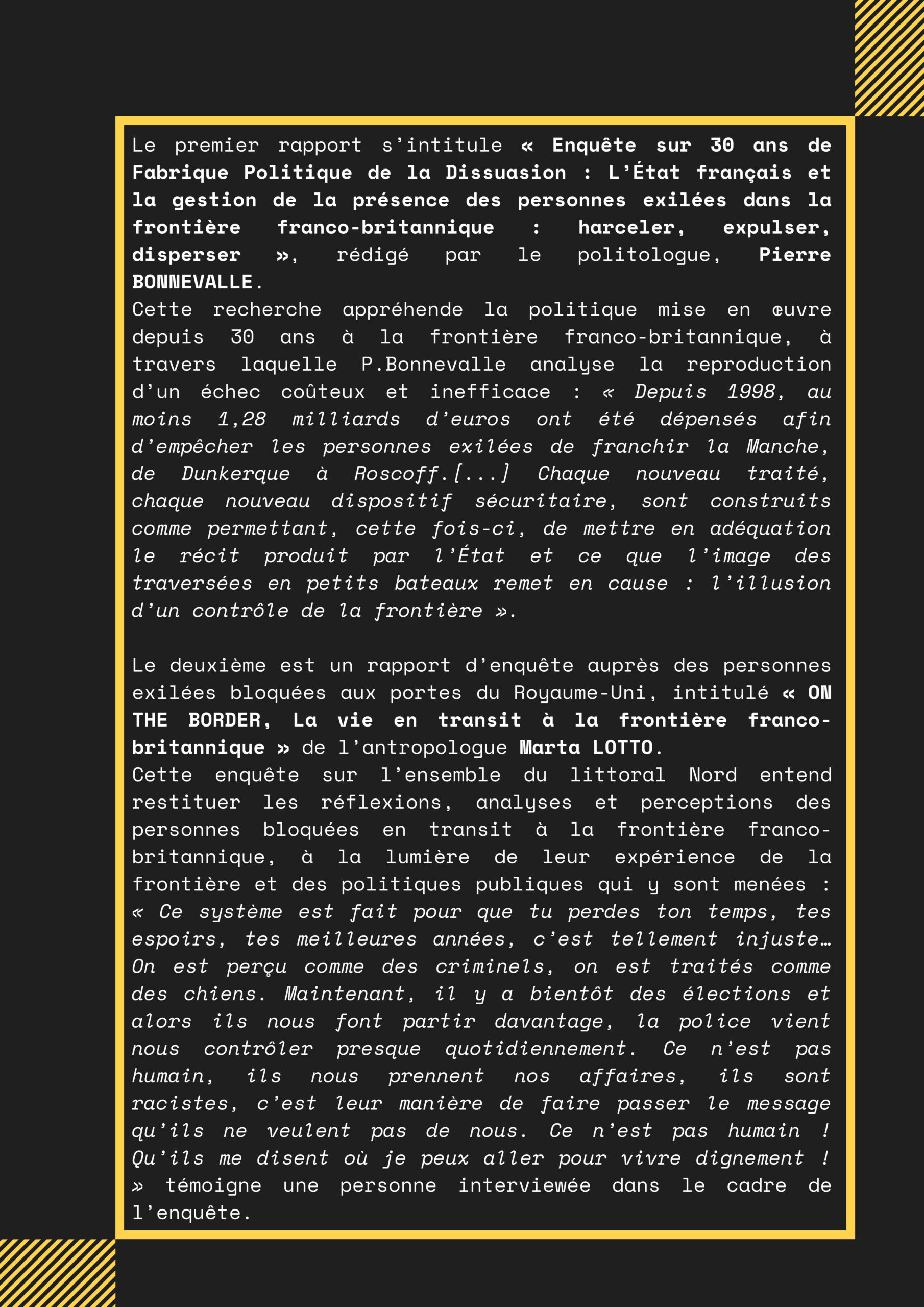Archives de catégorie : Non classé
Au Kurdistan irakien, les rêves d’ailleurs d’une jeunesse désespérée [Le Monde, 28.12.2021]
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/28/au-kurdistan-irakien-les-reves-d-ailleurs-d-une-jeunesse-desesperee_6107465_3210.html
Au Kurdistan irakien, les rêves d’ailleurs d’une jeunesse désespérée
 LAURENCE GEAI POUR « LE MONDE »
LAURENCE GEAI POUR « LE MONDE »
Reportage
Sans avenir, les candidats à l’exil quittent en nombre cette région autonome située dans le nord-est de l’Irak et tentent de gagner l’Europe, souvent au péril de leur vie.
Sur le profil Instagram de Muhammed Fatah Muhammed, une phrase est écrite en anglais : « Des jours meilleurs vont arriver. » Loin, sans doute, du centre-ville de Halabja, ville kurde dans le nord-est de l’Irak, où ce jeune homme de 23 ans au regard doux, le visage fin et barbu, travaille dans un petit restaurant. « De 5 heures du matin jusqu’à 15 h 30, précise-t-il. Et, au mieux, je gagne 6 euros par jour. » Aujourd’hui, comme de nombreux autres jeunes, Muhammed n’a qu’un rêve : quitter le Kurdistan d’Irak pour l’Europe, où vit déjà « une centaine »de ses amis et connaissances. Chaque jour, d’autres continuent de partir, souvent au péril de leur vie. Des milliers de migrants bloqués à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne étaient originaires de cette même région autonome du nord de l’Irak. Le 26 décembre encore, les corps de seize migrants kurdes, noyés dans la Manche un mois plus tôt, alors qu’ils cherchaient à joindre l’Angleterre, ont été rapatriés à Erbil.
Parmi les amis de Muhammed, beaucoup ont emprunté les routes de l’exil. « Au Royaume-Uni, il y en a un qui travaille aujourd’hui comme coiffeur. Il a réussi à acheter une maison pour ses parents ici à Halabja. Il a aussi payé pour le mariage de son frère. Je voudrais faire pareil ! », glisse le jeune Kurde.
Muhammed sait pourtant à quel point le chemin est semé d’embûches. En 2016, un bateau de migrants traversant la mer pour arriver en Italie depuis la Grèce a coulé, tuant dix-neuf membres de sa famille, du côté de sa mère. « Seule la tante de ma mère est restée en vie. Elle est partie ensuite aux Pays-Bas avant de retourner ici, où elle est morte il y a peu de temps »,explique le jeune homme. En 2018 déjà, lui-même a tenté sa chance. Quarante jours de route, 4 300 dollars dépensés (3 800 euros) de ses économies pour payer les passeurs, plusieurs pays traversés et une mer franchie, avant qu’il ne se retrouve enfin à Thessalonique, en Grèce.
A trois reprises, Muhammed a ensuite tenté une nouvelle traversée pour l’Italie. La dernière fois, dit-il, la police l’a arrêté après l’avoir tabassé. Le jeune Kurde a alors décidé de faire demi-tour. « Mais je vais refaire le même chemin, peut-être d’ici au printemps. Je veux aller dans n’importe quel pays, pour me débarrasser du Kurdistan, me sauver d’ici. La vie est dure. Il n’y a pas de boulot. Je vendrai la voiture que je viens d’acheter », assure-t-il.
Crise sans issue
Selon les chiffres de l’Organisation des Nations unies (ONU), le taux de chômage, pour les Kurdes âgés de 15 à 29 ans, est de 24 % pour les hommes et de 69 % pour les femmes. Dans cette région, la croissance économique est loin de suivre le rythme de la croissance démographique. Chaque année, pour absorber l’arrivée de jeunes sur le marché du travail, il faudrait quelque 50 000 emplois nouveaux dans la région, estime l’ONU.
Le père de Muhammed, employé gouvernemental dans le Bureau des retraités, gagne à peine assez pour subvenir aux besoins de ses quatre enfants. Muhammed voudrait bien se marier, mais il n’en a pas les moyens. Pour lui, comme pour la grande majorité des jeunes Kurdes, l’espoir d’être embauché par le gouvernement s’est éteint.
Depuis 2014, à cause de la crise économique inédite, tous les recrutements ont été gelés au Kurdistan d’Irak, contrairement à ce qui se pratiquait massivement pendant des années. La région compte près d’un million de fonctionnaires, pour une population de 6 millions d’habitants. Cette année-là, le prix du baril du pétrole, principale ressource d’Erbil, a drastiquement baissé, passant de 100 dollars à 30 dollars. L’organisation Etat islamique a surgi en Irak et en Syrie, mettant sous pression les autorités kurdes. Surtout, l’année 2014 a mis fin à la bulle économique créée avec l’arrivée des aides internationales après la chute de Saddam Hussein en 2003 et les milliards de dollars versés par le gouvernement central, plongeant le gouvernement du Kurdistan d’Irak dans une crise sans issue.
Si, aujourd’hui, Muhammed songe à partir, c’est aussi parce que les plaies infligées par le passé à la population sont loin d’être guéries. Le jeune homme et sa famille se rendent tous les ans, le 16 mars, au cimetière de Halabja, où les pierres blanches portent le nom des Kurdes tués à l’arme chimique par le régime de Saddam Hussein, en 1988. Quatorze membres de la famille de Muhammed, du côté de son père, ont péri lors de ce massacre, qui a, en quelques heures, provoqué la mort de quelque 5 000 civils – en majorité des femmes et des enfants – et fait des milliers de blessés et d’invalides. C’était la fin de la guerre Iran-Irak (1980-1988). La région frontalière de Halabja était brièvement passée sous contrôle iranien, avec l’aide des combattants kurdes. Saddam Hussein s’est vengé en bombardant leur territoire avec un mélange de gaz de moutarde, de tabun et de sarin.
« Nous sommes ignorés »
En cette fin de journée glaciale du mois de décembre, Muhammed Fatah Muhammed déambule dans le cimetière et montre du doigt des pierres. « Ça, c’est ma tante, Perwim Muhammed Qader, et son mari, Bahman Kaka Abdulrahman, explique-t-il. Leurs enfants sont aujourd’hui en Angleterre. » Encore plus loin, plus de pierres, plus de noms, dont celui de deux autres tantes, leurs maris et leurs enfants. « Après l’attaque, personne n’est venu dans la ville pendant un mois. Les morts ont été laissés par terre. Je n’étais pas né, mais j’ai entendu dire que les cadavres se transformaient en poudre comme ça »,poursuit le jeune homme en écrasant entre ses doigts une feuille d’arbre séchée.
L’un de ses oncles, Jalal Hussein, a survécu, mais, touché par un éclat à la colonne vertébrale, il ne peut plus bouger sa jambe droite. Assis sur un lit, cet homme écorche ses mots, ses poumons ayant été gravement touchés lors de l’attaque chimique. « Cela fait trente-quatre ans que mon frère vit avec moi, mais l’Etat n’a rien fait pour lui. Il n’y a eu aucune compensation, aucune aide pour ses opérations,regrette l’un des frères de Jalal Hussein, Ruzigar. On n’a plus d’argent pour s’occuper de lui. Depuis quelque temps, il n’arrive pas à contrôler sa vessie. »
Ancien peshmerga (combattant kurde), Ruzigar s’est battu à Kirkouk lors de l’insurrection irakienne de 1991 contre le régime baasiste de Saddam Hussein, après l’échec de ce dernier dans la guerre du Golfe. La révolte a été matée en un mois par l’armée irakienne. Dans ces combats, Ruzigar a perdu des amis. « On s’est sacrifiés pour nos dirigeants, mais ils ne travaillent pas pour nous, parce qu’ils sont corrompus. Tous des voleurs »,s’emporte-t-il. L’homme, à la retraite depuis quelques années, fait référence aux anciens chefs de la résistance qui ont pris le pouvoir en se substituant au régime de Saddam Hussein au Kurdistan et qui se sont, depuis, considérablement enrichis, aux dépens de la majorité de la population.
La ville de Halabja, utilisée sans cesse par les autorités comme un symbole du martyre kurde, est, elle aussi, « laissée pour compte », disent les habitants. « Tout le monde connaît les Kurdes d’Irak avec ce qui s’est passé ici,explique Shilir, une des sœurs de Ruzigar, une survivante elle aussi de l’attaque chimique de 1988. Et encore aujourd’hui de nombreuses maisons sont en ruine et les services publics demeurent très défaillants. » Dans cette ville de 200 000 habitants, l’eau ne coule que six ou sept heures par jour. Pareil pour l’électricité. « Nous sommes ignorés, poursuit Ruzigar. Si ça ne dépendait que de moi, je dirais que les jeunes doivent tous partir. Cela me rendrait très heureux que Muhammed s’en aille. Peut-être que, comme ça, on pourra emmener Jalal Hussein dans un pays européen et le faire opérer. »
A 70 kilomètres de Halabja, dans l’université publique de la ville de Sharazur, l’enseignant en anglais Hamid Mustafa est entouré des étudiants qui veulent, pour la grande majorité, eux aussi quitter le Kurdistan d’Irak. « Je les comprends. Ici, le chômage est très élevé. La mauvaise gestion est un vrai fardeau. Et l’instabilité règne », explique cet homme de 37 ans, aux cheveux et à la barbe déjà poivre et sel. Son salaire, comme celui de tous les fonctionnaires, a connu des réductions depuis 2017, à cause de la crise économique. « Parfois, pendant des mois, on ne touchait rien du tout, soutient-il. Ici, le système politique appartient à deux clans, les Barzani [à la tête du Parti socialiste du Kurdistan, PSK] et les Talabani [Union patriotique du Kurdistan (UPK), dirigée par Jalal Talabani (1933-2017)]. Ils embauchent qui ils veulent. Même le secteur privé leur appartient. Si tu ne les satisfais pas, tu restes dans les marges. »
L’un de ses étudiants, Shwana Karim, qui se spécialise en langue kurde, fait partie des rares jeunes confiants : « J’ai des contacts. Mes cousins occupent des postes haut placés au sein du parti UPK », assure le jeune homme barbu, assis sur un banc dans la cour de l’université. Son ami Muhammed Zebir n’a pas cette « chance ». « Je n’ai pas de connexions. Si je ne trouve pas d’emploi correspondant à mes études, je partirai. » Dans sa ville natale, Rania, à deux heures d’Erbil, nombreux sont ses amis et ses cousins qui ont déjà pris le chemin de l’exil. La plupart vivent aujourd’hui en Angleterre. Muhammed Zebir aussi a voulu leur emboîter le pas, il y a quelques mois, mais ses parents s’y sont opposés. « Dans notre région, Rania, le chômage est très élevé. Les dirigeants la négligent. La situation est meilleure dans les grandes villes comme Erbil et Souleimaniyé. Pas chez nous. »
Comme tous ses amis, il est au courant d’une récente affaire impliquant le premier ministre du Kurdistan irakien, Masrour Barzani. Selon une enquête du magazine The American Prospect,M. Barzani posséderait un immeuble de 18,3 millions de dollars (plus de 16 millions d’euros) aux Etats-Unis. « Je crois cette histoire. Pourquoi pas ? Ils [les dirigeants] ont volé beaucoup d’argent. Pour eux, 18 millions de dollars, c’est rien du tout », dit le Kurde de 19 ans, au physique frêle.
« La classe moyenne disparaît »
Pour Mera Jasm Bakr, chercheur non résident au centre de réflexion de la Fondation allemande Konrad Adenauer, la frustration chez les jeunes Kurdes est à son comble. « Ils voient quotidiennement une classe, proche des leaders, qui s’enrichit. Ce sont aussi les fils des dirigeants, comme une dynastie, qui profitent politiquement et financièrement du système. Et cela est vécu par les jeunes comme une absence de méritocratie dans le pays. La classe moyenne, elle, est en train de disparaître. »
A l’université de Sharazur, même le naufrage du 24 novembre ne semble guère altérer la décision des jeunes de partir. « Je sais que le voyage présente des risques. Mais hors de question que je reste ici », soutient Muhammed Zebir.
A Rania, à trois heures de route de Halabja, dans l’un des seuls parcs de la ville, Faryad Rahman compte deux amis d’enfance déjà installés au Royaume-Uni. Lui-même affirme bientôt vouloir tenter sa chance. Diplômé en informatique, le jeune homme de 23 ans cherche un emploi depuis un an et demi. Il n’appartient à aucun parti politique, ce qu’il juge nécessaire pour trouver un travail. « Ici, pour réussir, tu dois être jaune [couleur du PSK] ou vert [couleur d’UPK], soutient-il. Ces partis demandent beaucoup de choses : tu dois assister à leurs conférences, publier des posts sur Facebook et ailleurs, en soutien au parti et pour démontrer ta loyauté, pour qu’ils te proposent enfin un travail. »
Bijan Hussein Aziz chez lui à Erbil, au Kurdistan irakien, le 16 décembre 2021. Il est déjà allé avec sa famille en France. Il a retenté sa chance seul mais a été bloqué en Biélorussie et souhaite repartir, car il se sent menacé ici.Le jeune homme a participé à une manifestation en 2014 à Rania pour réclamer que la construction d’une route menant à sa ville soit terminée. La police est intervenue et plusieurs participants ont été blessés. « J’ai arrêté de manifester, parce que mes amis dans les partis politiques m’ont dit que des gens appartenant aux partis infiltrent les contestataires et jettent des pierres pour donner un prétexte aux policiers de nous tirer dessus. C’est pour cela que je n’y vais plus. » Le jeune homme a réfléchi à ce qu’il dirait, une fois arrivé au Royaume-Uni. Il compte se présenter comme citoyen iranien. « Je dirai que ma vie en tant que Kurde en Iran est en danger, glisse-t-il. Comme ça, j’aurai plus de chances d’obtenir l’asile politique. »
Naufrage au large de Calais: les associations appellent l’État à payer les frais d’obsèques
Le groupe décès est un groupe inter-associatif composé « de membres individuels, de membres de Médecins du Monde, d’Utopia 56, du Secours Catholique et de Solidarity Border ». Sa mission, aussi indispensable que délicate, consiste à identifier les défunts mais aussi « à accompagner et soutenir, autant que faire se peut, les proches des personnes décédées et les communautés de personnes exilées », indique-t-il dans un communiqué.
Dignité piétinée
Cette mission passe par « la préparation de l’inhumation ou du rapatriement, le soutien psychologique ou matériel des rescapé-e-s, des témoins, et de celles et ceux qui ont vu leur frère, leurs parents, leurs proches mourir sous leurs yeux ». En général, l’inhumation ou le rapatriement sont financés grâce à des appels aux dons par les associations. Leur coût varie entre 2 000 et 4 000 euros. « De cela, l’État ne s’est jamais préoccupé. Même après la mort, la dignité des personnes exilées est piétinée », dénonce le groupe qui cherche également « à faire le lien avec les autorités administratives face à leur absence de mobilisation ».
Soutenir, accompagner
Après cette tragédie, les bénévoles veulent envoyer un message au président de la République et à son gouvernement. « Aujourd’hui, il est urgent que l’État fasse enfin ce qu’il ne fait jamais lors des disparitions et des décès malgré nos multiples alertes », c’est-à-dire « soutenir matériellement, accompagner moralement, finalement considérer les personnes décédées et leurs proches ». Ils attendent que « les représentants de l’État prennent leurs responsabilités » et « pas uniquement pour cette tragédie mais aussi pour toutes celles qui, inéluctablement, vont suivre, si l’État continue à s’entêter dans ses politiques assassines ».
Contactés, la Préfecture du Pas-de-Calais et le ministère de l’Intérieur n’ont pas répondu à nos sollicitations.
27 VIES NOYÉES DANS LE DÉSESPOIR ET L’HORREUR
25 novembre 2021 – Damien Carême
7 femmes. 17 hommes. 3 jeunes « pouvant être des adolescents » : 2 garçons et 1 fille.
27 vies.
27 vies noyées dans le désespoir et l’horreur.
27 vies arrachées à leurs familles, atomisées par la tragédie.
Alors que les morts s’entassent sur la plage, la nausée nous envahit. Elle retourne nos tripes.
La nausée. Celle-là même qui, ce matin, lorsque le Ministre Darmanin tapait sur les passeurs, annonçait un arsenal de renforts et présentait ses condoléances « aux proches des victimes », révélait de façon certaine la manipulation effroyable : le drame, c’est précisément lui et le gouvernement d’Emmanuel Macron qui l’orchestrent. Jour après jour, sciemment. Ce sont eux qui militarisent à tout va, ce sont eux qui harcèlent les Solidaires et brutalisent les exilé·e·s, ce sont eux qui lacèrent les tentes, eux qui chassent, séparent, violentent, laissent croupir des femmes, des hommes, des bébés, des vieillards, des adolescents dans le froid, la boue et la misère la plus ignoble.
Ce sont eux qui créent le système qui permet aux passeurs d’exister.
Ce sont eux qui entretiennent à l’égard des exilé·e·s, le vocabulaire de la haine.
Ce matin, notre pays des droits humains s’est réveillé le visage inondé de larmes et de colère aussi : car plus personne n’est dupe.
Ce qui a tué hier soir, c’est l’inhumanité des puissants. Leur cynisme dégoutant. Leur rejet. Leur électoralisme. Le business as usual de l’extrême-droite, récupéré par ces sombres sires simplement désireux de se faire réélire.
Hier soir, pourtant, comme tous les soirs : des associations, des ONG de terrain, des bénévoles, des citoyens et des citoyennes solidaires étaient à pied d’œuvre. Au bord de l’eau sur les côtes de la Manche, dans les dunes, dans les rues de Calais, Dunkerque, Ouistreham, dans les villes, partout, d’un bout à l’autre de France, de la frontière franco-espagnole au pays basque jusqu’aux sommets des montagnes de la frontière franco-italienne : hier soir, oui, beaucoup tentaient de réchauffer les exilé·e·s. Beaucoup tentaient malgré tous les bâtons mis dans leurs roues, de prendre soin, de panser, de nourrir autant que possible, d’essuyer les larmes.
Hier soir, comme depuis tant de soirs, tant de jours, de semaines, de mois et d’années, ces citoyennes et ces citoyens alertaient, suppliant les dirigeants d’agir, par humanité. Juste par humanité.
Et hier soir, comme tous les autres soirs, ces mêmes dirigeants – technocrates de ministères et autres pontes de cabinets ministériels, ont fait la sourde oreille.
Pendant qu’ils ignoraient les appels à l’aide, la mort a frappé.
Ma rage, aujourd’hui, égale ma tristesse.
Le drame d’hier soir aurait pu être évité.
D’autres surviendront encore si rien ne change.
Et je vous le dis, lorsque ces autres drames surviendront, ces dirigeants-là feront encore semblant de pleurer.
Je refuse d’être complice. Si mes larmes, nos larmes, aujourd’hui noient douloureusement notre âme, nous sommes là pour hurler notre peine et dire, encore et encore, que OUI les solutions existent :
- Cesserde nourrir le rejet, de jouer avec les peurs et les mots de haine.
- Cesserles violences et la militarisation.
- Respecterles droits humains, et les textes fondateurs de notre société humaine.
- Mettre finà la directive de Dublin.
- Instaurer des voies légales de migration vers le Royaume-Uni : cette décision démantèlera de fait les réseaux de passeurs.
- Accueillir dignement les êtres humains qui sont là, qui arrivent, qui arriveront encore pour sauver leur vie et parce qu’ils n’auront eu aucun autre choix.
- Soutenirla solidarité.
La nuit dernière, c’est leur cynisme qui a tué.
La nuit dernière, les corps de leurs victimes flottaient à la surface de leur inhumanité.
Ces frontières qui rendent fou et qui tuent
|
TRIBUNE
Le naufrage au large de Calais s’ajoute à la litanie des drames aux frontières de l’UE. A la sidération ont succédé l’oubli, l’habitude et l’indifférence, estime l’anthropologue Michel Agier. Pourtant, des solutions existent, à commencer par la mise à l’abri des exilés.
par Michel Agier, Anthropologue (EHESS et IRD), auteur (avec Y. Bouagga, M. Galisson, C. Hanappe, M. Pette et Ph. Wannesson) de « La Jungle de Calais. Les migrants, la frontière et le camp », PUF, 2018. Libération, le 25 novembre 2021 à 9h46
Le naufrage d’une frêle embarcation est un nouvel épisode dramatique dans une interminable litanie des morts aux frontières de l’Europe. Sur le fond, il n’y a malheureusement rien de fondamentalement nouveau avec ce drame. Depuis 1993, les frontières extérieures de l’Union européenne ont vu la mort d’au moins 50 000 personnes qui tentaient de les traverser, principalement en Méditerranée. Et depuis 1999, plus de 300 personnes sont mortes à Calais et dans sa région en tentant de franchir la frontière britannique «externalisée» en France, depuis 2004 par les accords du Touquet. Les années 2000 et 2010 ont été jalonnées de ces annonces de morts aux frontières, parfois monstrueuses comme ce millier de morts en deux naufrages successifs les 12 et 19 avril 2015. Mais aux sidérations ont succédé l’oubli (l’absence d’hommages publics et officiels et le deuil impossible y contribuant) puis l’habitude, qui ouvrent la voie à l’indifférence. La brutalité des discours politiques (qui ne sont plus la seule marque de l’extrême-droite) contre les étrangers indésirables (noirs et bruns, venant des pays du Sud et pour beaucoup des anciennes colonies européennes) donne aujourd’hui à cette indifférence la forme de véritables projets politiques de rejet de l’autre et du monde. Avec l’horizon funeste du repli sur soi comme leitmotiv. «Passeurs criminels»Il faut donc mettre ces 27 personnes décédées dans la Manche en relation avec ce qui se passe ces jours-ci à la frontière polonaise de la Biélorussie et son déploiement des policiers et de l’armée contre les migrants, tout comme avec les tirs de l’armée et de la police grecque le 4 mars 2020 qui firent au moins sept blessés et un mort parmi les réfugiés coincés à la frontière gréco-turque. Immédiatement après le naufrage de la Manche ce 24 novembre, les gouvernants français et britanniques se sont unanimement empressés de mettre en avant la responsabilité des «passeurs criminels». Cherchez l’erreur ! Les «passeurs» ne sont pas les responsables des morts aux frontières, ils sont les profiteurs sordides et criminels des politiques publiques des pays européens qui font des frontières des murs, des camps ou des cimetières. Pour le directeur de l’OFII, Didier Leschi, promu représentant de l’Etat ces dernières semaines à Calais, ce sont les passeurs «qui essaient […] de maintenir des camps en bord de mer» afin de mieux recruter les candidats au voyage interdit vers le Royaume-Uni. Or c’est précisément la responsabilité de l’Etat de créer des lieux sûrs de prise en charge des exilés au lieu de les laisser en errance et aux mains des passeurs. C’est ce qui lui a été demandé lors de sa mission à Calais, mais en vain. Solutions immédiatesLes frontières rendent fous : aussi bien les migrants qui sont empêchés de circuler, que les dirigeants politiques qui y voient le symbole de leur obsession nationale. Et les frontières tuent maintenant de plus en plus. Si l’on ne veut pas que la Manche devienne un cimetière, comme vient de s’y engager le président français Emmanuel Macron, des solutions existent. Elles peuvent être décidées immédiatement et seraient le début d’une réhumanisation indispensable à la compréhension de la question migratoire et à la prise de décisions. La mesure la plus urgente est la mise à l’abri des exilés de la région de Calais, dans des lieux sûrs, c’est-à-dire protégés des intempéries de l’hiver comme des sollicitations dangereuses des passeurs. Mais aussi sûrs de leur point de vue, c’est-à-dire n’étant pas des pièges vers la rétention et l’expulsion. Cette mise à l’abri doit aller de pair avec un accompagnement de leurs demandes : rester en France, partir en Grande-Bretagne ou ailleurs. Il y a des travailleurs sociaux et des volontaires associatifs qui savent faire cela, donner confiance, établir le dialogue, chercher à comprendre plutôt qu’à trier et exclure. Dans ce cadre, il peut être proposé à toutes ces personnes des voies rapides de régularisation en France. On verra alors, comme on l’a déjà vu, que cette proposition peut avoir plus d’écho qu’on ne le croit, et peut calmer la situation. Renégocier les accords du TouquetEnfin, il faut imposer sans plus attendre au Royaume-Uni ce qui a été promis plusieurs fois déjà sans être appliqué : la renégociation des accords du Touquet d’externalisation de la frontière britannique en France, pour sortir de cette position honteuse d’exécutant des basses-œuvres de notre voisin contre rétribution, à l’image de ce que font la Libye, la Turquie ou le Maroc pour l’Union Européenne. Ces mesures auront notamment comme effet indirect mais immédiat d’assécher le fonds de commerce des passeurs. C’est la dignité de notre pays qui est en question. Et sa responsabilité aussi, après le drame qui vient d’avoir lieu sur ses côtes. Plus que tout, ces solutions supposent une confiance de l’Etat à l’égard du monde associatif de la région qui, depuis des années maintenant, est mobilisé sur la question migratoire, et en a une connaissance profonde, dialoguant avec les chercheurs en sciences sociales. C’est cette confiance qui manque actuellement aux représentants de l’Etat, qui semblent ne pas voir les solidarités au sein de la société française. |
24-11-2021 – Communiqué de presse « A la frontière franco-britannique, nous ne voulons plus compter les mort-e-s »
16-11-21 Communiqué de presse : Rapport 2021 Observatoire des expulsions de lieux de vie informels
une dizaine de pays européens partisans de la construction de « murs » aux frontières extérieures de l’Union
Par Jean-Pierre Stroobants (Luxembourg, envoyé spécial), Le Monde, 08 octobre 2021
Les ministres de l’intérieur et des migrations des Vingt-Sept se sont réunis, vendredi 8 octobre, au Luxembourg, alors que les violences se multiplient contre les migrants dans plusieurs pays.
Ils ont survolé la question, devenue, il est vrai, banale : les ministres européens de l’intérieur et chargés des migrations, réunis vendredi 8 octobre à Luxembourg, n’avaient pas envie de s’appesantir sur cette nouvelle affaire de pushbacks (refoulements illégaux) de migrants, révélée la veille par le consortium d’investigation Lighthouse Reports . Cette fois, celui-ci s’était appuyé sur des enregistrements prouvant les brutalités commises par des membres de forces de l’ordre, aux uniformes rendus anonymes, des « unités spéciales » à l’œuvre en Croatie, en Grèce et en Roumanie, et dont le financement pourrait venir de fonds européens.
Les ministres des pays concernés ont promis d’enquêter. Ce n’est pas la première fois, et les résultats éventuels des investigations précédentes n’ont jamais été dévoilés. « Nous n’allons pas nous excuser, nous protégeons les frontières extérieures et luttons contre les réseaux de trafiquants », expliquait, dès jeudi, le ministre grec des migrations, Panagiotis Mitarakis.
La commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatovic, parle d’« une normalisation inacceptable de la violence », tandis que la commissaire européenne à la migration, Ylva Johansson, s’est, pour sa part, dite « extrêmement inquiète ». Mais ses services font valoir leur incapacité à contrôler, et éventuellement à sanctionner, des Etats membres.
Pas d’action « en tant qu’Union »
Au cours de la discussion de vendredi, Mme Johansson a bien dû constater que, sur ce sujet comme sur d’autres, sa marge de manœuvre semble s’amenuiser de réunion en réunion. « Nous agissons en tant qu’Europe du Sud, de l’Est, de l’Ouest ou du Nord, mais pas en tant qu’Union » a-t-elle déploré. Autour de la table, un consensus a seulement été trouvé pour condamner vivement l’attitude du régime biélorusse et son instrumentalisation de la migration : visé par des sanctions européennes pour la violente répression à laquelle il se livre, le régime d’Alexandre Loukachenko a dirigé vers ses frontières avec la Lituanie et la Pologne des milliers de personnes, majoritairement des Irakiens.
Evoquant ce qu’ils appellent une « attaque hybride » contre eux et l’Union, les deux pays concernés, appuyés par dix autres, dont la Grèce, la Hongrie et l’Autriche, réclament désormais de la Commission qu’elle finance la construction de murs aux frontières extérieures de l’Union. Ils jugent que ce projet doit devenir prioritaire, car « au bénéfice des Vingt-Sept ». « Les fonds européens ne peuvent servir qu’aux systèmes de gestion intégrée des frontières », a précisé un porte-parole de la Commission. Ce qui exclut, a priori, l’édification de murs.
Un autre sujet de préoccupation des ministres européens reste la possible arrivée sur le continent de réfugiés afghans . « A ce stade, pas de panique, mais nous restons attentifs », a commenté un diplomate. Jeudi, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a exprimé son souhait que l’Union accueille 42 500 réfugiés afghans au cours des cinq prochaines années, soit la moitié d’un contingent de 85 000 personnes séjournant actuellement dans les pays voisins de l’Afghanistan. « C’est réalisable », a jugé Mme Johansson, même si, pour l’heure, aucun pays n’a précisé son degré d’engagement.
Quelque 22 000 ressortissants afghans ont jusqu’ici été évacués et accueillis dans 24 Etats membres. Le Bureau européen d’appui en matière d’asile estime que, depuis le mois d’août dernier, 123 000 demandeurs d’asile afghans sont arrivés en Europe. En France, 7 200 Afghans ont demandé l’asile depuis le début de l’année, et 2 618 ont été accueillis depuis la mi-août.
Plusieurs contradictions
Certaines sources envisageaient l’arrivée de 500 000 demandeurs supplémentaires en 2021, à la suite de la chute de Kaboul. A ce stade, la perspective d’une arrivée massive semble s’éloigner, a confirmé le ministre français Gérald Darmanin. Tant mieux, soupirent certains diplomates, car une nouvelle version de la crise syrienne accentuerait les tensions et les divisions entre les Vingt-Sept, d’autant que le projet de pacte global pour la migration déposé en septembre 2020 par la commission serait dans ce cas d’un faible secours. C’est ce que diagnostique Catherine Wihtol de Wenden dans une récente étude pour la Fondation Robert-Schuman : la directrice de recherche émérite au CNRS souligne qu’aucun des outils proposés ne serait utile, en l’occurrence.
Il ne pourrait être question, comme le suggère le projet de pacte, d’accélérer les retours pour des gens qui fuient un régime comme celui des talibans. Il serait difficile de négocier un accord avec l’Iran et le Pakistan comme cela avait été le cas avec la Turquie, pour les réfugiés syriens, en 2016. Quant au « partage solidaire » des personnes accueillies, il se heurterait, à coup sûr, au refus d’une majorité de pays membres.
De quoi illustrer, une fois de plus, « les contradictions entre l’approche sécuritaire qui domine chez les gouvernants européens, une solidarité entre Etats qui fait défaut, et le rappel par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell , du devoir d’accueil », note Mme Wihtol de Wenden.
Au-delà, ce pacte « pour une politique juste et raisonnable » a-t-il encore la moindre chance de voir le jour ? Il propose notamment une harmonisation du droit d’asile, une solidarité obligatoire en cas de crise aiguë, une accélération de la politique de retours et un filtrage des migrants à l’entrée. A ce stade, seul ce dernier point semble récolter l’assentiment d’une majorité de pays membres. « Il faudra sérier les problèmes, mais ne pas oublier la solidarité », expliquait vendredi M. Darmanin, convaincu que la prochaine présidence française de l’Union pourra faire progresser le débat. Pour d’autres capitales, il s’agit à l’évidence de s’en tenir uniquement à une approche strictement sécuritaire.
Jean-Pierre Stroobants(Luxembourg, envoyé spécial)
À Grande-Synthe, l’invisible odyssée des exilés vietnamiens
Mediacité, 10 septembre 2021 par Nicolas Lee
Dernier arrêt avant l’Angleterre pour une dizaine de milliers de migrants par an, le bidonville de Grande-Synthe, près de Dunkerque, héberge aussi quelques centaines de Vietnamiens particulièrement exposés aux passeurs-mafieux. Enquête sur une migration fantôme.
À droite, à gauche et en se penchant par-dessus le volant, Thomas Gauthier examine les environs du parking de la zone commerciale de Grande-Synthe. « Les CRS sont partout, ici. On va éviter de se faire contrôler et de se choper une amende… » Bénévole depuis 2013 dans l’association Wise, qui vient en aide aux exilés dans le nord de la France, ce trentenaire à la barbe poivre et sel cherche à gagner un camp de migrants qui voit passer quelque 9 500 personnes par an.
Le bidonville se cache dans les bois à quelques centaines de mètres à peine d’un Auchan, invisible aux regards des clients qui s’affairent avec leurs caddies. La Kangoo rouge s’engage dans un chemin bordé d’arbres et débouche sur un parking poussiéreux. Thomas entreprend de décharger la voiture avec Karim, « pote de pote » venu donner un coup de main pour la première fois. « La majorité de la population, ici, est constituée de Kurdes d’origine irakienne, iranienne et turque, lui explique Thomas. Il y a des Pakistanais et depuis peu des Érythréens. Et aussi des Vietnamiens… » « Des Vietnamiens ? » Karim est étonné. Il n’en avait encore jamais entendu parler.
Une migration méconnue
Cette migration, méconnue du grand public, fait les gros titres en 2019, lorsqu’un charnier de 39 corps est découvert à l’intérieur d’un camion réfrigéré, à 30 kilomètres de Londres. En découle une opération de police qui conduit à l’arrestation de 26 personnes en France et en Belgique. La fermeture d’une filière qui ne met toutefois pas fin au trafic. « Il y a toujours environ une trentaine d’asiatiques dans le camp », observe Claire Millot de l’association d’aide aux migrants Salam.
Au début du mois de mai dernier, une centaine de Vietnamiens arrivent au camp du Puythouck sous le regard stupéfait des associations. « Ils avaient des valises à roulettes, étaient bien habillés. On avait du mal à croire qu’ils vivaient là », se souvient Thomas Gauthier. La communauté vietnamienne représente pourtant près d’un passage de la Manche sur cinq, révèle le commissaire Xavier Delrieu, chef de l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière (Ocriest).
« Toute la famille se mobilise pour réunir entre 30 000 et 40 000 euros pour payer le voyage. »
Dans les années 1970, les « boat people » fuyaient la crise humanitaire héritée de vingt années de guerre et l’effondrement du gouvernement du Sud Viêtnam. Aujourd’hui, ceux qui partent sont les laissés-pour-compte du développement économique. « C’est la pauvreté que fuient les Vietnamiens », observe Thi Hiep Nguyen. Chercheuse en littérature vietnamienne et en langue étrangère, elle a participé pendant près d’un an à une enquête de terrain sur la migration vietnamienne pour France Terre d’Asile.
Dans les centres de rétention administratifs (CRA) et les bidonvilles des Hauts-de-France, elle croise en majorité des hommes qui rêvent de l’eldorado britannique. À Londres et à Birmingham, elle rencontre des Anglais d’origine vietnamienne qui emploient des sans-papiers. « Certains gagnent beaucoup d’argent, comparé à leurs revenus au Vietnam – entre 1700 et 2300 euros – en travaillant dans des restaurants et des bars à ongles. »
Comparé à un salaire minimum de 160 euros par mois, le jeu semble en valoir la chandelle. « Toute la famille se mobilise pour réunir entre 30 000 et 40 000 euros pour payer le voyage. » L’objectif une fois sur place étant de rembourser la dette puis d’envoyer de l’argent au pays avant d’y retourner. « Les histoires de richesse et la prospérité apparente des voisins au village qui se construisent une belle maison incitent les personnes à partir », explique la chercheuse.
Du gage au servage
Mais les promesses de travail des trafiquants laissent souvent place au servage des migrants qui acceptent de s’endetter. C’est le cas des mineurs qu’accompagne Laura Duran de l’ONG Every Child Protected Against Trafficking (Ecpat UK). « Ils ne connaissent personne en Angleterre et sont sous l’emprise totale des passeurs », déplore-t-elle. Dans les groupes de parole qu’organise l’association, des adolescents de 15 ans racontent leur calvaire. « Certains travaillent dans des fermes de cannabis, vivent dans des appartements où ils dorment à même le sol avec un seul repas par jour. Ils ont interdiction de sortir sans être accompagnés. D’autres sont exploités… »
La militante observe également que des mineurs pris en charge par les services sociaux retournent parfois auprès de malfaiteurs par crainte de représailles contre leurs familles restées au pays. « Les trafiquants exercent une grande influence sur les jeunes, ajoute-t-elle. Beaucoup estiment qu’ils ont cette dette envers eux et acceptent de travailler presque sans revenus, ou sans. Ils sont réduits à l’état d’esclaves modernes. »
Parfois, ces migrants se retrouvent également forcés de collaborer à des activités criminelles. Xavier Delrieu, le patron de l’Ocriest, mentionne des cas de traite liés au trafic de drogue en France. « Tous les ans, nous avons en moyenne une ferme de cannabiculture qui est démantelée, constate-t-il. Les prisonniers [vietnamiens] ne se rendent pas compte de l’exploitation qu’ils subissent. » Au printemps 2020, huit personnes sont interpellées près de Montargis : elles cultivaient du cannabis dans deux fermes où des migrants vietnamiens auraient été contraints de travailler.
Grande-Synthe, dernière étape de la route migratoire
Pour Mediacités, le commissaire Delrieu remonte la filière bien rodée par laquelle les trafiquants, aidés de banquiers et de mafieux, s’assurent de transporter, nourrir et héberger les migrants. « Ils partent en avion du Vietnam avec un visa de travail pour la Russie. Ils entament la traversée de l’Europe de l’Est en poids lourd et arrivent à Paris où ils sont logés par les réseaux locaux. De là, en taxi ou en camion, ils sont envoyés à Grande-Synthe où le passage de la Manche s’effectue en small boat [embarcation de fortune] ». La petite commune accolée à Dunkerque est donc la dernière étape d’une éprouvante route migratoire.
À l’un des points d’eau du bidonville de Grande-Synthe, un asiatique d’une vingtaine d’années se passe de l’eau sur le visage. Il a le teint gris – est-il malade ? -, et une casquette de baseball vissée sur la tête. Il ne parle pas anglais, le français encore moins, mais tend son téléphone portable pour dialoguer. Sur l’écran s’affiche la page d’accueil d’un site de traduction automatique. Il explique qu’il va bien et souhaite aller en Angleterre pour travailler et aider sa famille restée au Vietnam. Avant de clore rapidement l’échange à l’arrivée de deux de ses compatriotes.
Arnaud Gabillat, coordinateur de l’association Utopia56, dégaine alors une carte sur laquelle est inscrit un numéro d’urgence : « Problem ? » Il mime de la fièvre en imitant une respiration lourde et en s’essuyant le front. « You », il le désigne. « Call and we help ! » invite-t-il enfin en faisant le geste du téléphone. Il termine avec un sourire. Son interlocuteur le lui rend, agite un « au revoir » de la main et s’éloigne, le regard plongé dans l’écran de son mobile.
« Les passeurs leur demandent de se méfier des associations. Ils leur font croire que s’ils nous parlent, ils seront interpellés par la police », explique Arnaud Gabillat. Parler à des associations et à des journalistes, c’est prendre le risque de subir des violences et des intimidations de la part des trafiquants. Quelques semaines plus tôt, un Vietnamien a été poignardé dans le camp, raconte-t-il. « La violence pèse à chaque instant sur les personnes qui vivent ici. »
 Lire aussi : A Calais, le règne sans fin des passeurs de migrants Lire aussi : A Calais, le règne sans fin des passeurs de migrants |
Isoler pour faire passer
Les différentes associations présentes à Grande-Synthe témoignent de la difficulté extrême d’entrer en contact avec les migrants vietnamiens. Claire Millot, de l’association Salam, admet que ces derniers viennent très peu les solliciter : « Ils ont leur nourriture, ils ont de l’eau et des vêtements et restent très discrets ». Le turnover lié à un rythme de passage soutenu empêche également les associatifs de tisser un lien ou d’avoir un interlocuteur fixe – à l’inverse d’autres communautés qui attendent parfois plusieurs mois avant d’effectuer la traversée.
Pour Mayliss, de l’association Solidarity border qui assure des maraudes de nuit, c’est aussi la barrière de langue qui rend le contact difficile. « On a des militants qui parlent arabe, parfois le kurde, mais personne ne parle le vietnamien malheureusement. » Reste que maîtriser parfaitement la langue et partager des origines communes ne suffit pas non plus.
Thi Hiep Nguyen s’est rendue dans le bidonville baptisé « Vietnam city », à Angres, démantelé en 2017. Elle se rappelle de la suspicion des migrants à son égard. « Je parle le dialecte du centre du Vietnam, d’où ils sont originaires. Nous avons discuté de mon frère, prêtre catholique qu’ils connaissaient [les Vietnamiens présents dans le camp sont catholiques pratiquants]. Mais malgré ces connexions, nous n’avons parlé qu’une heure. »
Nous aurons encore moins de chance aujourd’hui. À Grande-Synthe, les passeurs accompagnent, surveillent et vivent avec les exilés. À cause de cette surveillance, les langues sont liées. Sauf en de rares exceptions. Thi Hiep évoque encore l’histoire d’une jeune femme qui l’a bouleversée. « Elle nous avait sollicités parce qu’elle était enceinte. C’était contre ses convictions religieuses, mais elle voulait avorter à tout prix… » La chercheuse ne peut que deviner le contexte de cette grossesse non désirée. « Peut-être était-ce après l’agression d’un passeur… Elle ne nous a rien dit. »
« Pour [les passeurs], ils ne sont qu’une marchandise à protéger »
Pour Laura Duran, l’invisibilisation et l’exclusion sont des stratégies employées par les mafieux pour garder le trafic dissimulé, tout en dissuadant les voyageurs de renoncer en cours de route. « Pour eux, ils ne sont qu’une marchandise à protéger. » Sur les 800 Vietnamiens ayant traversé la Manche en bateau depuis le début de l’année, selon un décompte de la police aux frontières au mois de juin, combien seront asservis ? Impossible à dire, reconnaît la salariée d’Ecpat UK. Mais la tendance semble être à la hausse, sans que l’on dispose toutefois de statistiques récentes.
Après 40 minutes passées à chercher des exilés vietnamiens, Thomas et Karim finissent par marquer une pause devant un campement vide. Le bénévole désigne une serviette éponge grise sur laquelle on reconnaît un visage asiatique accompagné de lettres en majuscules : VIỆT NAM. Sur la parcelle désertée, un sachet de nouilles instantanées, des baguettes, un tube d’encens, de la sauce d’huître ou encore de la sauce piquante sriracha. Les lieux ne sont pas abandonnés – une rallonge serpente dans la forêt pour amener l’électricité dans les batteries portatives. Tout laisse supposer que le bivouac, prévu pour une dizaine de personnes, n’attend plus que l’escale des prochains voyageurs d’infortune.
Je rencontre pour la première fois des exilés vietnamiens en 2021, alors que j’accompagne des militants associatifs qui viennent en aide aux réfugiés du bidonville de Grande-Synthe, près de Dunkerque. À ma grande surprise, j’apprends qu’ils représentent près d’une personne sur cinq dans les bateaux qui traversent la Manche. Une réalité particulièrement méconnue du grand public.
Et pour cause : sur le terrain, les associations rencontrent les plus grandes difficultés à dialoguer et à évaluer les besoins de cette communauté. La barrière de la langue et le constant contrôle des passeurs contraignent les candidats à la traversée outre-Manche à la plus grande discrétion.
Mes origines sud-coréennes facilitent un peu les choses : certains acceptent enfin de me dire quelques mots, par le biais d’une application de traduction sur téléphone. Mais, sous surveillance, impossible d’instaurer une vraie relation de confiance : je ne parviens pas à discuter plus de dix minutes avec un habitant du camp, et jamais deux fois avec la même personne, en dépit de deux mois d’aller-retour régulier entre Grande-Synthe et Lille. Ce sont donc surtout les témoignages des chercheurs et des ONG qui ont pu travailler avec cette communauté qui m’ont permis de retracer le parcours de cette migration furtive.
Lettre des réfugiés de Calais
Jour après jour, nous appelons. Mais personne ne nous entend. C’est le langage de nos coeurs ici à Calais. Calais est une très belle ville, mais nous vivons simplement derrière un rideau de beauté. Nous ne pouvons voir les lumières ni de la vérité, ni de la liberté, ni de la sécurité a Calais. Nous sommes venus dans cette ville parce que nous avons un petit objectif. Nous vivons dans l’espoir que demain sera peut-être meilleur. Mais nous devons demander, Pourquoi I’univers ne nous permet pas d’atteindre notre futur, notre liberté, notre sécurité ? Chaque matin à Calais, il y a une nouvelle épreuve. Nous vivons en sachant que nos amis qui sont avec nous aujourd’hui ne seront peut-être plus avec nous demain. La mort est dans nos yeux, la peur et l’anxiété ne quittent pas nos esprits. Nos vies sont pleines d’histoires, mais elles sont très tristes et douloureuses. Aujourd’hui, nous avons perdu le sourire de notre cher frère Yasser. Hier encore, il jouait. Nous marchons sur les routes pendant la journée mais la peur ne nous quitte pas. Puis nous essayons de manger mais nous ne goutons que la tristesse. Nous buvons de l’eau mais nous n’étanchons pas notre douleur. Quand la nuit arrive à Calais, c’est calme. Nos yeux essaient de se reposer mais nous n’avons pas d’endroit pour dormir. Tout cela parce que nous avons un petit objectif La police de Calais. Nous nous demandons de temps en temps: pourquoi toute cette cruauté de votre part ? Vous savez que nous ne sommes pas vos ennemis. Nous vivons dans les bois, loin de vos yeux, parce que nous vous craignons. Pourtant, vous venez tôt le matin et prenez nos affaires de fortune comme si elles n’ étaient rien pour vous mais ous savez très bien qu’elles sont tout pour nous. Nos maisons. Sans humanité, vous nous laissez à l’air libre avec le froid qui nous pince et la pluie sur nos têtes comme si nous n’étions pas des êtres humains. Puis nous essayons de partir pendant que vous détruisez nos biens, nous sommes battus et gazés par certains de vos membres. Ensuite, vous nous faites monter de force dans. des bus du gouvernement en direction d’endroits lointains que nous n’avons jamais vus auparavant, en prétendant que tout cela est pour notre protection. Pourquoi ne nous ‘demandez-vous pas notre avis avant ? Les chauffeurs routiers. Lors de nos tentatives de passage de la frontière en camion, nous subissons des blessures répétées qui entrainent des fractures, des blessures graves voire la mort. Nous pensons que chaque blessure que nous avons reçue avait une intention délibérée de la part des chauffeurs. C’est clair, lorsque vous, le conducteur, remarquez qu’un réfugié se trouve dans le camion, vous secouez le camion et appuyez sur les freins encore et encore jusqu’à ce que nous lâchions prise. Vous savez que nous allons tomber et nous casser une épaule, une main, une jambe ou la colonne vertébrale. Mais cela ne vous suffit pas. Lorsque nous tombons au sol, vous nous frappez sérieusement. Vous vous éloignez et continuez votre chemin. Quand nous ouvrons les yeux, nous sommes à I’hôpital, encore une fois. Pourquoi Ne POUVONS-NOUS pas continuer notre voyage ? Les organisations humanitaires et l’aide médicale Calais, nous profitons de cette occasion pour remercier chaleureusement les personnes qui portent les vestes d’aide humanitaire à Calais. Merci pour le travail que vous faites encore et encore. Vous sauvez la vie de nos frères et soeurs blessés. Nous vous devons beaucoup. Nous remercions également nos frères et soeurs des organisations qui nous aident en nous fournissant de la nourriture, de l’eau et des douches.
Pour Yasser, De la part des réfugiés de Calais, 2021,